| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°610 Octobre 1946 > Page 316 | Tous droits réservés |
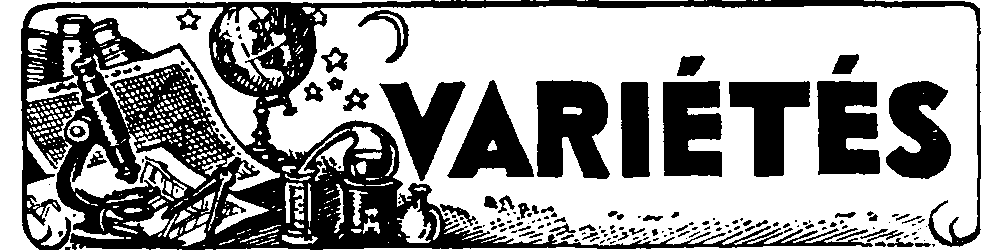
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
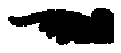
|
Peut-on créer la vie ? |
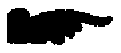
|
|
La vie est le grand mystère, le seul que la science n’ait absolument pas réussi à élucider. Nous savons capter les ondes, transmettre des images par télévision, descendre à 900 mètres sous la mer, voler en piqué à 1.000 kilomètres à l’heure, analyser la composition chimique de Sirius, photographier des nébuleuses à une distance de cinq cent millions d’années-lumière, fabriquer des engrais avec l’air atmosphérique ... mais ce petit morceau de chair vivante, les plus puissants laboratoires du monde ne sauraient pas le créer. Cet œil perdu, fussiez-vous milliardaire, nul savant ne pourra vous le remplacer. L’extraordinaire tentative de Stéphane Leduc.— Un beau jour de l’année 1905, les quotidiens lancèrent en caractères d’affiche une nouvelle sensationnelle : un savant français, Stéphane Leduc, avait réussi à créer des plantes artificielles, de véritables êtres vivants. Dans de hautes éprouvettes de verre, des photographies montraient, en effet, la première plante créée de main d’homme, analogue à la plante aquatique naturelle nommé antennuaris ramosal : dans le bas, une gerbe de tiges minces comme de la paille, bientôt divisées en branches, puis en fines brindilles ; l’ensemble se balançait dans le liquide, imitant les flexibilités de la vie ; l’organisme artificiel croissait et se développait, se nourrissant des substances chimiques dissoutes dans le liquide ... Ce fut un beau scandale qui mit aux prises les matérialistes triomphants et les « vitalistes » partisans d’une force spirituelle supérieure présidant aux phénomènes de la vie. Comment procédait Stéphane Leduc ? Voici. Dans une éprouvette, on verse tout d’abord une solution de ferrocyanure ; dans ce « milieu » chimique peu propre en apparence à la vie, on « sème » une graine non moins diabolique : une boulette formée de sulfate de cuivre et de sucre. Sous l’action du liquide, la boulette s’entoure d’une membrane de ferrocyanure de cuivre, dans laquelle l’eau pénètre par pression osmotique, sous l’influence du sucre. La membrane se distend, s’allonge, se hérisse d’épines, de vrilles et d’étranges feuilles, s’arrondit en grappes de fruits comme une plante véritable. Des substances convenables, ajoutées au bain nutritif, donnent à cette végétation artificielle les plus étranges couleurs. Marions le vivant et l’artificiel.— Dire que les « plantes » au ferrocyanure vivent serait une exagération scientifique : elles ne meurent point ... preuve qu’elles n’ont jamais vécu ! En outre, elles n’ont pas de forme propre comme un chrysanthème ou un pommier ; leur silhouette dépend exclusivement de la composition chimique du liquide. Un fragment microscopique d’algue, transporté dans une eau claire, l’envahit de millions d’algues semblables, tandis qu’un fragment de « plante artificielle » se désagrège misérablement. Le biologiste Raph Lillie obtint des résultats suggestifs en mélangeant au ferrocyanure des produits naturels tel que le blanc d’œuf. Plongée dans ce milieu hybride, une lame de fer se couvre d’une toison de tubes minuscules qui croissent rapidement et rappellent la chevelure ou « thalle » des champignons. On constate ici encore que la pseudo-plante se « nourrit » en empruntant au liquide des substances qu’elle choisit. Si l’on coupe l’extrémité d’un filament, celui-ci repousse, comme la patte d’une araignée, et l’on s’aperçoit qu’il y a dans ce tube une véritable circulation, analogue à celle de la sève. Mieux encore, touchons la plaque de fer qui forme notre terrain de culture avec un métal « noble », tel que de l’or ou du platine : la croissance s’accélère : elle se ralentira, au contraire, si nous touchons le terrain avec un métal vulgaire, tel que du zinc. Il y a là une curieuse ressemblance avec les fameux « poinçons » d’or, de cuivre et d’argent utilisés dans l’ « acupuncture » chinoise. Les plantes « semi-artificielles » se rapprochent ici curieusement des organismes les plus compliqués, tels que ceux des animaux et de l’homme. Les désordres de la vie.— Un savant suisse, M. Pfeiffer, du laboratoire biologique du Gœthéanum-Dornach, a pu aller plus loin encore. Nous connaissons tous ces « fleurs de givre » qui croissent sur les vitres de nos fenêtres par un matin glacial d’hiver. Vous seriez sans doute fort surpris si l’on vous démontrait que ces élégantes arborescences traduisent fidèlement l’état de santé, le tempérament de la personne qui dormait dans cette chambre. C’est pourtant à des résultats hautement équivalents qu’est parvenu M. Pfeiffer au bout d’une série d’expériences de huit années. Sur une lame de verre, déposons une goutte d’eau contenant en dissolution de l’acétate de plomb ou du chlorure de cuivre. Abandonnée à l’abri de la poussière, notre goutte va sécher en laissant un « givre » cristallisé. Si le corps chimique ci-dessus est employé pur, le givre présentera un aspect « désordonné ». Il en sera tout autrement si nous avons mélangé à la solution une minuscule quantité de sang ou un extrait de graine ; on constatera alors que, sous l’influence de cet élément vital, toute la cristallisation s’est merveilleusement polarisée en figures régulières. Mais le plus curieux est que, si nous avons utilisé un extrait de graine ou de racine provenant d’un arbre rabougri, qui aura poussé, contrefait, sur un terrain marécageux, la cristallisation sera également difforme. Elle sera éclatante, solaire comme une rosace de cathédrale, si nous avons prélevé le suc sur un arbre droit et de belle venue. Quelque chose d’individuel, de particulier à l’arbre est donc venu conditionner également la forme cristalline. Comment ne pas songer ici à ce « guide invisible » dont parle Claude Bernard, à cette « âme » (entéléchie) d’Aristote qui vient pétrir, organiser, la matière vivante pour créer des êtres ? Comment ne pas évoquer les extraordinaires substances vitales, les « organisateurs », dont la découverte valut à Spemann le prix Nobel et qui se chargent, dans un embryon de poulet ou d’homme, de faire pousser un membre, une tête, un œil ? Créer la vie, fabriquer des « hommes en fiole », ce rêve des alchimistes ! des animaux fabuleux qui volettent sur les pelouses, nous n’en sommes pas encore là, et, du reste, ces amusettes spectaculaires sont-elles souhaitables ? Un but plus élevé nous attend. En démontant le mécanisme régulier de la cellule vivante, nous commençons à comprendre le mécanisme atrocement déréglé des « cellules folles », le tragique bourgeonnement des néoplasmes, et peut-être arriverons-nous, comme Pasteur, à force d’ascétisme d’esprit et de patience, à vaincre ce chancre de la vie, le cancer. Pierre DEVAUX. |
|
|
Le Chasseur Français N°610 Octobre 1946 Page 316 |
|