| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°614 Juin 1947 > Page 469 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Défense de fumer |

|
… même une Gitane
|
Jadis, la recommandation n’était pas superflue : combien de sangliers, de chevreuils, de renards n’ont dû la vie sauve qu’à la fumée d’une pipe ! S’il est admis de prendre quelques libertés tant qu’il ne s’agit que de pousser d’innocents capucins vers le coup de fusil final, rien n’est de trop avec les grands animaux de battue, dont la méfiance est toujours en éveil et les sens à vif. Alors, sauf empêchement rigoureux, cela devient une impérieuse nécessité de descendre toujours la traque dans le lit du vent — et pas de cigarettes. Qui d’entre nous, pour peu qu’il ait chassé en forêt, n’a connu ces enceintes au travers desquelles un souillaud prudent s’est promené à pas feutrés, allongeant sous bois, hors portée, sa marche silencieuse, sans bouger une brindille, reconnaissant longuement la ligne des tireurs, puis, une fois sa religion éclairée, a fait un brusque demi-tour, à grand fracas, son flanc rude broussant dans les gaulis, et, finalement, a foncé sur les traqueurs ? Sans conteste, ce sanglier resté invisible, et qui lui-même n’a rien pu voir, a reniflé de loin ces gens-là, qui lui voulaient malemort. C’est ici que chacun doit être silencieux, incolore et, s’il se peut, inodore. Ma terreur, aux temps où je chassais en forêt lorraine, c’était ce voisin odieux, incapable de se tenir tranquille, qui tousse, qui crache, se mouche à grand renfort de trompettes, tape du pied pour se dégourdir et sort une cigarette de son étui, juste à l’instant où le coup sourd d’une corne lointaine annonce que l’attaque est partie. Bien heureux encore si le mufle — car c’en est un — ne pousse pas la gentillesse jusqu’à venir vous en offrir une, en taillant une bavette. Celui-là, fuyez-le comme la peste ! Dommage qu’au règlement de la société un article n’autorise pas à le faire taire, d’un coup de vingt-huit grains ... Je sais bien qu’il arrive parfois, malgré le vent mauvais et les bavards, qu’un vieux baptiste, ou qu’une compagnie de bêtes noires viennent sauter la ligne, de propos délibéré. Nul n’a jamais pensé que ce soit faute de nez, mais bravoure, folie, goût de suicide, ou toute autre raison échappant à nos idées de civilisés. J’ai bien vu un renard — mon premier — qui se dérobait hors de la battue. J’étais posté moi-même en potence de la traque, avec une grande bise me poussant aux épaules. Il m’est venu sournoisement, en coulant sous la ronce au fond d’un vieux fossé. Manifestement, il ne pouvait pas ne pas m’apercevoir, et les bouffées du vent lui portaient mon sentiment, il me surveillait, et ce n’est qu’à l’instant où nos yeux se furent croisés qu’il se détendit d’une foulée souple, trop tard. Ce jour-là, il faisait un clair soleil, froid et vif, ses rayons dorés jouaient sur la robe fauve, sur les dernières feuilles accrochées aux ronciers, sur la jonchée de cuivre couvrant le sol d’un tapis de piécettes gelées. Ce renard, un grand vieux qui savait plus d’un tour, avait-il pensé se fondre, invisible, parmi ce camaïeu d’or roux ? ... Et même j’ai vu mieux avec un chacal, cette horrible bête qui n’est que ruse, méfiance et fourberie. Au Djebel bou Zegra, au poste du lundi de Pâques. Devant moi, une abrupte coulée de grosses roches moussues, encombrée des bois morts descendus par les grandes pluies d’hiver, s’enfonçait sous une voûte de chênes-lièges entre deux murailles de hautes bruyères blanches. Le flanc du mont dégringolait sous l’épaisse fourrure des cistes, des arbousiers et des lentisques. Très loin, au fond du ravin, j’entendais l’Oued Gountas, gorgé d’eau, gronder en écumant parmi les lauriers-roses, sur les cailloux roulés. Un poste magnifique, n’eût été une diablesse de brise printanière qui tombait des crêtes et descendait doucement vers moi, portant avec elle le baume du maquis en fleurs. Sur ma droite, le hurlement des Arabes s’envola, le rabat commençait. J’entendis une chasse se former, la belle gorge de Flambeau sonnait la vue, le cochon poussé raide vint casser du bois en dessous de mon poste, je devinai qu’il grimpait la ravine, j’attendais, la crosse presque à l’épaule, et puis plus rien ... Les chiens aussi montèrent leur menée jusque-là, firent demi-tour, et la chasse fila par les fonds vers Angoulmane ou le Zebboudj. Décidément, mauvais vent ... Après quoi je ne sus plus rien, ni des hommes ni des chiens, les voix s’étaient éteintes, mangées par la profondeur des ravins et l’épaisseur des bois. La forêt retombait au silence. J’attendis longtemps. De loin, je devinai qu’un petit animal bougeait dans la coulée. Il se précisa : un raton, cet être hybride entre la fouine et le blaireau ; il avançait à travers les roches, la croupe balancée d’une démarche onduleuse. Lui aussi s’arrêta, intrigué, l’arrière-train assis sur ses longues jambes, le torse droit, la tête haute. Il ne pouvait me voir, masqué que j’étais dans une cépée de chênes verts. Ses petits yeux rouges scrutaient le mystère, cherchaient à trouver l’homme dont la brise lui charriait le relent. Sa prudence l’emporta, il se laissa doucement retomber sur son avant, s’aplatit, coula derrière une roche et disparut. Imbécile, va ! comme si j’allais risquer de gâcher mon poste pour un raton ! Le temps me durait ; pour qui sait qu’il ne lui viendra rien, c’est interminable ces battues qui prennent tout un flanc de montagne. Après un long temps, dans les fonds, je vis remuer des cimes d’arbres : une forte bande de singes remontait vers moi, elle avançait dans les houppiers des chênes en cueillant la glandée. Cela venait, bientôt j’en aurais à tir. Un grand macaque, le vieux mâle sans doute, allait devant. À cent pas, je le vis se balancer à bout de bras et se lancer d’un bond jusqu’à l’arbre suivant. Là, il eut un sursaut et s’immobilisa, la figure tendue, essayant vainement de me découvrir. Derrière lui sa tribu s’était tue, plus rien ne bougeait. Le vieux épiait en grattant longuement ses fesses laquées de rouge, puis, fixé sur cette odeur qu’il avait saisie, il se gonfla le torse, le battit de ses mains comme un tambour, éructa une sorte de crachement de dégoût à mon adresse, glapit un bref commandement, et tout s’enfuit en piaillant. Décidément, aujourd’hui, je ne tirerais rien. Je quittai la place un instant et fis une courte retraite dans un buisson au-dessus de mon poste pour « une lamentable raison » (je m’excuse de piller ce mot dans les sages conseils de Jean de Witt aux chasseurs en Brière, de moi-même je n’aurai su trouver un terme aussi décent). À peine avais-je rejoint mon affût que le chacal arrive. Il montait la ravine silencieusement, de son allure de loup, le panache serré entre les jambes, oreilles à l’écoute, nez au vent, humant la brise, une babine retroussée découvrant ses dents mauvaises. Bien loin encore pour tirer ! ... et ces diables de bouffées printanières qui descendaient des crêtes devaient lui porter tout ensemble les senteurs de la montagne et le souffle du buisson. Pourtant il est venu à vingt pas, il est entré dans la mort sans même savoir qu’elle était là, lui qui était toute défiance, traîtrise et fausseté. Le parfum des bruyères fleuries aura-t-il tout couvert, ou tout simplement traînait-il un rhume de cerveau ? Cela doit arriver aux chacals comme à nous autres. En tout cas, malgré de stupéfiantes exceptions, il faudrait jouer à l’original pour discuter le flair du grand gibier. Albert GANEVAL. |
|
|
Le Chasseur Français N°614 Juin 1947 Page 469 |
|
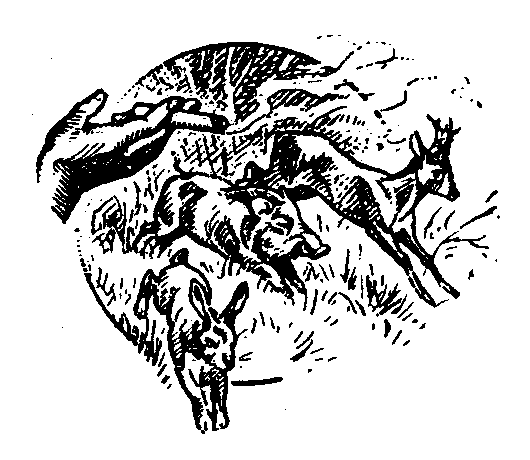 J’ai souvenir qu’avant guerre les tramways de
Marseille arboraient cette réclame de la Régie. J’espère que la simple pudeur
lui aura fait retirer son affiche, maintenant que le Monopole nous a fait à peu
près « passer le goût du tabac ». Cette amusante publicité des temps
heureux n’aurait plus, de nos jours, qu’une saveur amère. À présent, dans les
belles chasses bien agencées, le garde n’a plus besoin de clouer sur un
baliveau, à côté du « bon poste », la pancarte fatidique : « Défense
de fumer. »
J’ai souvenir qu’avant guerre les tramways de
Marseille arboraient cette réclame de la Régie. J’espère que la simple pudeur
lui aura fait retirer son affiche, maintenant que le Monopole nous a fait à peu
près « passer le goût du tabac ». Cette amusante publicité des temps
heureux n’aurait plus, de nos jours, qu’une saveur amère. À présent, dans les
belles chasses bien agencées, le garde n’a plus besoin de clouer sur un
baliveau, à côté du « bon poste », la pancarte fatidique : « Défense
de fumer. »