| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°615 Août 1947 > Page 517 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Encore une histoire … |

|
|
— Une histoire, une histoire ! Va donc jouer, mon petit, va ; ou bien apprends tes leçons. Je suis fatigué, ce soir. — Mais une histoire de chasse, grand-père. — Oh ! alors, si c’est une histoire de chasse ! C’est si beau, la chasse, vois-tu. Tu seras chasseur, toi aussi, pas vrai ? Tu seras chasseur, comme mon grand-père à moi, comme mon père, comme moi, comme ton papa, hein ! petit ? — Oh oui ! grand-père. — Très bien, mon petit. Tu verras, oui, comme c’est beau, la chasse, et intéressant, et instructif. Que de choses elle t’apprendra que tu ne trouveras pas dans tes livres de classe ! Tu reconnaîtras, sans te tromper, un chêne d’un érable, un ormeau d’un hêtre, un pin d’un sapin ; tu ne confondras pas l’orge et le blé, le seigle et l’avoine ; et, devant un beau champ de trèfle où rappellent les perdrix, tu ne diras pas que c’est une luzerne. Et, quand tu verras passer un oiseau, tu sauras dire : Tiens, voilà un geai, ou un étourneau, ou un pivert, ou une alouette, ou un pinson. Savent-ils tout cela ceux qui ne vont pas à la chasse, et surtout les gens des villes ? Et puis tu verras de belles aurores et des couchers de soleil merveilleux ; la lumière qui se joue dans les arbres, l’ombre mauve des sous-bois mystérieux, la douce clarté brumeuse ou ensoleillée des étangs au-dessus desquels évoluent les volées de canards et où glissent les flottilles de sarcelles, avec, par-ci par-là, quelque foulque farouche qui, le cou tendu, se sauve à la nage, ou un grand héron perché, en bordure, sur une patte, à l’affût de quelque poisson. C’est à la chasse que tu apprendras et verras tout cela. Car, à l’école, on t’apprendra beaucoup de choses ; beaucoup de choses que tu oublieras ensuite, parce que la plupart ne servent pas dans la vie. Mais la chasse est une autre école, une école merveilleuse, comme tu verras, et pratique. Une école saine, aussi. Car tu apprendras à sortir par tous les temps ; tu ne craindras ni le froid, ni la canicule, ni le vent, ni le brouillard ; tu respireras à pleins poumons, tes jambes seront entraînées, et tu feras des kilomètres et des kilomètres sans t’en apercevoir, à travers champs, à travers bois, à travers la pierraille des coteaux et des garrigues. Et, le soir, quand tu rentreras, un peu fourbu peut-être, comme tu te trouveras bien devant ta bonne soupe, puis dans ton fauteuil et tes pantoufles ! Enfin, quand tu te seras glissé dans ton lit, alors tu reverras les coups heureux ou manqués de la journée et tu t’endormiras dans des bruits de battements d’ailes ou avec la vision d’un grand capucin qui fait la cabriole. Tu chasseras donc, hein ! mon petit ? — Oui, grand-père. Et avec un fusil comme le vôtre, là, pendu au-dessus de la cheminée. — Un fusil comme le mien ! Eh ! non, mon petit, eh ! non. Il n’est plus à la mode, mon vieux fusil. Tu en auras un autre plus beau, sans chiens, plus commode et qui tirera loin des charges sans fumée. Tiens, regarde-le tout de même, le mien. Vois cette jolie crosse avec cette belle tête de sanglier ciselée dans le bois ; le canon est un peu long, bien sûr, et les chiens un peu encombrants. Ah ! il en a tué tout de même du gibier pendant ses cinquante ans de bons et loyaux services ! Des centaines de perdreaux, des milliers de cailles, et des lièvres, et des lapins, dont je regrette de ne pas avoir tenu le compte ; des canards, des palombes, des bécasses ; de vilaines bêtes aussi : pies, rapaces, renards ; et des sangliers, et même, une fois, un loup, mon petit, oui, un loup. — Oh ! un loup, grand-père ? Racontez-moi donc l’histoire du loup. — Ah ! il y a bien longtemps de cela, mon petit, bien longtemps. Car des loups, dans notre pays, il y a belle lurette qu’il n’y en a plus. Et, ma foi, ce n’est pas une bête que l’on regrette. Je ne te dirai pas en quelle année se passa l’affaire ; mais je te dirai seulement que je n’avais pas, à ce moment-là, de cheveux blancs et que j’avais des jambes qui ne connaissaient pas la fatigue. C’était vers la fin de novembre. Il avait neigé un peu quelques jours plus tôt et il en restait encore des traces dans les creux à l’ombre. Il y avait encore quelques bécasses dans le bois de la Combe, où elles s’arrêtent chaque année deux ou trois semaines ; il s’y trouve des coins de taillis humides et bourbeux qui les retiennent, car elles y ont pitance à discrétion. Mais vienne un coup de froid, et les voilà parties. J’en avais une dans mon carnier, la seule levée, et je rentrais pour dîner quand des cris m’attirèrent du côté de la ferme des Venettes, tu sais, là où tu vas, l’été, ramasser fraises des bois et airelles. Tout le monde était en grand émoi. Un loup venait d’enlever un agneau dans la pâture bordant le bois ; la petite bergère qui gardait les quelques brebis du fermier, qui était, alors, le grand César, en tremblait encore de peur. Mais la bête, effrayée peut-être par les cris des gens et les aboiements des chiens, avait abandonné sa victime non loin de là. On laissa celle-ci sur place ; peut-être le loup, si loup il y avait, reviendrait-il la chercher la nuit venue. Je me hâtai de rentrer et de dîner, pris deux cartouches chargées chacune d’une douzaine de chevrotines, car c’est plus sûr que la balle pour le tir de nuit, et allai me poster dans un petit taillis, à quelques mètres de l’agneau. Enfoncé dans ma pelisse, j’attendis venir la nuit, bien décidé à rester à mon poste aussi longtemps qu’il le faudrait. Bientôt, il n’y eut plus une âme dans les champs. Tout le monde était rentré, et la soupe devait fumer sur les tables. Pas un brin de vent et un ciel déjà noir et plein d’étoiles qui, une à une, s’éclairaient comme des lucioles, et un croissant de lune, mince et brillant comme une faucille. Les pies, les merles, les geais, tous les oiseaux avaient gagné le bois. Le chat-huant, avant de commencer sa randonnée de nuit, poussait son cri monotone et triste ; un instant, un bruissement de feuilles mortes se fit entendre derrière moi ; c’était une belette qui, souple et mince, se faufilait dans une coulée ; une sale bête que je regrettai bien de laisser filer. Le loup viendrait-il ? Je n’osais y croire ; pourtant, j’avais bien reconnu son long pied léger sur le sentier de bordure. Ce ne pouvait pas être autre chose qu’un loup. J’entendis sonner huit coups au clocher de Saint-Amand. Les heures, par deux fois, s’égrenèrent lentement dans la nuit, m’arrivant par-dessus les terres et les grandes brandes de chez Tillon. Si tu savais comme on est bien, ainsi, en pleine nature, seul pour jouir de ce grand silence qui donne un peu une idée de l’immensité et de l’infini où nous sommes plongés ! On resterait là, immobile, silencieux, dans une béatitude indéfinissable, des heures et des heures, sans s’apercevoir du temps qui s’écoule. Tu goûteras ce charme toi aussi, mon petit, les soirs d’affût, quand tu iras faire la passée aux canards ou attendre la bécasse au coin d’un bois. — Et le loup, grand-père ? — Eh bien ! le loup ne tarda pas à venir. J’entendis son frôlement dans le taillis, avant même de le voir. Un pas à peine perceptible sur les feuilles mortes, qui s’arrêtait de temps à autre, car il se méfiait, l’animal ! Il mit bien dix bonnes minutes à s’approcher. Je ne respirais plus. Un moment, je crus qu’il m’avait éventé et avait fait demi-tour. Mais, soudain, entre deux baliveaux, apparut son ombre noire qui glissait lentement. Je ne le voyais pas encore assez pour le tirer. Enfin, ses deux yeux brillèrent comme des étincelles ; il était à deux pas de l’agneau. Il s’étira, souple, comme hésitant, puis, d’un bond, fut sur le cadavre. Je levai mon fusil et lui envoyai son compte de ferraille. Il poussa un hurlement rauque et se débattit quelques secondes sur le flanc, puis ne bougea plus. » C’était une grande louve qui allaitait, à l’échine à demi pelée, et que l’on vint chercher le lendemain matin. On ne put jamais trouver sa portée, qui dut crever dans sa tanière, Dieu sait où. » Tu n’auras pas l’occasion, toi, d’avoir un loup au bout de ton fusil. Mais que saint Hubert, notre grand patron, te prenne en amitié et y mette beaucoup de lièvres, de perdrix et autres bestioles qui semblent, hélas ! diminuer de jour en jour. » Et maintenant, si tu veux, je te prends demain matin aux alouettes : tu tireras la ficelle du miroir. » FRIMAIRE. |
|
|
Le Chasseur Français N°615 Août 1947 Page 517 |
|
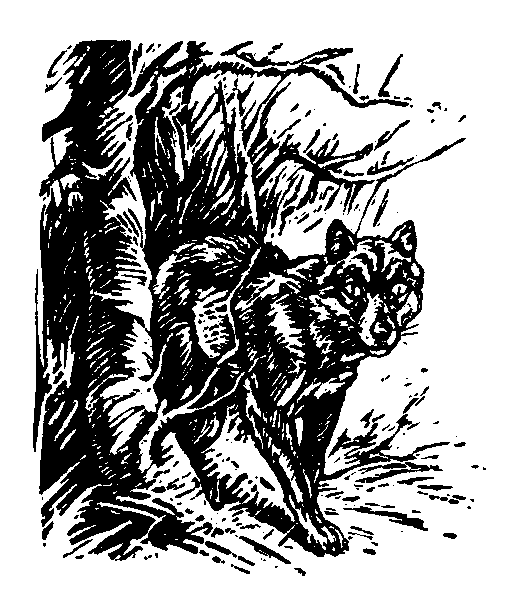 — Encore une histoire, dis, grand-père.
— Encore une histoire, dis, grand-père.