| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°616 Octobre 1947 > Page 570 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Les « Panthères » du Valais |

|
|
Ces bêtes se sont manifestées en Suisse, dans les cantons les plus riches en grandes forêts, en égorgeant un nombre considérable de moutons. Certaines seraient allées se cantonner dans les « Freiberge », ces réserves de chasse soigneusement entretenues par nos voisins, et y feraient de grands dégâts. Les meilleurs chasseurs de Suisse — et certes il ne manque pas de grands maîtres dans les Grisons, le Valais et l’Oberland — les ont traquées sans jamais les dépister. Au début d’avril, un communiqué triomphal a bien annoncé la mort d’un monstre sanguinaire, « issu du croisement d’un loup et d’une chienne Saint-Bernard » (?), mais, le lendemain, dans la commune même où l’animal avait été abattu, un nombre imposant de moutons passèrent de vie à trépas ... Le problème reste donc entier. En l’hiver 1947, les « panthères » ont passé de Suisse en Haute-Savoie — certaines d’entre elles, tout au moins. Les possesseurs de troupeaux de moutons sont inquiets pour l’été qui vient, tant pour les dégâts réels que pourraient faire les fauves que pour l’alibi commode que leur présence pourra apporter aux vides creusés — sans tickets — dans les troupeaux, au cours de la saison de tourisme. Messieurs les chasseurs, eux, sont dans la jubilation ! Un vieil ami m’écrit, de quelque part près de la frontière : « J’ai trouvé les traces, un jour, avec André. Il y avait 25 centimètres de neige, gelée à la surface. En skis, la croûte nous portait, mais la bête, en courant, l’avait enfoncée. Elle doit être d’un bon poids. Des sauts de deux mètres, sans traces intermédiaires, les pattes d’un chat qui serait de la grosseur d’un gros chien. Les crottes de la grosseur du poing. La bête avait séjourné dans une tanière, ça sentait la ménagerie à dix mètres. Mon frère a trouvé un chevreuil, sur le chemin des gorges, les os du cou sectionnés verticalement : du beau travail. Quand j’y suis allé, la carcasse avait disparu ... » Et une seconde lettre m’annonce : « J’ai suivi à plusieurs reprises les traces de la « panthère ». Pas de queue balayant la neige, comme un loup ou un renard. Ce sont sûrement de vulgaires lynx. Ils sont trois, et, si ça peuple, ça va faire du sport. » J’adore l’expression « de vulgaires lynx ». Sacré vieux ! Il semble que tu en voies passer tous les jours devant ta porte ! Mais je sais bien que, le soir, les pieds dans les pantoufles, tu as compté et recompté tes cartouches, et passé la baguette dans le canon de ta carabine jusqu’à ce que les rayures luisent comme un vrai miroir ! Il y a en effet du lynx dans nos Alpes, bien qu’il soit très rare en France, et les fameuses « panthères » sont plus que probablement des lynx, mis en mouvement par la guerre et venus des forêts de Galicie ou du Tyrol autrichien. L’importance des massacres de moutons constatés en une seule nuit semble bien prouver que c’est le lynx qui a opéré. Périodiquement, les publications alpines signalent quelques couples de lynx isolés dans le Vercors et dans le Queyras. Jusqu’à cette année-ci, on n’en avait point vu en Haute-Savoie, le dernier ayant été tué en 1871 à l’Aiguillette des Houches, dans la vallée de Chamonix. J’ai été présent à la mort d’un lynx, il y a déjà pas mal d’années, dans la région d’Albertville. Depuis quelques semaines, les bergers de la montagne du Grand-Arc accusaient des pertes répétées d’agneaux et de moutons, et les bûcherons de la forêt de Rhonne, qui domine le confluent de l’Isère et de l’Arly, avaient entendu la nuit des cris singuliers. Le garde général des Eaux et Forêts, M. Touchard, avait tout de suite pensé au lynx et, connaissant ma passion pour la chasse, m’avait promis de ne pas partir sans moi. Un soir, il reçut des avis plus précis, et, bien avant le jour, nous grimpions les couloirs de descente des bois, tout droit, pour arriver le plus tôt possible au sommet des forêts. Mille mètres d’ascension dans les sapins, pour émerger à la jonction des alpages et des grands bois. Mais là, malgré le concours du berger qui prétendait avoir vu la bête la veille, nous passâmes toute la matinée à explorer en vain les broussailles. Mes deux compagnons avaient leur fusil et des chevrotines, et, pour mon compte, j’avais emporté à tout hasard le revolver d’ordonnance du garde général. À midi, nous déjeunions à l’ombre, complètement découragés, lorsque, à vingt pas de là, une branche se mit à bouger dans un grand sapin. « ... Un écureuil ! » Tous trois, nous avions levé la tête ; près de la fourche d’une grosse branche, une bête était allongée, collée au bois, nous regardant de sa face ronde aux oreilles pointues et aux yeux immenses. Touchard fit feu ... et le lynx tomba comme un sac. C’était bien un lynx, un animal assez jeune : 1m,10 de long environ sans la queue, 0m,60 à l’épaule. Un lynx gris tacheté de gris plus foncé, avec ses houppes de poils au bout des oreilles, ses dents formidables et, chose qui nous frappa plus que tout, une musculature des épaules et des avant-bras d’une puissance disproportionnée avec sa taille, une bête où tout annonçait la force brutale, la rage et la cruauté. Très fier, je pris l’animal sur mon dos. Nous voulions le faire empailler, pour en faire don au musée de Chambéry. Mais il était dit que jamais notre lynx ne finirait ainsi. Comme nous étions à mi-chemin de la descente, deux coups de canon roulèrent dans la vallée, suivis d’une brève sonnerie de clairon. C’était le 2 août 1914 ... En passant au chalet, le berger posa son fusil, embrassa sa femme et ses deux enfants, but un coup et ressortit. Le lynx était resté sur la table, devant la porte. À fond de train, faisant rouler les cailloux du talon, nous descendions les couloirs à la course, jusqu’au pont de Tours. Partout la montagne s’animait, les montagnards plantaient leur bêche au bout de leur champ, remettaient leur veste et couraient s’équiper à la caserne des Alpins ; Albertville n’était plus qu’une foule en mouvement, où se confondaient les vestes brunes des paysans, les robes blanches des Trappistes de Tamié et les vareuses bleues des chasseurs. Le garde me serra la main et entra au quartier. Un mois après, dans les Vosges, il était tué, écrasé par un obus, à la tête de sa section de mitrailleuses. Huit ans plus tard, je suis remonté dans la forêt. Au chalet où nous avions laissé la bête, une femme d’une quarantaine d’années me reçut, la veuve du berger resté à l’Hartmannswillerkopf. Elle se souvenait fort bien de moi et de « ce pauvre M. Touchard ». Maintenant elle était seule. Sa fille, l’aînée, était placée à la ville, et son garçon était petit berger, à trois jours de là, chez un oncle. Ce fut elle qui, la première, me parla du lynx. — La bête, oui, les enfants s’en sont amusés un moment. Et puis le chien hurlait toute la nuit, et elle sentait bien mauvais. Au bout de quelques jours, je suis allée la jeter dans le bois, au fond d’un trou. — Et vous n’en avez pas vu d’autres ? — Que si, il y en avait un tout pareil, plus gros. Mais, voyez-vous, avec la guerre, les hommes étaient partis, les troupeaux étaient descendus ; un beau jour, il est parti. Et ce n’est pas moi qui en ai eu du regret : avec les enfants tout petits, je n’étais pas tranquille. Si j’étais tant soit peu superstitieux, je m’abstiendrais cette année d’aller courir après les « panthères », pour ne pas risquer de déclencher la troisième guerre mondiale. Mais, comme la mobilisation de 1939 m’a surpris taquinant la truite dans l’Ardèche, il me faudrait alors renoncer aussi à la pêche en plus de la chasse ! J’aime mieux me répéter, comme mon ami le Savoyard : « Si ça peuple, ça va faire du sport ! » Le pauvre garçon ! Je sais bien que, tous les soirs, avant de s’endormir, il rêve de la « panthère » qu’il va rencontrer un jour au coin d’un bois. Je le sais, parce que, depuis que j’ai reçu ses lettres, il m’arrive d’en rêver aussi. Il paraît — je dis il paraît, car, quand je dors, c’est pour de bon — que certaines nuits je me démène, que je rampe à l’affût, embusqué derrière un oreiller, pour me ruer ensuite à la poursuite du fauve, si bien que ma femme m’a déjà menacé de faire chambre à part ... C’est toujours le même rêve : nous trottons, mon ami et moi, comme deux Peaux-Rouges sur la piste de guerre. À chaque pas, les coqs de bruyère s’envolent se percher sur les sapins, les chamois mettent la tête à la fenêtre derrière les rochers pour nous regarder, mais nous passons sans les voir. Nous suivons les traces de la « panthère » sur les plaques de neige et la terre humide du sentier. Indiscutablement, ça sent le fauve dans le sous-bois. Du fond d’une caverne, la « panthère » bondit. Pas d’erreur, c’est bien une panthère, un jaguar, un léopard ... Deux coups de feu, et nous voilà courant sur la piste où les pierres sont rouges de sang. Le fauve est monté dans un arbre ... deux coups de feu, il dégringole. C’est un lynx ! À nouveau, nous reprenons la poursuite. La bête se couche et nous regarde ... ce n’est plus un lynx, c’est le fameux « croisement de loup et de Saint-Bernard » qui nous regarde d’un air de reproche en battant de la queue ... Je mets en joue. Mon compagnon m’arrête :
Là-dessus, je m’éveille, plus ou moins entortillé dans mes draps, et d’une humeur de dogue. Mais moi aussi, avant que la journée soit finie, j’irai graisser ma carabine, l’essuyer, la mettre en joue, viser le plafond et la raccrocher à son clou. Et, sans vouloir faire le prophète, je sais qu’un de ces jours le facteur m’apportera un mot de mon vieux copain, m’annonçant la mort du lynx. Car c’est un lynx, il n’y a plus à en douter : j’ai reçu ces jours-ci une pincée de poils que je suis allé comparer, au Musée d’Histoire naturelle, avec la fourrure de toutes les bêtes d’Europe, et aucun doute n’est permis. « ... Quelques poils que j’ai trouvés sur la piste. Il mue, le pauvre, pourvu qu’il ne s’enrhume pas ! » Mon pauvre vieux, tu es aussi toqué que moi quand il s’agit de chasse, et tout le monde est d’accord que ce n’est pas peu dire ! Pierre MÉLON. |
|
|
Le Chasseur Français N°616 Octobre 1947 Page 570 |
|
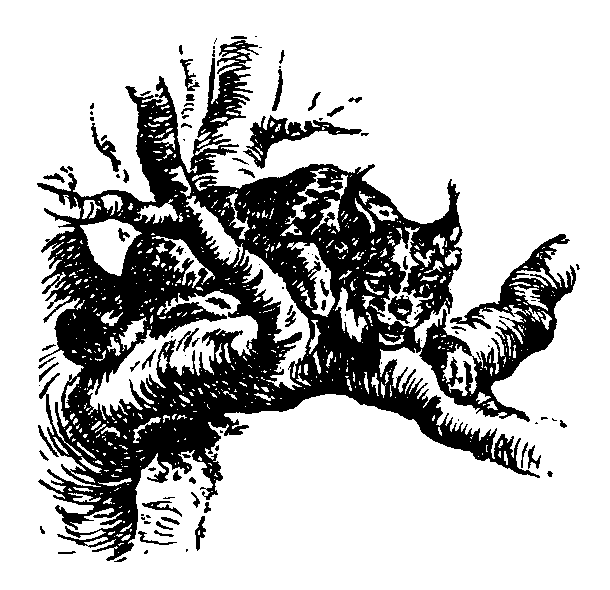 Depuis un an, il n’est question dans les Alpes que
d’animaux féroces, que personne n’a vus et que tout le monde connaît. Sur leur
origine, personne n’est d’accord ; l’histoire la plus romanesque parmi
toutes celles qui ont cours parle de bêtes fauves échappées d’une ménagerie qui
voyageait dans un train bombardé en 1945 dans la région du Brenner. Comme si
les Allemands, détalant d’Italie, n’avaient pas eu mieux à faire que de perdre
leur temps à déménager des bêtes curieuses ! D’autres origines tout aussi
fabuleuses ont été évoquées. Le plus simple serait assurément d’avouer qu’on ne
sait pas d’où sortent les « panthères ».
Depuis un an, il n’est question dans les Alpes que
d’animaux féroces, que personne n’a vus et que tout le monde connaît. Sur leur
origine, personne n’est d’accord ; l’histoire la plus romanesque parmi
toutes celles qui ont cours parle de bêtes fauves échappées d’une ménagerie qui
voyageait dans un train bombardé en 1945 dans la région du Brenner. Comme si
les Allemands, détalant d’Italie, n’avaient pas eu mieux à faire que de perdre
leur temps à déménager des bêtes curieuses ! D’autres origines tout aussi
fabuleuses ont été évoquées. Le plus simple serait assurément d’avouer qu’on ne
sait pas d’où sortent les « panthères ».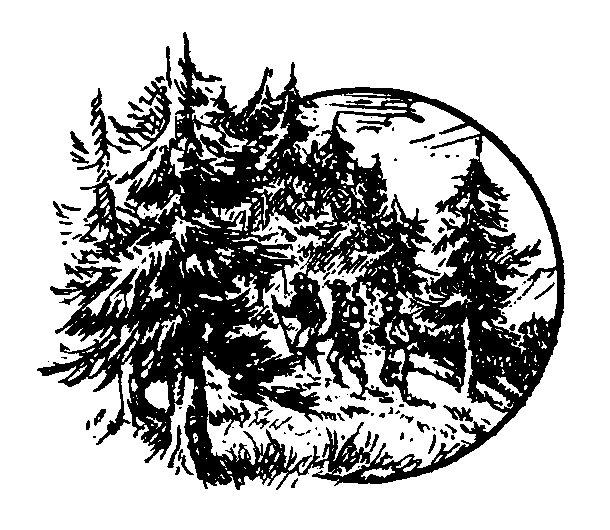 — Écoute, Pierre, un coup de plus, et il va se mettre à aboyer et ce sera
un fox-terrier.
— Écoute, Pierre, un coup de plus, et il va se mettre à aboyer et ce sera
un fox-terrier.