| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°617 Décembre 1947 > Page 651 | Tous droits réservés |
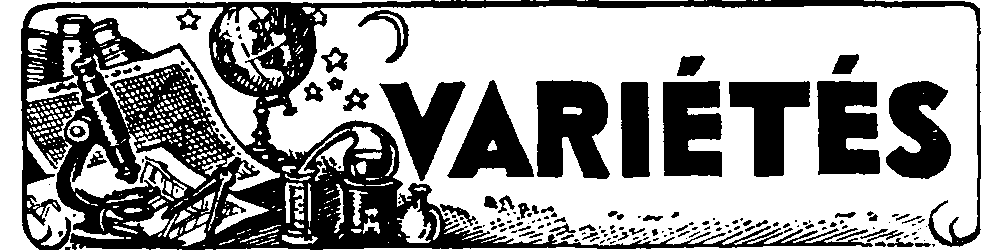
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Le Kurdistan, pays ignoré

|
Autour du lac de Van |

|
|
En voyage de prospection, à la veille de la guerre de 1939, pour des achats de laine brute, l’auteur du récit qui va suivre a réussi, après maintes difficultés, à pénétrer au pays des Kurdes, contrée assez fermée, encore mal soumise à la domination turque. Le voici arrivé dans la région du lac de Van, explorant un village peuplé de bergers primitifs. ... On nous a aperçus. Le vieux Reïs (1) arrive à notre rencontre. Un pur entre les purs ... Il se réveillerait sans anachronisme au XVIIe siècle. Quel arsenal se case dans sa large ceinture amarante ! De sa calotte s’échappe une blanche chevelure longue, et son doux visage de patriarche sourit, tandis que ses yeux bleus rayonnent d’azur. Nous échangeons à deux mètres, grâce à Setke, l’interprète, de rituelles salutations, puis nos mains se serrent, et j’offre la cigarette d’usage. À ma stupeur, le vieux refuse que je la lui allume : va-t-il se la mettre à l’oreille, « en réserve », comme un vulgaire garçon coiffeur ? Non : sa main droite la tourne et la retourne amoureusement, et sa main gauche, qui a plongé dans la ceinture-tiroir, en sort ... Une loupe. Une loupe du milieu du siècle dernier, cerclée d’argent fiorituré, et dont la lentille a tant traîné dans des poches ou ailleurs, s’est tant rayée qu’elle semble dépolie. Voilà de quoi notre Reïs tire du feu, quand il y a du soleil. Cet instrument « ultra-moderne » doit rehausser son prestige aux yeux des siens. Il ne sert évidemment que l’été, quoiqu’il serait plus de circonstance l’hiver, mais n’est-ce pas déjà bien beau de détenir, ne fût-ce que quelques mois, en son pouvoir les rayons solaires ? Voici la cigarette en ignition et collée aux vénérables lèvres sous l’abondante moustache. Deux ou trois aspirations en coup de pompe l’activent. Enchanté, notre hôte nous entraîne à l’ombre d’un noyer, moins grand que ceux de la crique, beau quand même, et dépêche un gamin quérir des abricots dans un verger. La saveur de ces fruits pris à l’arbre en cette heure bouillante se décuple. Le jus tiède embaume la langue et paraît plus sucré, plus vivant. Tout en nous régalant, nous observons les scènes ménagères des logis proches ; Setke obtient du Reïs qu’il nous présente aux familles. Nous nous y rendons, escortés du porteur d’abricots. Une affluence de fileuses est apparue sur les toitures plates en terrasse. La curiosité de nous inspecter est pour beaucoup dans cette soudaine extériorisation d’activité. Comme il n’existe pas d’escaliers, ces femmes ont gagné leurs toits par l’arrière, du côté où les constructions s’adossent à la montagne. On arrive là-haut de plain-pied aussi facilement qu’en bas on entre par la porte. C’est en bas que nous sommes introduits. Nous devons nous courber jusqu’à terre pour franchir derrière le Reïs les ouvertures surbaissées.
De ce foyer provient quelque lumière, mais surtout de la fumée. Il est creusé au centre de la pièce, et, pour que le tirage s’effectue, un trou d’aération est foré de biais vers son fond. Par ailleurs, une cheminée perce le toit juste à l’aplomb : je ne sais si elle évacue beaucoup des gaz de combustion ; en tout cas, elle compose avec la porte le seul système d’éclairage ... Il en tombe, au moment de notre visite, une colonne de soleil presque verticale, qui ne dispense aucune clarté. Elle éblouit lorsqu’on y fixe ses prunelles, et on n’y voit plus rien dès qu’on les en a retirées ... Nous allons de place en place avec une religieuse curiosité. Dans cette maison, l’aïeule prépare un brouet de pois. Elle tire les graines de hauts réservoirs de poterie, décorés de motifs patauds : des mains moulées en surépaisseur. Une anfractuosité de la paroi contient deux couches d’enfant en bois et paille : je pense à la crèche de Bethléem, elle devait être aussi simple et touchante. Plus loin, les lits des parents, baquets grossiers. Aux murs sont accotés des instruments, pas mieux mais aussi utilement forgés qu’à l’âge du fer. Des liens confectionnés d’herbes sèches pendent à des clous. Il y a un maigre vestiaire de lainages, où trois ou quatre couleurs survivent dans la crasse. Le moindre contact noircit : la fumée imprègne tout. Certes, cette existence se répète depuis plus de générations qu’elle ne se poursuivra ... Le progrès, monstre vorace, est déjà là qui cogne aux portes. Il n’a pas encore ici apporté les casquettes. Mais je le vois briller, insultant, ostentateur, dans les dents d’or que découvre le sourire du vieux Reïs ! Ce n’est pas là la marque d’un seigneur kurde : le bonhomme a dû livrer sa mâchoire à quelque charlatan de Bitlis, à l’occasion d’un voyage en char à la ville. Peut-être ne souffrait-il point, et fut-ce sa coquetterie, adroitement stimulée, qui le détermina ? C’est dans la bouche qu’on est allé lui mettre la saveur dudit progrès … Ne dramatisons rien. Bien de la couleur reste sauve en ce perchoir. Les femmes, abondamment juponnantes, aux corsages bouffants, nous entourent de chatoyantes soieries. Elles s’apprivoisent très vite. Les plus infimes détails du costume de ma compagne se gravent à tout jamais dans leur mémoire. Un semblant de conversation générale s’établit. Nous parlons de l’hiver, de la vie confinée dans les noirs réduits, chauffés par la provision de bois sec et la tiédeur animale qui arrive des écuries contiguës. Cette claustration dure sept à huit mois. Il n’y a qu’en cas de déplacements indispensables que l’on sort les traîneaux. Ils sont là, ces attelages des jours rudes, abandonnés au soleil en attendant la neige. Il faut savoir leur usage pour le comprendre : de prime abord, on dirait une pile de rondins à brûler montés sur tirette ! À les examiner avec soin, on y reconnaît les pièces essentielles, suffisamment assemblées et articulées, d’un bon véhicule hivernal. Étant sur le chapitre de la locomotion, le Reïs et les jeunes veulent voir notre voiture. Ils nous y ramènent fort opportunément, car l’heure a tourné. Faisant cercle, touchant d’un doigt méfiant qui un pneu, qui un nickel, ils nous regardent nous réinstaller. Naturellement, notre chauffeur y va de sa note musicale et l’admiration fige les visages … Avant de nous laisser repartir, le vieillard nous prie d’avancer de cent mètres pour nous montrer « quelque chose ». Je lui avais parlé des malheurs de ces régions éprouvées, et, en tête lente, il n’avait rien répondu sur le moment. « Voyez, dit-il à présent, ce grand cimetière où ne reposent point les nôtres : ce sont des tombes de Russes, après une grande bataille. » Les stèles sont, en effet, gravées en russe. Elles marquent les restes d’une des nombreuses incursions : sous le prétexte de protéger les Arméniens, les soldats du tsar fondaient volontiers du Caucase sur Van. Il en dort là quelques centaines. Mais où sont donc les tombes des Arméniens qu’ils venaient sauver, et qui eux aussi sont morts, pourtant ? François BALSAN.(1) Le chef du village. |
|
|
Le Chasseur Français N°617 Décembre 1947 Page 651 |
|
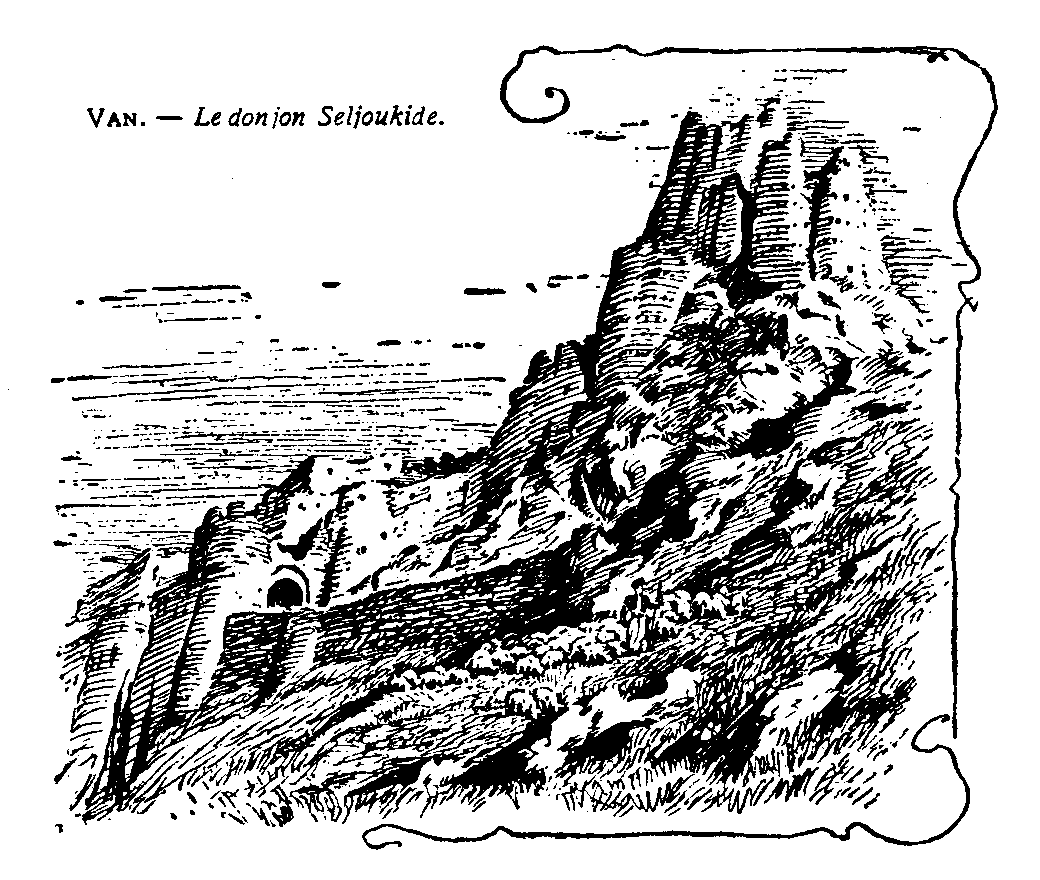 Chaque logis comporte une unique pièce. L’obscurité
commence par aveugler, la fumée prend à la gorge et aux narines. Et puis, au
fur et à mesure que les yeux s’accoutument, que les détails sortent de l’ombre,
une indicible émotion nous envahit. Nous sommes, en effet, dans l’une des plus
anciennes cellules vitales et familiales du monde ... Rien n’y a changé
depuis un millénaire peut-être. La puissance de la coutume sacrée, de la
tradition de père en fils, se lit dans le regard résigné et doux de la vieille
femme qui vaque aux occupations du foyer.
Chaque logis comporte une unique pièce. L’obscurité
commence par aveugler, la fumée prend à la gorge et aux narines. Et puis, au
fur et à mesure que les yeux s’accoutument, que les détails sortent de l’ombre,
une indicible émotion nous envahit. Nous sommes, en effet, dans l’une des plus
anciennes cellules vitales et familiales du monde ... Rien n’y a changé
depuis un millénaire peut-être. La puissance de la coutume sacrée, de la
tradition de père en fils, se lit dans le regard résigné et doux de la vieille
femme qui vaque aux occupations du foyer.