| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°620 Juin 1948 > Page 101 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
En Australie

|
Chasseurs de buffles |

|
|
Rude, dangereuse, sans confort, solitaire, mais passionnante et pouvant rapporter gros, voilà la vie dans les Territoires du Nord australien pour les chasseurs de buffles, seul pays où ces animaux sont exterminés pour leur peau — buffles d’eau de Malaisie et non caribous ou bisons d’Amérique. À peine plus qu’un nom sur une carte, telle est Marrakai, primitive et isolée, l’un des centres d’opérations des chasseurs de buffles. Dans cette région, d’ailleurs, peu d’agglomérations sont proches les unes des autres ; les hommes blancs sont dispersés à raison d’un par 256 kilomètres carrés, si l’on en calcule la moyenne. De Darwin, port coloré des tropiques, à 110 kilomètres plus bas, l’une des grandes voies jalonnant les Territoires vous mène au fleuve Adélaïde et au premier hôtel ; là vous trouvez un poste de police, deux fermes, une ou deux habitations et quelques constructions de guerre abandonnées et tombant en ruines. Puis vous parcourez environ 65 kilomètres au Nord-Est par un sentier serpentant à travers les plaines basses parsemées d’ossements. Quelques taillis et peu d’arbres ; des marécages et des mares à buffles, et des centaines de milliers de nids de fourmis, hauts de 1m,80 et davantage, parfois 6 mètres ... Car c’est ainsi que ces insectes se tiennent au sec dans ces plaines submergées chaque année durant trois mois de pluie de moussons. Pendant les neuf autres mois, la sécheresse et la poussière règnent ; une poussière telle qu’il faut l’avoir connue pour y croire, toujours en suspension dans l’air et semblant vous pénétrer droit dans le sang. Marrakai, fondée il y a environ soixante ans et possédant probablement une merveilleuse histoire, est ostensiblement une station d’élevage, mais en réalité un ranch à buffles, le fermage commercial n’étant qu’un à-côté. Il y a là une rivière ou crique infestée de crocodiles, une petite maison de fer rouillé et de bois emprunté à la brousse, et beaucoup de campagne, 3.840 kilomètres carrés de campagne. On y comptait à la fin de 1946 — et peut-être encore maintenant — 1.400 têtes de bétail, un nombre inconnu de troupeaux sauvages et des buffles, en plus grand nombre encore dont on extermine environ 2.000 spécimens chaque année à la saison. Marrakai, comme toutes choses des Territoires du Nord, est vaste et indéterminée ; on n’en connaît pas exactement les limites ; il n’y a pas de clôtures, car le temps et l’espace ne comptent presque pas pour l’habitant de cette région.
Ce sport a lieu avec un fusil de calibre 303, à cheval, en voiture ou à pied ; de toute façon, c’est dangereux ; le buffle est naturellement calme et timide, jusqu’à ce qu’il soit blessé — bien que l’on en connaisse qui aient chargé avant qu’on ne les atteigne, témoin le vieux taureau rejeté du troupeau pour avoir attaqué une automobile qui passait sans le provoquer. Chasser à pied demande un but déterminé et du sang-froid, car on doit tuer du premier coup, autrement, gare ! — J’ai vu, dit Eoic, un buffle blessé, pesant peut-être une tonne, soulevé de terre par un autre ; touchés, ils chargent aveuglément, et, s’ils parviennent à l’attaquant, alors c’est la catastrophe : l’homme, d’abord emporté à bout de cornes, sera littéralement écrasé au sol par l’animal rendu fou. Eoic fut un jour entouré de cinq buffles parce que ses chevaux avaient fait un écart, mais il leur échappa en continuant à tirer : « Si vous gardez votre présence d’esprit, vous pouvez les atteindre à l’épaule, ou exactement entre les cornes, alors qu’ils foncent sur vous. Une balle à l’épaule traverse le cœur et le corps entièrement ; on la trouve sous la peau du côté opposé. Pour des raisons évidentes, il est préférable que deux blancs prennent part à la chasse, deux fusils valant mieux qu’un. À Marrakai, un blanc part avec un groupe d’indigènes dans une voiture, et l’autre, toujours avec des indigènes, à dos de cheval ; c’est ce dernier qui attaque. — Tirer d’un cheval est périlleux, continue Eoic. Il faut l’habitude du gibier et beaucoup de témérité, et aussi un cheval entraîné, posé, effrayé ni par le coup de feu ni par le buffle, comme ils le sont souvent, un cheval qui devra savoir se tenir sur la défensive lorsque le coup part, afin d’éviter d’être dessellé quand le buffle charge ou tombe. C’est une épreuve dure pour la monture, qui devra fréquemment être relayée. Le cavalier-chasseur vise l’épine dorsale au-dessus des pattes arrière. À moins d’être vite mis hors d’action, le buffle va où il a choisi, et il est bien difficile de le faire changer d’avis ; aussi le but du tireur est-il de le réduire à l’impuissance. Comme il est impossible de transporter les victimes et que le terrain est extrêmement vaste, le chasseur n’a pas de temps à perdre, il passe à la bête suivante, tire et ainsi de suite. Les dépeceurs se mettent au travail immédiatement ; autrement la peau se riderait et serait abîmée. Le record de l’année dernière en une journée fut de 34 tués et dépecés par ceux qui travaillent à Marrakai, mais un chasseur célèbre, Paddy Cahill, en a — dit-on — abattu 48 en une « course » à travers les plaines, avec 50 cartouches seulement. Un chasseur de buffles a besoin d’un capital allant de 750.000 à 1.150.000 francs pour acquérir son installation et ses droits de chasse selon les règles fixées par la « Protection des Buffles et les Ordonnances des Terres de la Couronne ». Le permis sur une étendue de terrain à buffles loué à bail se monte à 7 fr. 50 au kilomètre carré par an ; cela semble insignifiant, mais il faut un grand espace pour recueillir environ 2.000 peaux par saison, ce qui est une base normale. L’installation doit comprendre de 70 à 100 chevaux, à peu près 15 selles et bâts et divers autres paquetages. Les cuirs sont généralement acheminés du campement au port de destination par camion. On avait pour coutume de les transporter en fourgons à chevaux et en bateaux, au long de la côte, mais ces moyens sont entièrement périmés ou en train de disparaître. Au temps des fourgons à chevaux, le chasseur de buffles recevait son courrier et ses journaux tous les trois mois, et encore pas durant les pluies, où tout s’arrêtait ... sauf ces dernières. Il faut beaucoup de chevaux parce que ceux-ci ne peuvent être longtemps à la tâche. Une peau brute pèse environ 100 kilos, et une bête de trait doit quelquefois en porter deux loin du campement pour les faire saler et sécher. Et nous voici au campement, tout à fait typique, au nom pittoresque de À l’Encolure de Cheval, entouré d’une enceinte d’arbres, sur le terrain du corroborie de Malalucka, lieu traditionnellement réservé par la tribu locale d’indigènes pour leurs danses cérémoniales. Le campement est primitif, composé d’un enclos séparé du reste par une simple barre et où les femmes indigènes (lubras) font la cuisine. La barre est destinée à maintenir les chevaux en dehors ; entre deux arbres, une autre barre porte un assortiment de selles et de paquetages, ceci pour éloigner les fourmis blanches qui mangent pratiquement tout, sauf le fer. Non loin, une odeur qui n’a rien de délicat émane d’une pile de peaux salées prêtes à être pliées et chargées et de petites mares croupissantes dans lesquelles d’autres peaux sont grattées, préparées pour la salaison. Chaque tas en contient dix, poil dessous, et une couche de sel brut entre chacune d’elles, afin que les deux faces soient salées. Sous les arbres d’alentour sont les wurlies des indigènes, ou huttes primitives. Tous les jours, la peau de dessus est mise en dessous de la pile ; ceci pendant sept jours ; le huitième jour, on les suspend toutes jusqu’à ce qu’elles soient presque sèches et ensuite on les graisse. Le jour suivant, elles sont traitées avec du désinfectant agricole (contenant de l’arsenic) pour en détruire les parasites. Le dixième jour, les peaux sont pliées, prêtes au transport. Elles sont alors épaisses d’environ un centimètre, marron foncé, brillantes et cornées ; le prix courant par livre de 453 grammes en est à peu près de 27 francs, et elles pèsent chacune, disons 30 kilogrammes sèches ; de sorte qu’une peau moyenne vaut environ 1.500 francs. Tannée, la peau atteindra facilement 2 centimètres d’épaisseur et pourra être sectionnée en 16 couches. Au camp, nous goûtons de la viande de buffle ; elle est légèrement plus foncée que le bœuf, autrement on ne l’en distinguerait pas. Dans les campements de chasseurs, la langue est une gourmandise, à peu près la seule. Mais la majeure partie des carcasses, y compris les cornes, reste à pourrir par les plaines, ce qui est très dommage ; il semble que l’on n’ait encore trouvé aucun moyen, dans cette région à la population clairsemée, d’utiliser entièrement les bêtes tuées. Le transport vers les marchés est, naturellement, impossible. Cette industrie prit naissance lorsqu’un petit troupeau de buffles fut amené dans le pays il y a de nombreuses années. On dit que les trois premières bêtes furent introduites à l’île de Melville en 1825 par le commandant Maurice Burlow, et aussi qu’un troupeau de seize unités fut amené en 1848 par des soldats britanniques en garnison à Port Essington, dans la péninsule de Cobourg. La garnison fut relevée l’année suivante et laissa le troupeau derrière elle. Il n’y a aujourd’hui aucun chiffre officiel de production annuelle de cuirs, mais cela doit aller de 7 à 10.000 peaux. Edgar BEE. |
|
|
Le Chasseur Français N°620 Juin 1948 Page 101 |
|
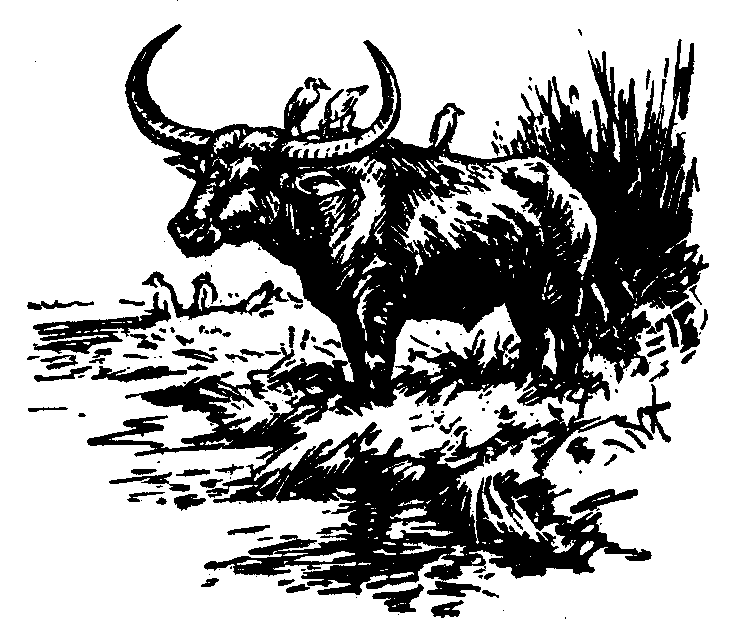 La population de Marrakai se compose de quelques
blancs et de nombreux indigènes. Clarrie Wilkinson, qui approche de la
soixantaine, chasseur aux longues années d’expérience, peut-être le meilleur de
la contrée de son temps, gère maintenant l’élevage. Son bras droit est Eoic Clissold,
qui prétend être le plus jeune d’Australie à taquiner le buffle. Il a la
trentaine, est de taille moyenne, fort et robuste, type du pionnier. Dès qu’il
sait ce que nous voulons, il fait preuve d’une extrême complaisance en nous
conduisant au campement principal et, en chemin, nous raconte tout ce qu’il
sait du gibier. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes à la noce, car ce
trajet de 15 à 25 kilomètres dans un ancien blindé de l’armée est
exténuant ; il s’effectue, pour la plupart du temps, dans des lits
desséchés de ravines, présentant de gros morceaux d’argile durcie sans assise,
et piétinés par d’innombrables milliers de bestiaux et de buffles. La seule
manière d’y faire rouler un véhicule est de le maintenir à 10 kilomètres à
l’heure et de serrer les poings ... Et voici ce dont nous informe Eoic aux
instants de progression relativement calme : le chasseur de buffles a une
série de campements utilisés comme bases d’opérations. Par une journée moyenne,
il abat de 18 à 20 bêtes, ne visant jamais une femelle ni un mâle de moins
de trois ans environ, susceptible de fournir moins d’une trentaine de kilos de
cuir sec.
La population de Marrakai se compose de quelques
blancs et de nombreux indigènes. Clarrie Wilkinson, qui approche de la
soixantaine, chasseur aux longues années d’expérience, peut-être le meilleur de
la contrée de son temps, gère maintenant l’élevage. Son bras droit est Eoic Clissold,
qui prétend être le plus jeune d’Australie à taquiner le buffle. Il a la
trentaine, est de taille moyenne, fort et robuste, type du pionnier. Dès qu’il
sait ce que nous voulons, il fait preuve d’une extrême complaisance en nous
conduisant au campement principal et, en chemin, nous raconte tout ce qu’il
sait du gibier. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes à la noce, car ce
trajet de 15 à 25 kilomètres dans un ancien blindé de l’armée est
exténuant ; il s’effectue, pour la plupart du temps, dans des lits
desséchés de ravines, présentant de gros morceaux d’argile durcie sans assise,
et piétinés par d’innombrables milliers de bestiaux et de buffles. La seule
manière d’y faire rouler un véhicule est de le maintenir à 10 kilomètres à
l’heure et de serrer les poings ... Et voici ce dont nous informe Eoic aux
instants de progression relativement calme : le chasseur de buffles a une
série de campements utilisés comme bases d’opérations. Par une journée moyenne,
il abat de 18 à 20 bêtes, ne visant jamais une femelle ni un mâle de moins
de trois ans environ, susceptible de fournir moins d’une trentaine de kilos de
cuir sec.