| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°620 Juin 1948 > Page 140 | Tous droits réservés |
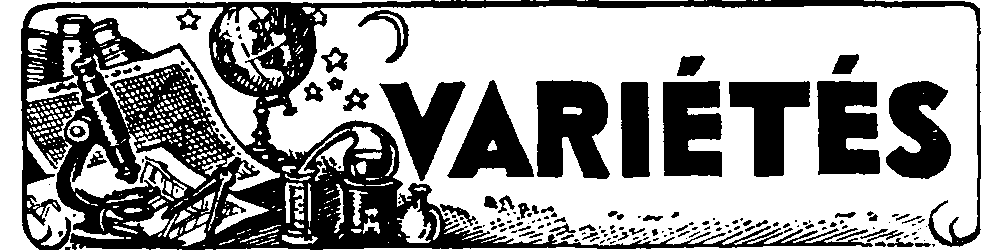
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Météorologie
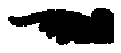
|
Les cyclones |
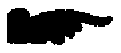
|
|
On ne peut pas, en quelques lignes, épuiser cet important sujet, et, même si on disposait de pages, on n’en verrait pas la fin, car le prochain capitaine qui sera pris dans une de ces tempêtes remarquera des phénomènes non encore signalés. Les cyclones se forment dans les régions tropicales. On attribue leur naissance à un fort échauffement, dans un certain lieu, des masses d’air des couches inférieures. On sait que l’air chaud tend à s’élever en altitude (le souvenir des montgolfières est présent à tous les esprits !). Donc, ces masses d’air subissent un mouvement ascendant qui entraîne évidemment une baisse barométrique plus ou moins considérable (souvent moins de 700 millimètres) et sur une zone plus ou moins étendue, suivant le volume des masses d’air en mouvement. Conséquence : immédiatement, de toutes les régions voisines, l’air plus froid accourt pour combler le vide causé par cette ascendance ... Mais, dès que cet air parvient à l’endroit surchauffé, il subit, lui aussi, le même phénomène et est entraîné vers le zénith ! ... Ceci rappelle l’attirance causée par un brasier : la fumée des brindilles un peu éloignées du foyer est d’abord attirée horizontalement vers le point d’où jaillissent les flammes, et, dès qu’elle y parvient, elle est emportée verticalement avec les flammèches, les autres fumées et même les cendres légères. Dans un poêle, dans un fourneau, cette ascendance est canalisée dans un tuyau et prend le nom plus connu de « tirage ». À l’échelle du cyclone, dont la cheminée centrale mesure des milliers de mètres de hauteur, on se rend compte de l’énormité du tirage et, partant, de la vitesse considérable qu’acquièrent les masses d’air qui se précipitent vers le centre avant d’être, à leur tour, emportées vers le zénith. On pourrait croire, à première vue, que les vents créés par ce phénomène vont converger de la périphérie vers le centre, comme les rayons d’une roue, issus de la jante, se rejoignent directement au moyeu ! Il n’en est rien. Diverses influences font que les vents tournent autour d’une dépression dans le sens inverse des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère Nord — le contraire dans l’hémisphère Sud (loi de Buys-Ballot). L’air est donc soumis à deux forces : la première l’attire directement au centre, la deuxième lui donne un mouvement giratoire autour de ce centre. Il va donc se mettre en mouvement suivant la résultante de ces deux forces, c’est-à-dire suivant une spirale qui, issue de la périphérie du météore, se dirigera vers le centre. Le vent « tournera » constamment, aura toujours une direction inclinée vers le centre, et sa force augmentera à mesure qu’il s’en rapprochera. Pour décrire un pareil ouragan, il faut laisser la parole à un Titan : Averse, ouragan, fulgurations, fulminations, vagues jusqu’aux nuages, écume, détonations, torsions frénétiques, cris, rauquements, sifflements, tout à la fois ... déchaînement de monstres ... le vent soufflait en foudre, la pluie ne tombait pas, elle croulait ... C’est ainsi que Victor Hugo a vu un cyclone ... Il semble que, pour une fois, il n’ait pas exagéré. Mais nous savons que ce vent, dès qu’il atteint la région centrale, est pompé verticalement vers le haut, et l’observateur, en général un marin, qui ne sent plus le déplacement « horizontal » de l’air (seul appréciable), dit qu’il n’y a « plus de vent ». C’est le calme central, appelé aussi « œil de la tempête » ... On peut, dit-on, allumer une bougie sur le pont du navire, et le ciel redevient bleu. Certainement, au sortir de la première phase d’un cyclone, alors qu’on vient d’éprouver des vents de 200 kilomètres à l’heure, on a l’impression d’une accalmie totale quand le vent ne souffle plus qu’à 30 ou 40 kilomètres à l’heure ... Quant au ciel, qui redevient bleu, il suffit de réfléchir un peu pour comprendre la raison du phénomène. Les vents convergent vers le centre et entraînent avec eux tous les nuages de la région ... En fait, dans le corps d’un cyclone, la pluie n’est pas « diluvienne », elle est « cyclonique » (une expression vaut l’autre, mais la deuxième a l’avantage d’avoir été mille fois vérifiée autrement que par des témoignages bibliques). Dès que l’air subit l’influence ascendante, tous les nuages sont emportés en hauteur, puis rejetés vers la périphérie. Il y a donc dans la région centrale une zone de ciel serein et d’atmosphère relativement calme ... Se rend-on bien compte de la force des lames provoquées par un vent soufflant à 200 kilomètres-heure ? Un vent qui dure, qui tient des heures et des jours ? ... La mer devient dure, énorme, furieuse en approchant du centre ; et, dans ce centre où sont enfermées toutes les vagues venues de tous les points de l’horizon, puisqu’un cyclone a un mouvement giratoire, la mer devient absolument démontée, les vagues énormes se mêlent et s’entrechoquent pour faire de terribles lames pyramidales, et l’infortuné navire pris dans ce centre ne sait plus du tout ce qu’il a à faire, car, en présence de ces houles jaillies de toutes parts, il ne peut plus prendre ni la cape, ni la fuite ... Il n’a plus qu’à attendre l’inévitable arrivée de la deuxième partie du cyclone où, malgré les dangers de cette renverse, le capitaine trouvera, grâce au vent qui reprend, un adversaire à peu près franc dans le troupeau des lames démentes à nouveau soumises au vent régnant. Je n’ai pas cherché à expliquer les cyclones, j’ai surtout voulu faire comprendre le mécanisme et surtout l’existence du calme central ... Il y a quelques semaines, certains journaux quotidiens ont annoncé qu’un navire avait trouvé au large une mer énorme, sans un brin de vent ... Dépêche sans doute tronquée, interprétée peut-être par un chroniqueur pas très au fait des choses de l’océan ; pour que les lecteurs de cette information ne croient pas que ces mouvements désordonnés des ondes sont le fait d’une ébullition subite ou la, conséquence des convulsions du serpent de mer, j’ai cru bon d’écrire les lignes qui précèdent. PYX. |
|
|
Le Chasseur Français N°620 Juin 1948 Page 140 |
|
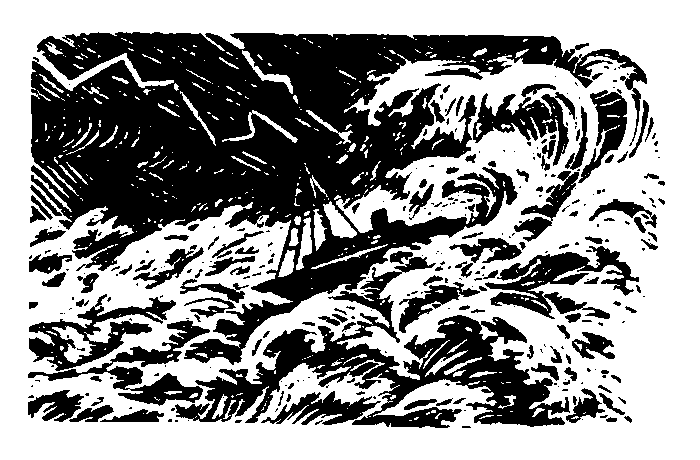 Il n’entrait pas dans mes projets d’aborder ici
l’étude des cyclones. Ces tempêtes extrêmement violentes ne sont pas,
heureusement, des habituées de nos régions. L’ouragan qui, les 25 et 26 septembre
1947, a éprouvé notre littoral méditerranéen offrait bien quelques analogies
avec cette espèce de météore : baisse rapide du baromètre, précipitations,
passage du centre, renverse subite et grande vitesse du vent (160 kilomètres-heure
à Toulon), mais ce n’est pas pour cette raison que je veux effleurer aujourd’hui
l’étude des cyclones (ou typhons), c’est pour une raison bien différente qui
sera donnée à la fin de cet article.
Il n’entrait pas dans mes projets d’aborder ici
l’étude des cyclones. Ces tempêtes extrêmement violentes ne sont pas,
heureusement, des habituées de nos régions. L’ouragan qui, les 25 et 26 septembre
1947, a éprouvé notre littoral méditerranéen offrait bien quelques analogies
avec cette espèce de météore : baisse rapide du baromètre, précipitations,
passage du centre, renverse subite et grande vitesse du vent (160 kilomètres-heure
à Toulon), mais ce n’est pas pour cette raison que je veux effleurer aujourd’hui
l’étude des cyclones (ou typhons), c’est pour une raison bien différente qui
sera donnée à la fin de cet article.