| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°608 Août 1948 > Page 146 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
La chasse aux chiens courants

|
Tout coi ! Valet ! |

|
|
Sur la Grande Ligne qui s’étend à perte de vue et dont la pénombre m’empêche de distinguer l’admirable rectitude, allée ferrée et tracée autrefois pour le plaisir des rois de France, je n’aperçois que des bois noirs, dominés par un ciel gris bleuté. Tout est silence, troublé seulement par un rien de brise murmurant dans les branches dépouillées. Pour un profane cela suerait l’ennui, mais, pour moi, je suis dans l’état bénéfique d’un mélomane avant un grand concert. Une lueur d’un rose violet a percé tout au loin ; déjà on peut distinguer la ligne plus claire de la grande allée. Un vol de corbeaux rase les arbres. Il est temps de se mettre en quête. Aujourd’hui, je dois explorer un assez vaste canton, délimité par la Grande Ligne, ayant à sa base un étang fort étendu — quelque 70 hectares d’eau — et bordé d’un côté par la plaine. Je cherche à prendre le vent afin qu’il puisse aider mon limier, mais tout est calme et nous partons à l’aventure dans le jour incertain. Avez-vous fait parfois le bois en grande forêt en essayant de détourner des grands animaux ? Si cela vous est arrivé, il vous sera facile de nous suivre dans nos marches dans les bois, maintenant endormis, car pour les bêtes sauvages l’aube devient le crépuscule des hommes. Autrement vous aurez peine à comprendre tout le charme envoûtant de ce rude labeur. Je cherche une voie de sanglier, et les sangliers, après les criminelles destructions qui suivirent la Libération, sont devenus rares dans un massif forestier que j’ai connu assez vif pour faire le bonheur d’un vautrait. C’est ce qui explique pourquoi veneurs et gardes sont nombreux ce matin pour quêter dans une forêt de près de 6.000 hectares, c’est-à-dire à peu près aussi vaste que Paris ... J’ai le plaisir de travailler avec un excellent limier ; c’est une chienne de cinq ans, blanche et orange, de 21 pouces environ et qui rappelle, dans son type et sa silhouette, la fameuse Duchesse, peinte par Oudry. Je l’estime beaucoup. Car, respirant la grande race et si jolie à regarder, elle possède, de plus, un merveilleux équilibre mental. Très fine de nez certainement, comme tous nos chiens français, mais surtout très sûre, sage et secrète malgré ses grandes qualités de rapprocheur. Elle ne donne que des voies de bêtes noires, se rabattant bien sur les renards, mais d’une manière si dégoûtée qu’il n’y a pas à se tromper. Elle méprise souverainement cerf, chevreuil et lièvre. Mais j’ai tellement confiance en elle — et comme je sais qu’elle sera découplée tout à l’heure avec le reste du vautrait— que, pour ne pas la fatiguer inutilement, je l’ai libérée du trait et elle marche en liberté devant moi. Je sais aussi que ce n’est pas l’avis du maître d’équipage, mais toute ma vie j’ai été terriblement indépendant et j’aime jouer — encore maintenant — avec la difficulté ... Et nous cheminons de compagnie. Allées, layons, routes, bordures de plaine sont parcourus sans que nous croisions une voie de bon temps. Deux longues heures sont déjà passées et je peste en moi-même contre ces « fusillots » qui ne savent point exploiter des chasses en bons pères de famille. Le moment du rendez-vous approche et il faut rejoindre la camionnette qui nous conduira à la garderie où nos amis nous attendent pour un rapide déjeuner avant le moment de nous mettre en selle. Pour ce faire, je suis une allée herbue qui porte un nom célèbre de l’histoire ; puis, tout à coup, alors que, désespéré, j’allais prendre un layon transversal afin de me raccourcir, ma chienne se rabat brusquement et saute au fort. Je n’ai que le temps de la rejoindre et de lui passer la botte. Nous sommes dans un taillis d’une douzaine d’années, où pousse un bois peu fourni, coupé de ronciers et de genêts. La chienne fait suite hardiment. Le revoir est mauvais, mais elle tire à plein trait, sent à la branche ; j’ai peine à distinguer sur le sol, dans l’amas des feuilles mortes, un volcel’est incertain. Prudemment, car le bois est clair et la voie semble très chaude, je continue en cherchant une place favorable où je pourrai juger ce qu’emmène le limier. Voilà un endroit meilleur ; pas de végétation, une terre noircie parsemée de plaques de mousse (une ancienne place à charbon sans doute), et je distingue enfin le double croissant fatidique, et même profondément marqué, les gardes donnant bien dans le sol meuble. C’est un goret, et un goret qui doit peser dans les 200 livres si je ne me trompe, bien vigoureux et bien courable. Des sires de cette sorte ne sont plus des apprentis, possédant la candeur du jeune âge et qui se croient en sûreté dès qu’ils ont gagné leur bauge. Quatre ou cinq ans de vie forestière leur ont appris bien des choses et il serait imprudent de continuer plus avant dans l’enceinte. Nous regagnons donc l’allée et je brise haut et bas. Cette partie de forêt m’est très familière ; j’y ai beaucoup chassé à tir, surtout la bécasse, et je pourrais m’y diriger comme dans mon jardin ; je sais que l’enceinte n’est pas très grande, mais que dans le centre il existe des ronciers impénétrables où les sangliers aiment se tenir. Et voici la dernière manœuvre : faire le tour de l’enceinte pour s’assurer que rien ne sort. La chienne, qui se traînait dans les allées il n’y a qu’un instant, est vraiment transformée. Elle en sait aussi long que moi, la jolie, et joue, de tout son cœur de bon chien courant, ce terrible jeu où sa vie et celle du sanglier que nous travaillons seront peut-être en cause tout à l’heure ... Et, je l’avoue humblement, moi aussi, je joue le jeu avec autant d’intérêt qu’à mes débuts, il y a bien des années. Rien sur l’allée ; je prends un faux-fuyant en bordure de plaine, et la chienne me donne une voie rentrante, le volcel’est me l’indique sans aucun doute. Maintenant nous tombons sur un chemin tournant ; là il faut faire attention, car le sol est dur, et c’est une voie très fréquentée. Nous allons avec prudence, les sens en éveil ; la chienne tout odorat, et moi les yeux ouverts à m’en faire pleurer. Mais saint Hubert est avec nous, pas de voie de sortie, et je peux en conclure que notre sanglier est dans l’enceinte, qu’il est rembuché pour tout dire. Vous attendez la suite ? Vous croyez que, deux heures après, et sur la foi de notre rapport, on découplait de meute à mort les vingt anglo-français du vautrait ; qu’ils bondissaient sur la voie dans un rapprocher emmené à plein train et que bientôt le ragot déboulait dans le concert des voix déchirantes, les cris des hommes, la fanfare des trompes ? Il en aurait pu être ainsi ; mais ce n’est pas ce qu’il advint. On n’attaqua pas à ma brisée. Ce fut à une autre plus près du rendez-vous, où les chiens furent mis aux branches. Ce prélude, en somme, fut une mesure pour rien. Pour rien ? Est-ce bien sûr ? Pas pour moi toujours, qui y avais vécu de ces minutes exaltantes dont on se souvient — en bon sportsman — sans vaine mélancolie. Guy HUBLOT. |
|
|
Le Chasseur Français N°608 Août 1948 Page 146 |
|
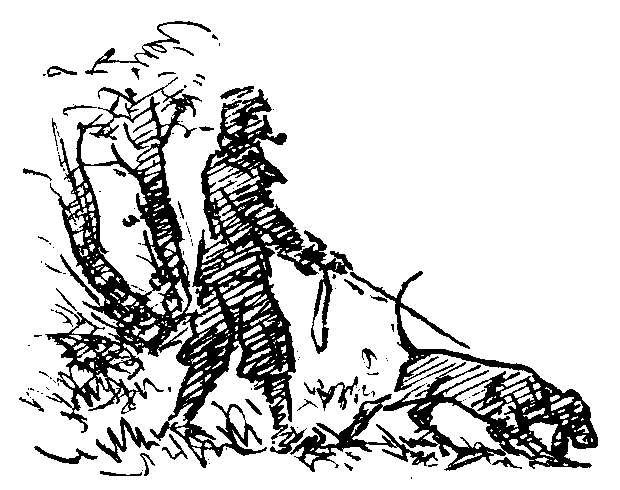 Le jour n’en finissait pas de se lever ; un jour
de décembre, un jour d’hiver où l’aube livide, le ciel de plomb rendent
mélancoliques, mais avec un charme si prenant, les fourrés, les futaies et les
taillis d’une grande forêt. Car je suis dans une grande forêt avant l’aurore,
et, bien au chaud dans ma camionnette de chasse, je tire sur ma pipe qui
rougeoie en calmant le limier impatient qui s’agite derrière moi.
Le jour n’en finissait pas de se lever ; un jour
de décembre, un jour d’hiver où l’aube livide, le ciel de plomb rendent
mélancoliques, mais avec un charme si prenant, les fourrés, les futaies et les
taillis d’une grande forêt. Car je suis dans une grande forêt avant l’aurore,
et, bien au chaud dans ma camionnette de chasse, je tire sur ma pipe qui
rougeoie en calmant le limier impatient qui s’agite derrière moi.