| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°608 Août 1948 > Page 155 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
En basse Seine

|
Une histoire de gabion |

|
|
Je connais donc le gabion. Ça ne m’a pas empêché, ce jour-là, de m’y comporter comme une mazette, tant est grande l’hypnose qu’exerce sur les nerfs l’attente du gibier. Quand on est dans cette satanée boite, les yeux au guichet, on n’est plus un homme, on est une machine enregistreuse de tous les bruits, de tous les mouvements, de toutes les ombres. Tout ça, c’est du gibier ! On l’attend, on l’entend, on le veut. On le voit. Les yeux et plus encore l’imagination déforment tout ... La petite bosse, là-bas, au sommet de laquelle remue une touffe d’herbe, ça y est : c’est un gros, ou une sarcelle ... On la voit remuer le cou, changer de place : imagination. Que dire de la pièce, une vraie celle-là, ou du voilier qui décrit son orbe avant que de se poser ? On est là, pantois, le souffle coupé et, Dieu me pardonne, le cœur serré comme si on affûtait un tigre ! Qu’y a-t-il ? Du gibier d’arrivé ! J’avais dix-huit ans, je ne coupais pas à cette émotion. Aux décades de la vie, où le 6 est largement entamé pour moi, l’émotion est toujours la même ! Excusez, ami lecteur, ce préambule. Je pense que vous n’êtes pas loin de me comprendre, et ceci m’incite à penser que vous ne rirez pas de trop — non de ma petite histoire, — mais d’un de ses auteurs dont je fus. Voici : Nous habitions loin (250 kilomètres du Hode), mais venions régulièrement toutes les lunes passer quelques jours à nos gabions, avec, ma foi, assez de chance pour les changements de temps, partant pour des réussites. Ayant manqué une fois un coup de gelée assez sérieux, dont nous nous consolions difficilement, nous nous étions mis en route nos affaires terminées, mais, depuis deux jours, le dégel était venu. — Tant mieux, disait mon ami, toujours optimiste, un coup de dégel, ça vaut un coup de gel, suivant Le Chasseur Français. Las ! aux environs de Caudebec, de Lillebonne, plus beaucoup d’espoir. C’était un dégel mou, un dégel à la ... noix, comme dit le grand Jules en nous accueillant. — J’suis pas amorcé, et puis j’peux pas aller à l’Épi, mais, s’il était libre, j’risquerais ma chance, ça me dit qué’chose. Un peu réconforté par notre oracle habituel, pressant le déjeuner et n’oubliant pas les provisions du soir, nous voilà en route. Six canes, deux malarts. Un jeu de choix. Je n’étonnerai aucun de mes condisciples en leur disant que, dans un gabion que l’on prête à ses amis, c’est, bien rare si on y retrouve ses tiers et plombs au complet. Un vrai gabionneur a ce qu’il faut dans son carnier, et les deux tiers manquants furent vite confectionnés, mais restaient nos quatre canards en bois ! On y tient ; si ça ne fait pas de bruit, ça meuble et, bien posés en un petit tas, ça vous a un air naturel qui fait bien dans le décor. Trois avaient encore leur ficelle, mais rien au bout. Un vieux boulon pour l’un, une vieille fourchette pour l’autre, la cuillère qui faisait son pendant pour le troisième, mais rien, rien pour le quatrième. — Bah ! tu le poseras sur la glace. Y a pas de vent, il ne bougera pas, me dit mon ami. Une idée, après tout. Et voilà bientôt toute la volière en place sur la mare aux trois quarts dégelée. J’avais, d’un petit coup sec, assujetti mon canard sans corde par son piton sur la glace friable. Un dernier coup d’œil. Parfait, nos quatre bois ont bien l’air, loin des autres, d’un petit volier au repos. Et nous voilà au guichet. Sans grand espoir, pas un souffle de vent, du brouillard, une mare sale, quoique bien éclairée. Pas un cri de cane, les malarts muets ... Tout ce qu’il faut pour faire une bredouille ... Vous connaissez ça, je n’insiste pas. De guerre lasse, et aussi d’ennui, on pense au dîner, d’autant que cette humidité glacée n’a rien de bien folâtre, et nous apprécions bientôt le charme et la joie d’un bon bouillon brûlant, qui chasse un peu notre déconvenue. Puis ce qui s’ensuit et le café avec son « calva » de bon goût, mon Dieu ! nous rabibochent avec le gabion. Nous n’avons pas, hélas ! à sauter sur les bougies pour les éteindre. Aucune alerte ne vient rompre la bonne chaleur émolliente de notre home confortable, lorsque l’on se rappelle les anciens gabions où, à même la paille, on ne pouvait guère que se tenir à genoux ! ... Et les souvenirs de pleuvoir ! Le coup des neuf sarcelles où sept étaient restées, des trois oies sur quatre, des quatre gros sur la glace royalement loupés, des deux rappelants qu’on avait tués d’un coup au lieu des deux sauvages, parce que, tournant la tête pour décrocher le fusil, les quatre, dans un beau mouvement de quadrille, avaient changé réciproquement de place. Et puis la nuit de 1948 où on avait manqué de cartouches ... — C’est pas tout ça, on n’est pas là pour bavarder. Y a peut-être quelque chose d’arrivé ; au gabion, faut s’attendre à tout, dit mon copain. J’éclatai de rire devant tant de confiance, mais le plus fort, c’est qu’il avait raison ! Derrière les trois appelants de droite, une pièce était là ! Jumelle en main, mon ami monologuait : — Trop petit pour un gros ; trop gros pour une sarcelle ; c’est pas un vingeon ... Ah ! ça doit être un morillon. De fait, trapu, le cou rentré, rond, bec court, ça devait être un morillon bien calme, bien sage, endormi comme il arrive parfois. Mais intirable dans la ligne des appelants. Et nous voilà, les yeux fixés sur le gibier, attendant qu’il se décolle un peu, mais aucun souffle de vent ! Un quart d’heure, une demi-heure se passe. Pourtant, insensiblement, il se dégage un tout petit peu, puis un peu plus. On guette le moment où les canes, toujours silencieuses, seront en sens inverse de leur tiers. Enfin, après vingt ou vingt-cinq autres minutes d’attente, je le trouve assez détaché, et vlan ! lui allonge un coup de fusil. Il y est ! — Il y est, dit mon ami, qui l’examinait à la jumelle, mais il y est mal, il n’a pas le cou dans l’eau. Tu devrais lui rallonger un second coup de fusil. C’est pas la peine de laisser souffrir une malheureuse bête, et puis, s’il va aux roseaux, il est perdu. Sans retenir ce que je devais le mieux apprécier ou de cette sensibilité que je comprenais, ou du désir d’avoir la pièce, je lui rallongeai mon deuxième coup. Cette fois-ci, il avait son compte. Et nous voilà, comme il se doit, en train de fêter le sauvetage de la bredouille par un large autre coup de café. Sans se presser, bien entendu. Réinstallés au guichet, mon ami me dit : — Ben ! mon vieux, ton morillon n’est pas encore mort. Tu le vois qui s’en va aux roseaux ? Effectivement, il paraissait y aller. — Tant pis, on ne risque rien, mais c’est pas la peine ni de le perdre, ni de le laisser souffrir. Tu te souviens ... Parbleu ! si je me souvenais de cette malheureuse barbelle qu’on avait retrouvée, le matin, le cou et la patte à moitié rongés par les rats et encore vivante. Pouah ! Quels sauvages on fait ! — Eh bien ! alors, à ton tour ; tu auras peut-être le plomb plus meurtrier que le mien. L’ajustant soigneusement, mon ami lui allonge un troisième coup de fusil. Cette fois-ci, plus de doute, le morillon n’est plus qu’une mince ligne noire sur l’eau. — C’est effrayant ce que ça a la vie dure, ces satanées bestioles, et puis aussi tu ne riras plus quand je dis qu’au gabion faut s’attendre à tout. Il ne savait pas si bien dire ! Le restant de la nuit fut sans histoire : morne, désespérant. Le petit jour, suprême espoir des bredouillards, nous retrouva à nouveau au guichet. Il compléta la nuit : rien, rien.
— Nom de D ..., ah ! par exemple. ! Notre morillon, il a un piton sur le ventre ! C’était un de nos canards en bois ! Et, de fait, ils n’étaient plus que trois ! Que s’était-il passé ? Ceci, que, la glace sur laquelle je l’avais posé s’étant fondue, le canard en bois s’était trouvé libre, et de là tout le drame ! Vous me direz que l’on aurait pu avant jeter un coup d’œil de ce côté. C’est vrai. Mais il y a l’hypnose du gibier, et ça ... c’est la porte ouverte à toutes les bêtises. On n’y a pas failli. — Vous en êtes des vernis, nous dit en passant notre voisin qui sortait de l’Épi, trois coups de fusil avec un pareil temps ! Diable, on n’avait pas pensé à ca ! Dire que, comme des gamins, on s’était amusé à tirer sur des canards en bois, ce n’était pas possible, mais avouer qu’en vieux gabionneurs on avait pu sciemment canarder trois fois de suite un même canard de bois, c’était par trop ridicule ! ... — Bah ! dit mon ami, ça marchait tellement mal qu’on a tiré sur des rats. On en est infesté ici, il y en a quatre qui n’embêteront plus personne. O amour-propre, où vas-tu te nicher ? Surtout, amis, n’allez pas clabauder cette histoire. C’est la première fois que je la raconte, et je ne voudrais pas qu’en me revoyant vous puissiez trop rire de moi. M. LEBAS. |
|
|
Le Chasseur Français N°608 Août 1948 Page 155 |
|
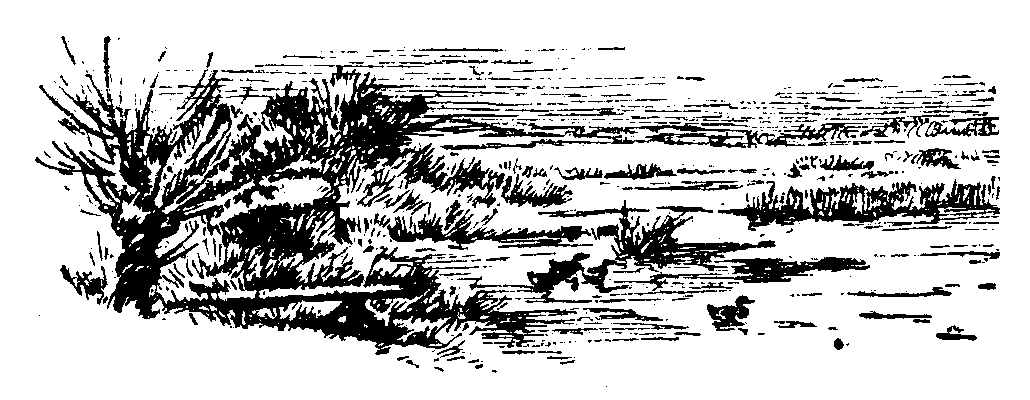 Ceci est une histoire véridique, arrivée non à un des
novices, mais à deux vétérans du gabion. Je dis vétérans : et on en
jugera, hélas ! puisque j’ai, dans ma prime jeunesse, connu les marais de
la basse Seine sans le canal de Tancarville, dont je me souviens des premières
dragues ; que mon grand-père possédait un gabion en face de la trouée du
parc du château de Mortemart ; qu’y tournant le dos, les yeux sur le phare
de Fatouville, on arrivait droit à son emplacement, c’est-à-dire au bord du
blanc-banc !
Ceci est une histoire véridique, arrivée non à un des
novices, mais à deux vétérans du gabion. Je dis vétérans : et on en
jugera, hélas ! puisque j’ai, dans ma prime jeunesse, connu les marais de
la basse Seine sans le canal de Tancarville, dont je me souviens des premières
dragues ; que mon grand-père possédait un gabion en face de la trouée du
parc du château de Mortemart ; qu’y tournant le dos, les yeux sur le phare
de Fatouville, on arrivait droit à son emplacement, c’est-à-dire au bord du
blanc-banc !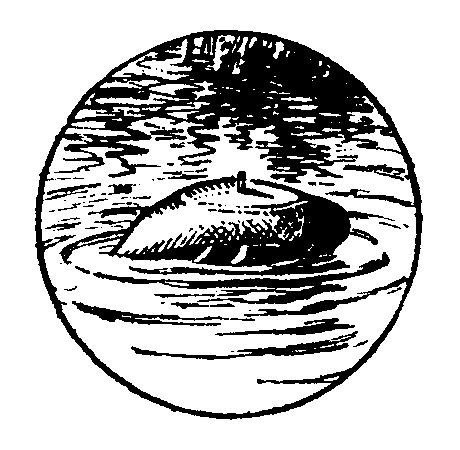 Inspectant par distraction à la jumelle la mare et
ses contours, je redécouvris le morillon arrêté par ce qu’il restait de glace.
Inspectant par distraction à la jumelle la mare et
ses contours, je redécouvris le morillon arrêté par ce qu’il restait de glace.