| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°608 Août 1948 > Page 190 | Tous droits réservés |
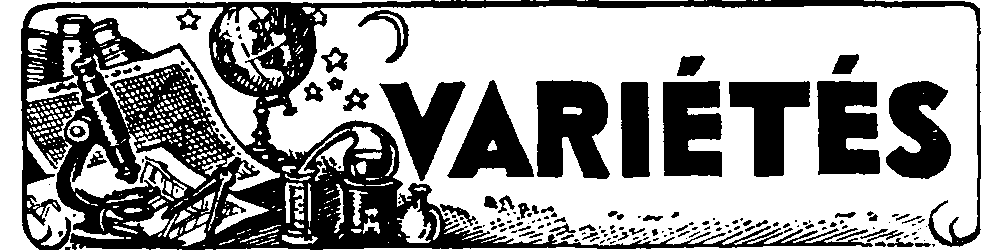
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Notes de voyage

|
À Djibouti |

|
|
Voici, vécues par un grand voyageur, au cours d’un voyage circulaire à travers la mer Rouge, quelques impressions sur la capitale de notre Côte des Somalis, injustement méconnue et pleine de pittoresque. Je n’ai pas, comme relations à Djibouti, que mes compagnons de l’Hôtel des Arcades. Depuis huit jours — déjà ! — que j’erre dans les rues de la ville, dont je commence à connaître les moindres recoins, je m’y suis fait cent autres amis parmi des classes différentes de la population. Ce sont déjà, bien entendu, la douzaine de garnements qui passent leur temps à ne rien faire devant la porte de l’hôtel et désirent continuer, bien que s’offrant à vous dix fois par jour pour n’importe quelle besogne. Ceux-là, je les connais tous. Le cadeau d’une cigarette fait naître sur leurs visages un sourire qui s’étend jusqu’aux oreilles, et je ne me prive pas de leur offrir ce plaisir. Comme je ne leur demande rien en échange, ils se déclarent prêts à tout pour moi, et l’un ou l’autre, quand ce ne sont pas deux ou trois, m’accompagne toujours dans mes pérégrinations à travers la ville. Leur compagnie est précieuse et charmante ; elle contribue en outre à me faire connaître comme un Djiboutien attitré, et non plus comme un vulgaire touriste. C’est grâce à eux que j’ai maintenant porte ouverte dans vingt maisons et quelques paillotes, de la rue d’Abyssinie jusqu’au Bender. L’un, le plus fidèle, se nomme Ali, et l’autre Hamoudi. Ils sont très fiers de ce que je les appelle par leur nom. Ce n’est pas l’usage qu’un Européen, ici, fasse tant de frais pour un polisson de leur genre. Quand on a besoin d’eux, on les appelle yaouled, ce qui veut dire boy, ou garçon, et les humilie, car chaque enfant, sur la Côte des Somalis, comme ailleurs, s’imagine toujours qu’il est devenu un homme et mérite d’être traité comme tel. Ali et Hamoudi sont des métis. Il n’y a guère au service des Européens que des métis. Ils sont de peau très noire, minces, musclés, mais leurs traits n’ont ni la finesse, ni la beauté des purs Somalis, Issas ou Danakil, que l’on croise dans les rues des quartiers indigènes. Ali a les cheveux lisses, et Hamoudi a les cheveux crépus, ce qui trahit pour le premier des ancêtres arabes, et pour le second des parents d’origine soudanaise. L’un comme l’autre descendent d’anciens parents esclaves échoués au bord du golfe de Tad-jourah après quelles dramatiques péripéties ? ... Ce passé semble n’avoir laissé nulle amertume dans le cœur des deux garçons, qui sont aussi joyeux qu’espiègles.
Tout métis qu’ils sont, ils affichent un profond dédain pour les purs de race dont je parlais à l’instant. Je ne partage pas les sentiments d’Ali ni d’Hamoudi, et j’ai toujours regretté de n’avoir pu entrer en relations avec ces hommes farouches qui arrivent du fond du désert ou qui y repartent et font mon admiration quand je les croise. Ces gens passent pour être peu sociables et plutôt dangereux à fréquenter. Peut-être ainsi ai-je tort d’avoir tant de regrets ? Issas aussi bien que Danakil (ce sont là les deux races somalies) sont bruns, grands, minces, souvent très beaux, toujours très peu vêtus. Ceux que l’on voit à Djibouti de ces races insoumises portent toujours la lance guerrière dans la main et le poignard dans la ceinture. On dit qu’une plume d’autruche piquée dans leurs cheveux est le témoignage du meurtre d’un ennemi : mais je n’ai point rencontré pareille coiffure. Ceux que j’ai vus arboraient, fiché dans leur chignon, un piquant de porc-épic, ou une sorte de longue fourchette de bois taillé. À ce que j’ai cru comprendre, ce n’est point là objet de seule coquetterie, mais instrument commode pour fourrager dans une tignasse où règne, se reproduit et combat une faune très nombreuse. Ces hommes noirs sont fiers et hautains. Ils sont drapés dans de brèves étoffes de couleur et toisent les Blancs qu’ils rencontrent avec un très évident mépris. Ils crachent par terre dès que vous êtes passé, pour exprimer leur dégoût. Il vaut mieux les rencontrer dans les rues de Djibouti que seul, au détour d’un rocher, dans la brousse ... Beaucoup d’entre eux, toutefois, au contact prolongé de la civilisation, s’urbanisent un peu. Ils sont toujours aussi arrogants, mais moins dangereux. Ils ont oublié chez eux leur poignard et remplacé leur lance par une canne : c’est moins encombrant et plus pratique pour s’appuyer dessus quand on fait la causette. En marche, ils la placent sur leur nuque et accrochent leurs mains aux extrémités, un peu, mais plus gracieusement, à la façon des ours qu’on fait danser. Ce n’est pas là non plus mollesse élégante ; mais, de cette façon, les bras étant bien éloignés du corps, l’air circule autour de soi, et spécialement sous les aisselles, réduisant d’autant la transpiration, qui donne soif. Certains ont un costume plus citadin : souvent une sorte de caleçon blanc collant aux jambes qui descend jusqu’aux chevilles et un vaste péplum sur la poitrine et les épaules. C’est la mode d’Addis-Abéba, qui n’est pas sans distinction. Ils portent presque tous des sandales : mais fort rarement aux pieds. Ils tiennent ces objets dans la main, comme un roi tient son sceptre. L’on rencontre de ces messieurs par douzaines sur les places des quartiers indigènes, devisant et fumant, ou bien encore accroupis, la canne à la main, sur les hautes banquettes des terrasses de café. Poussant davantage l’enquête, j’en ai rencontré beaucoup plus encore dans des sortes de bouges, ou plutôt d’étables, occupés à brouter de l’herbe. Ils broutent consciencieusement, sans mot dire, pendant des heures et des nuits. On leur apporte des bottes de verdure, et ils broutent. Cette herbe, c’est le kat, qui donne 6des rêves heureux ... Le Yémen, de l’autre côté de la mer Rouge, qui fait, depuis des lustres, un usage absolument immodéré du kat, est tombé tout entier dans une sorte de léthargie voisine de l’idiotie complète. Les indigènes de la Côte des Somalis n’en sont pas encore là, mais cela viendra sûrement, et bientôt, du train qu’ils vont maintenant à mâcher le kat. Les rencontres dans les rues ne sont pas que masculines. Voici les dames de ces messieurs. Elles ne sont guère plus vêtues qu’eux et montrent souvent à découvert une poitrine dont le charme, mon Dieu ! comme ailleurs, varie suivant l’âge. Leur robe faite de cotonnade aux couleurs vives est serrée à la taille et forme au-dessus une sorte d’écharpe qui s’attache sur l’épaule gauche. Les mères de famille portent leur nouveau-né dans un fichu attaché sur leur dos. Les jeunes filles sont parfois ravissantes. Elles se coiffent les cheveux d’une façon extraordinairement compliquée, se divisant la chevelure en une infinité de petites nattes décorativement réparties de chaque côté du crâne et reliées les unes aux autres, par leur extrémité. Elles adorent les tissus rouge foncé et bleus. Comme toutes les sauvagesses du monde, et, d’ailleurs, ainsi que le font également les femmes les plus civilisées, elles se couvrent de bijoux et d’ornements. Elles semblent un peu plus occupées que les hommes. Elles s’affairent à leur ménage. Ce dernier n’est pas très difficile, et, si la hutte qu’elles habitent en famille est parfois d’une netteté relative, l’extérieur de la maison est le plus souvent d’une saleté repoussante. Le quartier indigène, malgré le vent du large, en acquiert une savoureuse odeur, extrêmement caractéristique. Madame fait-elle la cuisine ? La plupart du temps, c’est dans la rue, si bien que les passants peuvent se rendre compte du menu de chaque famille. C’est aux dames qu’il incombe d’aller quérir l’eau à la fontaine. Elles y vont dans des bidons d’essence désaffectés, qu’elles trouvent bien plus séduisants que les poteries de jadis. Autour du robinet, elles font la lessive et leur toilette, s’épouillant mutuellement sur le bord du trottoir. Elles vont aussi chercher le bois pour la cuisine, tissent des paniers, tannent des peaux de mouton et de chèvre. Leurs occupations innombrables constituent ainsi, pour le promeneur, un spectacle plein de charme et d’intérêt. Comme les hommes, elles adorent bavarder. Ont-elles quelque loisir, c’est pour l’employer à faire la causette. Elles ne vont pas au café. Mais leur lieu de rencontre favori est la voie du chemin de fer d’Addis. Elles s’assoient par groupe sur le ballast, mais surtout sur les rails, qu’elles considèrent comme le plus confortable des sièges. Et les langues de marcher ! La locomotive est obligée de siffler pendant de longues minutes et parfois de s’arrêter, pour ne pas écraser chaque jour ces péronnelles. Elles s’esclaffent sans vergogne en s’enfuyant et, quand le train est passé, reprennent leur place et leur conversation ... Je ne sais pas au juste quelle est la vie sentimentale de ces ménages citadins. L’on entend parfois, des paillotes, s’élever des cris suraigus de femme qu’on maltraite, accompagnés des jurons échappés d’un gosier mâle. Des glapissements, des supplications, des imprécations, des protestations semblent indiquer au passant qui n’est pas sourd que, mon Dieu ! en Somalie comme dans beaucoup d’autres régions du monde, maris et femmes ont quelquefois des explications un peu frappantes à se donner. Quoi qu’il en soit, les familles nombreuses sont la majorité, et les ruelles sont pleines d’enfants de tous âges — tout nus, tête rasée, sauf une mèche — qui se disputent la poussière avec les chèvres. Car à Djibouti, jusque sur la place Ménélik, les chèvres vont et viennent librement dans les rues, tout comme les personnes, et mieux qu’elles. Il est évident que ces bêtes ne trouvent là pas beaucoup d’herbe à brouter. Mais elles ne jeûnent pas quand même, car elles absorbent soigneusement tous les détritus et spécialement les vieux papiers qu’elles rencontrent. Rien n’est plus gourmand de vieux journaux qu’une chèvre Somalie. Ces animaux sont extrêmement impertinents et embouteillent à chaque instant les rues qui ne sont pas assez larges pour leurs évolutions, leurs jeux, leurs combats ou leurs fantaisies. Dans les conflits qui les mettent aux prises avec les yaouled, ou même les gens plus âgés, elles ont souvent le dessus, et elles constituent probablement le seul danger de ces rues pittoresques bordées de huttes en branchages qui aboutissent, au delà de la route d’Ambouli et des salines, à l’entrée du désert. Gaëtan FOUQUET. |
|
|
Le Chasseur Français N°608 Août 1948 Page 190 |
|
