| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°622 Octobre 1948 > Page 198 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
À propos des geais |

|
|
Le gros passage de geais observé à l’automne dernier me paraît devoir être signalé un peu comme une anomalie. Je me permets donc, à titre documentaire, de présenter quelques observations de chasseur qui intéresseront sans doute plus d’un jeune confrère. Tout d’abord le geai est un migrateur régulier, en ce sens que ses migrations sont certaines, je dirai même immuables, bien qu’elles ne se produisent que tous les deux ou trois ans. Pourquoi ces migrations et pourquoi tous les deux ou trois ans ? Ce point n’est pas nettement établi, mais voici une explication au moins acceptable. Nous savons tous que cet oiseau habite de préférence les pays nordiques, en particulier la Norvège, qu’il abonde dans la forêt Noire, mais aussi qu’il vit, en France, en colonies plus ou moins nombreuses. Or les geais résidant en France sont nettement sédentaires. Chez moi, pour les différencier des nomades, on les appelle les « geais de pays », bien qu’ils soient exactement semblables aux autres. Le geai n’est pas sensible au froid. Il est chaudement habillé. Rustique, il se nourrit facilement. J’ai trouvé dans son robuste estomac : du froment, du maïs, de l’avoine, des châtaignes, des glands, des faines, mais je sais qu’il ne dédaigne pas, à l’occasion, les gros insectes et même les petits oiseaux pillés au nid. Il est toujours maigre. Ce n’est pas le manque de confort qui le pousse à rechercher meilleure table au moment des grands froids, comme l’hirondelle, la bécasse, etc., et tout le gibier dit de passage. Il paraît donc obéir à cette loi brutale qui commande les grandes invasions, loi commune, hélas ! aux hommes et aux criquets du désert, qui a son explication dans l’insuffisance du fameux espace vital. Il y a exode lorsque la population déborde et souffre de la famine. J’ai l’avantage, si j’ose dire, d’habiter une localité dans laquelle le passage des geais est considéré par la population non pas comme un fléau, mais bien à la manière d’une sorte de rente perpétuelle garantie par l’État, au point que, lorsque ladite rente ne tombe pas à l’échéance prévue, on récrimine contre les « responsables » et on attaque ouvertement la République. Je ne partage pas entièrement, quant à l’utilité de cette manne céleste, la forte conviction de mes concitoyens. Je constate, en effet, que, les années de passage, mes châtaignes et même mes pommes sont raflées tant par les oiseaux que les chasseurs, tous gros consommateurs de fruits, mais, étant chasseur moi-même, je n’insisterai pas outre mesure. Depuis quarante ans, j’observe, pour y participer quelque peu, l’amusant branle-bas de combat que je vais décrire, affirmant au surplus qu’au dire des anciens du pays, respectables centenaires ou presque, nous ne faisons les uns et les autres, j’entends des geais et de nous chasseurs, que rester dans la tradition. Voilà donc ce que j’ai vu cette année, exactement comme il y a quarante ans, et régulièrement tous les deux ou trois ans dans cette même période de près d’un demi-siècle, bien lourde à nos épaules.
Au bas, dans le village, les yeux braqués vers le ciel, les femmes, les enfants et les vieux commentaient la fusillade tout en comptant avec une envie gourmande les gros points noirs des oiseaux échappant au massacre et plongeant dans le vide. Lorsque l’angélus sonna, par petits coups bruyants, les tireurs reprirent pour la descente l’étroit sentier frayé dans l’épaisseur des buis, chacun portant sur l’épaule un sac plus ou moins gonflé de plumes : j’entends d’un sac à pommes de terre. Entre eux, très excités, ils déclaraient les résultats : 40, 50, 75, etc., mais, certaines années, j’ai vu des records journaliers dépasser la centaine ! ... Si l’on veut bien considérer que, chaque matin, sur la seule arête des « Creux », vingt à trente postes sont occupés, que le dimanche tous les postes « possibles » ont leur amateur, que les geais passent partout, sur toutes les crêtes, que la passée dure un mois, parfois plus, je puis affirmer que, dans notre seule commune, qui compte environ 200 fusils ... officiels et pas mal d’autres, il se tue en moyenne 30.000 à 35.000 oiseaux en passage normal. Mais il s’en tue presque autant dans nombre de communes voisines, notamment aux portes mêmes de Grenoble. C’est donc par dizaines de milliers que les geais tombent dans le département, tous les deux ou trois ans. Au point de vue financier, la question n’est pas sans intérêt. Les geais se vendaient cette année 50 francs sur place et 60 francs à Grenoble (0 fr. 15 il y a quarante ans). Ils étaient « commandés » à l’avance aux spécialistes les plus réputés, car nous en avons. On voit toute l’importance de la spéculation. Cependant ce « gibier » grossier est mangeable, sans plus, dépouillé, écorché à la manière d’un lapin et mis en civet. Comme qualité, il peut se comparer à la macreuse ou au foulque, avec un fumet différent, quoique aussi puissant. Enfin je ne pourrais passer sous silence le profit indirect réalisé d’abord par l’État sur la vente des poudres, bien qu’il ne soit pas fabricant exclusif, tout « brûleur de loup » qui se respecte ayant dans sa tête plus d’une formule au moins suffisante, ensuite par les armuriers locaux, qui ont vendu jusqu’à leur dernière capsule sans aucun marchandage. Quant au ravitaillement général, il a trouvé là, sans le concours d’aucun ministre, un large appoint : ce qui prouve que les ministres ne sont pas toujours nécessaires. Au point de vue cynégétique, cette chasse, sans aucun intérêt pour le tir, serait malgré tout un massacre regrettable, comme tous les massacres, si le geai n’était vraiment un nuisible. Je ne plaiderai donc pas pour ce pillard, quelle que soit sa gentillesse dans la profondeur des bois ou son utilisation dans l’ordre « social ». Pour en terminer avec notre oiseau, je dirai qu’il est un imitateur de premier ordre. Avec une facilité étonnante, il contrefait toutes les voix de la forêt. Un jour entre tant d’autres que Dieu seul connaît, seul en montagne, j’attendais le chamois tassé au pied d’un gros « fayard ». Successivement, j’entendis sur ma tête un invisible écureuil jouer des castagnettes, un aigle siffler, puis un grand duc hululer à plein bec. Ce n’était pourtant pas son heure de chant. Je ne bougeais pas plus qu’un roc, assez mimétisé, du reste, par une veste et un feutre couleur de pierre. Finalement, entre les branches, je vis sautiller le mystificateur dans son superbe habit roux, blanc et bleu. C’était un geai. La venue à pas feutrés de l’hôte de marque que j’attendais mit fin à ses plaisanteries. Mon fusil fut brutal. Le chamois s’écroula, et ce fut à nouveau le grand silence au seul bourdonnement des mouches. Jean LEFRANÇOIS |
|
|
Le Chasseur Français N°622 Octobre 1948 Page 198 |
|
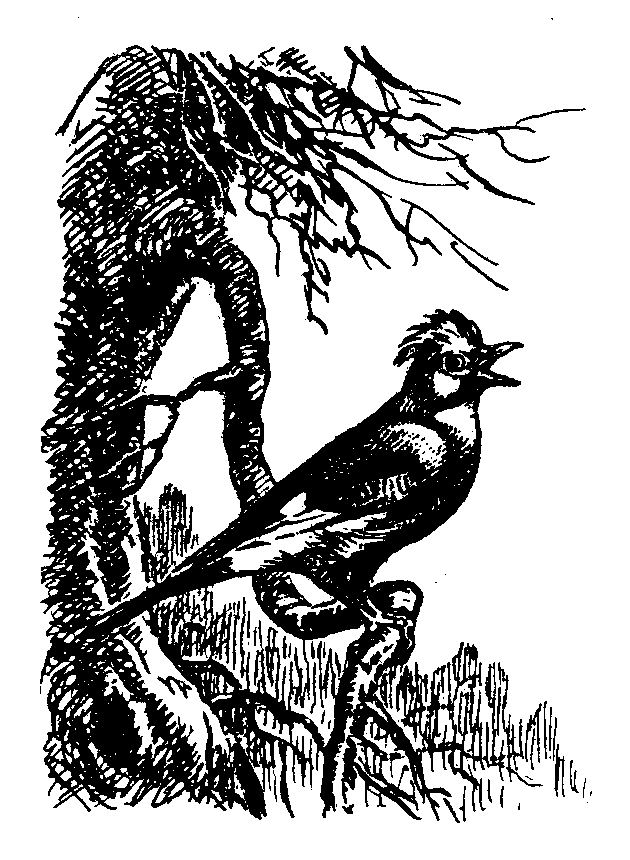 Aux premiers jours de septembre, la crête de
l’immense croupe rocheuse que nous nommons « Les Creux » parce
qu’elle recèle en ses flancs d’importantes et traîtresses crevasses (anciennes
poches de sable réfractaire aujourd’hui vidées), s’est hérissée de
« baliveaux » et, la nuit, un grand feu allumé dans l’unique
clairière du sommet a indiqué aux profanes que les chasseurs tenaient sur place
leur veillée d’armes. Ils étaient montés la veille dès midi. Leur équipe, munie
de fortes cognées, la « goyarde dauphinoise », s’était mise au
travail. Chacun avait dressé son poste aux emplacements traditionnels. Un poste
est fait de deux grandes perches fixées dans deux trous de rocher et reliées
par plusieurs barres transversales. Voilà pour l’assommoir. À 15 mètres
derrière, car le chasseur doit avoir le dos tourné au sens d’arrivée, en raison
de la vue perçante de l’oiseau, la « planque » ou cahute, faite de
rameaux de buis enchevêtrés avec une étroite meurtrière et une grosse pierre en
guise de siège. J’ouvre ici une parenthèse pour citer quelques postes célèbres
édifiés par la nature et respectés par la foudre ou la hache. Ce sont des
arbres légendaires, au chef dénudé, le gros chêne, « La Cerisole »,
« Les Tramoux », etc., très convoités ; ils sont toujours
occupés. Vers sept heures, lorsque le soleil commença à dorer les perchoirs, un
premier coup de feu claqua tout là-haut, à la pointe du roc, et le tir se
déclencha, comme à la guerre. Sans interruptions, sur les larges croisillons de
bois incendiés de lumière, les geais se posaient, confiants, et tombaient
foudroyés. Cela devait durer jusqu’à midi.
Aux premiers jours de septembre, la crête de
l’immense croupe rocheuse que nous nommons « Les Creux » parce
qu’elle recèle en ses flancs d’importantes et traîtresses crevasses (anciennes
poches de sable réfractaire aujourd’hui vidées), s’est hérissée de
« baliveaux » et, la nuit, un grand feu allumé dans l’unique
clairière du sommet a indiqué aux profanes que les chasseurs tenaient sur place
leur veillée d’armes. Ils étaient montés la veille dès midi. Leur équipe, munie
de fortes cognées, la « goyarde dauphinoise », s’était mise au
travail. Chacun avait dressé son poste aux emplacements traditionnels. Un poste
est fait de deux grandes perches fixées dans deux trous de rocher et reliées
par plusieurs barres transversales. Voilà pour l’assommoir. À 15 mètres
derrière, car le chasseur doit avoir le dos tourné au sens d’arrivée, en raison
de la vue perçante de l’oiseau, la « planque » ou cahute, faite de
rameaux de buis enchevêtrés avec une étroite meurtrière et une grosse pierre en
guise de siège. J’ouvre ici une parenthèse pour citer quelques postes célèbres
édifiés par la nature et respectés par la foudre ou la hache. Ce sont des
arbres légendaires, au chef dénudé, le gros chêne, « La Cerisole »,
« Les Tramoux », etc., très convoités ; ils sont toujours
occupés. Vers sept heures, lorsque le soleil commença à dorer les perchoirs, un
premier coup de feu claqua tout là-haut, à la pointe du roc, et le tir se
déclencha, comme à la guerre. Sans interruptions, sur les larges croisillons de
bois incendiés de lumière, les geais se posaient, confiants, et tombaient
foudroyés. Cela devait durer jusqu’à midi.