| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°622 Octobre 1948 > Page 200 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
En Éthiopie

|
Une chasse au koudou |

|
|
Ce matin de juillet, j’avais, dans la nuit finissante, quitté avec ma caravane le campement du père Madlène, vieil Alsacien au cuir tanné par de nombreuses années de brousse vécues surtout dans les régions équatoriales et employées à la construction de voies ferrées dans des pays fort distants les uns des autres, comme la Chine du Sud, le Brésil, la Bolivie, l’Éthiopie, etc. L’épopée serait à écrire de ces audacieux travailleurs du rail qui, bravant les périls dus au climat, aux hommes et aux bêtes, ont établi par le vaste monde la renommée du génie français. Nous observions l’ordre de marche habituel suivi depuis Diré-Daoua. Je cheminais à cheval, précédé, à cent mètres environ, par mon boy Matane et son aide et cousin Ahmed, tous deux de race Somalie. Derrière moi venaient les mulets de charge portant tout le matériel nécessaire pour l’expédition de reconnaissance que j’effectuais en direction du fleuve Aouache. Avec les soldats abyssins engagés pour notre garde, la caravane se composait d’une quinzaine d’hommes et d’une dizaine de mulets. Le terrain que nous foulions à nos pieds, ce n’était plus celui de l’affreux désert dankaliissa, aux rougeoyantes brûlures, qui s’étend sur 300 kilomètres entre Djibouti et Diré-Daoua. Nous avions d’ailleurs gagné l’altitude de 1.300 mètres au laga (rivière) Moulou. Au pied du mont Afdem et jusqu’au mont des Assabots, à notre droite, sur plus de 100 kilomètres, c’était une succession de prairies où poussaient les mimosas en parasol, les aloès, les agaves, les jujubiers. En maints endroits se dressaient des fourrés impénétrables tout garnis d’épines acérées. Cette région constituait et constitue toujours un des plus beaux terrains de chasse de l’Est africain. Les hauts seigneurs de la Cour éthiopienne y viennent d’Addis-Abeba, à 350 kilomètres dans l’Ouest, se livrer aux plaisirs cynégétiques qui sont fructueux, étant données l’importance et la diversité du gibier, poil et plume : gazelles, koudous, oryx, digs-digs, de la grande famille des antilopes, de toutes tailles et de toutes robes, phacochères, pour le poil ; pintades, francolins, outardes, tourterelles, pour la plume. Et les tribus de singes, de différentes variétés, les vénérables gourézas, longues queues soyeuses, manteaux noirs bordés de blanc, les hideux hamadryas, et les tout petits qu’on appelle totas. Sur tout ce monde animal dont l’énumération serait encore plus longue, le léopard prélevait sa dîme et, bien plus rarement, le lion, dont on notait les rares et brefs passages. La hyène et son suivant, le chacal, s’attaquaient surtout aux charognes. Dans le ciel, d’énormes et affreux vautours.
J’avançais au pas vif de mon cheval, mon fusil de chasse calibre 16 placé en travers de la selle. Mon cuisinier, Guédé Darod, flanqué de son marmiton, tous deux Somalis aussi, marchait à côté de moi portant ma carabine Winchester et un long et large couteau de cuisine, dont je préciserai plus loin l’emploi. Des gourézas gambadaient sur des arbres voisins et l’un d’eux, se suspendant à la branche d’un mimosa, à ma droite, fit un bond et se lança sur un arbre, à ma gauche, en franchissant ainsi, à mon nez, une dizaine de mètres avec la plus grande aisance. Malgré un brusque écart de ma monture, je me retrouvai en selle juste pour voir mes deux boys d’avant-garde s’arrêter, se baisser et revenir sur moi en courant. Matane, arrivé à ma hauteur, me chuchota : — Fissa (vite), moussié. Y en a koudou kébir (grand) beaucoup, là, devant ! Je sautai vivement à terre, empoignai la Winchester et me glissai jusqu’au point où Matane s’était arrêté. Matane, de son côté, avait pris mon calibre 16 et le couteau du cuisinier. En effet, à 400 mètres de nous environ, un superbe koudou broutait tranquillement l’herbe reverdie, à l’ombre des mimosas. J’avisai à moitié distance un arbre couché en travers par la foudre. Je commençai une reptation guerrière, m’aidant des genoux et des coudes et répétant mentalement : « Je ne tirerai que lorsque j’aurai touché l’arbre. Je ne tirerai que lorsque j’aurai touché l’arbre. » J’y arrivais, à l’arbre, et la cible superbe du solitaire s’offrait à mes yeux. Plus qu’une dizaine de mètres. Ah ! bien oui. Le koudou, qui, depuis quelques instants, donnait des signes d’impatience, tournait plusieurs fois sur lui-même, jetait la croupe en l’air et, en quelques foulées, disparaissait. Je ne tirai point. Lorsqu’un gibier de cette sorte est levé, il ne faut pas précipiter sa fuite. Il faut attendre, afin d’essayer de le relever plus loin. Je rejoignais la caravane, assez vexé. Matane, sentencieux, prononçait placidement : — Ça y en a foute le cam kif erueb (comme le lièvre). Cependant, un soldat abyssin, du nom de Damassié, qui avait assisté à la scène, s’approchait de moi et, par signes, car il ne parlait que la langue amharique, me fit comprendre qu’on retrouverait la bête. Je l’avais remarqué, ce Damassié. En lui, j’avais reconnu le vrai coureur de brousse, le hardi et rusé chasseur. Grand, élancé, vigoureux, l’œil vif, le geste prompt, l’allure prudente. Il déchiffrait sur le sol toutes les traces du gibier et, d’après l’empreinte, connaissait la bête. En effet, en suivant le mangad (la piste), car il ne peut être question de routes construites et entretenues dans ces immensités solitaires, il voyait la marque toute fraîche du koudou. Des bandes de pintades et de francolins se levaient à notre approche. Je les négligeais pour le moment, ne voulant pas troubler le silence de la forêt. La veille, du côté de Dalladou, j’en avais tué assez pour assurer la nourriture des hommes. Et il me fallait une grosse bête pour varier. Cette grosse bête, je crus la saisir sur l’heure. Dévalant vers un nouveau laga, le Méhesso, une énorme laie phacochère se sauvait avec sa progéniture, cinq ou six marcassins. Le phacochère, ce grand sanglier du Centre africain, haut sur pattes, à la tête énorme, aux défenses puissantes. Tout de suite, j’étais en bas du cheval et la poursuite commençait, endiablée. Cette fois, nous étions quatre à l’attaque de la bande porcine, car, à Matane, brandissant le couteau, et à moi, Damassié et le marmiton s’étaient joints. De ce côté du laga Méhesso, la brousse était plus dense. La mère et ses petits apparaissaient, disparaissaient et, quand j’épaulais, toujours d’un peu loin, je ne voyais plus rien au bout de la mire de ma Winchester. Nous nous éloignions beaucoup et nos coups de trompe, lancés à espaces réguliers, n’éveillaient plus que des réponses à peine perceptibles de celle de la caravane. Le soleil avait atteint le zénith. Et Damassié, silencieux et obstiné, nous emmenait toujours plus loin, jusqu’à une grande mare où, parmi le piétinement des innombrables bêtes de la brousse qui venaient y boire au crépuscule, les traces des phacochères se perdaient. Je fis donc demi-tour, bredouille une fois de plus. Cette fois, Matane était exaspéré. Il injuriait, dans un amusant sabir où se mêlaient les mots de plusieurs langues, ce gibier qui ne voulait pas se laisser faire. — Inahâdine bouk ! Inahâdine mouk ! Inahâdine bebek ! (Je maudis ton père ! Je maudis ta mère ! Je maudis ton grand-père !) Toutes dites grandes saloperies ! Nous retrouvions la caravane, et Damassié relevait encore les traces du koudou du matin, orientées, cette fois, vers le mont des Assabots. C’était à prendre ou à laisser. Je pris, escorté de mes quatre bonshommes. Il me fallait de la viande fraîche. Cette viande fraîche, enfin, je l’eus, j’avançais de front avec l’Abyssin qui suivait les traces. Une demi-heure passa dans le plus complet silence. Des pintades couraient à pattes sur le gazon. Alors que nous contournions un massif de jujubiers encombrés de lianes et débouchions sur une petite prairie limitée par un ravin, je vis la bête, le koudou, soudain dressé, car il se reposait là, se croyant en sécurité, magnifique avec ses cornes annelées haut dressées et prêt à bondir. Il n’en eut pas le temps. J’avais épaulé et tiré aussi vite que je roulais le garenne fuyant dans les ronciers des bois, aux confins de l’Île-de-France et de la Picardie, où j’avais commencé tout jeune à chasser. Et, comme il se présentait de biais, à vingt pas, la balle, pénétrant sous les dernières côtes, l’avait traversé à peu près dans le sens de la longueur et lui avait percé le cœur en le lui faisant éclater. En quelques bonds, Matane était sur lui, le fameux couteau levé, alors qu’il s’agitait dans les derniers spasmes de l’agonie. Il l’égorgeait, la tête du koudou tournée vers La Mecque, et prononçait les paroles rituelles avant qu’il ne bougeât plus. Un bon musulman ne mangerait point de la viande d’un animal qui n’aurait point été traité de cette façon. Et Damassié n’était pas en reste de religion, car, suivant la sienne, la copte, il tournait à son tour la tête, en murmurant la prière d’usage, vers Alexandrie d’Égypte d’où l’on envoyait le nouveau chef de l’Église d’Abyssinie lorsque celui qui était en fonctions décédait. Notre trompe sonnait. Dans le lointain, l’autre faisait de même. D’ailleurs, le coup de feu avait réveillé tous les échos. Il y eut festin, le soir, au campement. La viande grillait sur les brasiers pendant que l’injira (crêpe de farine de millet) cuisait sur les plaques de tôle préalablement frottées d’huile. Il fallut deux mulets pour ramener le grand koudou dont les cornes mesuraient 0m,80 de hauteur et 0m,60 d’écartement entre les pointes. Et si les Allemands ont fait main basse sur une partie de mes souvenirs d’Afrique, celui-là, je l’ai toujours. S. COLAS-DEVELLENNE. |
|
|
Le Chasseur Français N°622 Octobre 1948 Page 200 |
|
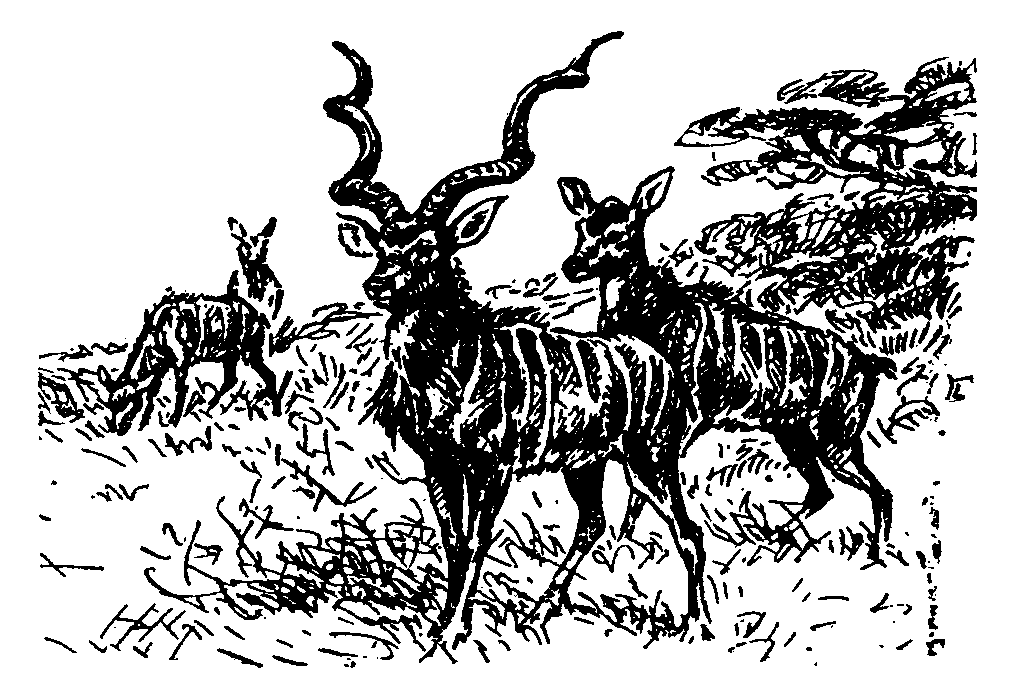 Depuis notre départ du campement Madlène, le jour
était venu, très rapidement, ainsi qu’il naît sous les tropiques. Le soleil,
surgissant de l’océan Indien, dorait les crêtes des monts Tchercher, à notre
gauche. De partout s’élevait le roucoulement des tourterelles, le chant clair
des francolins, le cri guttural et saccadé des pintades. Une grande douceur
s’étendait sur le paysage frais et comme lavé. Ainsi devait être la terre en
son premier âge. Les orages saisonniers avaient éclaté sur les montagnes
voisines, poussant en cascades furieuses les eaux dans les lagas à très forte
pente. Et la pluie bienfaisante arrivait sur nous.
Depuis notre départ du campement Madlène, le jour
était venu, très rapidement, ainsi qu’il naît sous les tropiques. Le soleil,
surgissant de l’océan Indien, dorait les crêtes des monts Tchercher, à notre
gauche. De partout s’élevait le roucoulement des tourterelles, le chant clair
des francolins, le cri guttural et saccadé des pintades. Une grande douceur
s’étendait sur le paysage frais et comme lavé. Ainsi devait être la terre en
son premier âge. Les orages saisonniers avaient éclaté sur les montagnes
voisines, poussant en cascades furieuses les eaux dans les lagas à très forte
pente. Et la pluie bienfaisante arrivait sur nous.