| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°622 Octobre 1948 > Page 218 | Tous droits réservés |
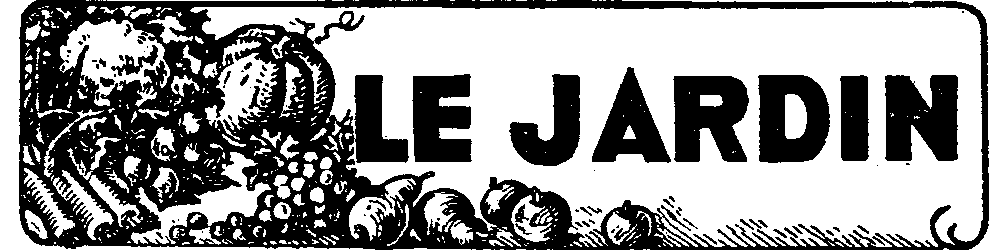
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Un fléau de nos vergers
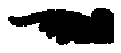
|
Les cochenilles |
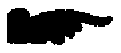
|
|
Les années sèches que nous avons traversées ont été très favorables à la multiplication, dans nos plantations fruitières, de diverses espèces de cochenilles ou Kermès. L’attaque de ces insectes est, la plupart du temps, insidieuse. Elle provoque un dépérissement progressif, souvent rapide, que l’observateur non averti ne sait trop comment expliquer, et qui se termine par la mort des branches et parfois de l’arbre tout entier. En regardant de près les écorces, on s’aperçoit qu’elles sont, par endroits, recouvertes de croûtes qui se soulèvent lorsqu’on les gratte, croûtes constituées par des carapaces dont les cochenilles sont recouvertes. La forme de ces carapaces, de même que leur couleur, permettent de différencier les espèces dont le mode de vie varie assez sensiblement et dont certaines sont beaucoup plus redoutables que d’autres. Parmi les plus dangereuses pour nos arbres fruitiers, il convient de citer : La cochenille virgule qui, comme son nom l’indique, a une carapace ou bouclier, de couleur brune, de 3 à 4 millimètres de long, affectant la forme d’une virgule. Cette espèce s’attaque surtout au pommier, quelquefois cependant au poirier. La cochenille ostréiforme, dont le bouclier est rond, gris ardoisé, de 2mm,5 de diamètre. On la trouve sur toutes les essences fruitières, mais surtout sur le pommier et le poirier. Les œufs, pondus au printemps par les femelles qui ont hiverné, donnent naissance à des larves pendant l’été, le plus souvent au mois de juin. La cochenille rouge du poirier, très répandue et dangereuse, dans le centre de la France, sur les pommiers, poiriers et pruniers. Le bouclier circulaire, gris sale, de 2 millimètres de diamètre, recouvre une femelle d’un rouge vineux qui, pondant au printemps de nombreux œufs, propage rapidement l’espèce. Les jeunes larves apparaissent en juin. Le pou de San José, originaire de la Chine, qui a déjà causé des dégâts extrêmement importants en Californie et s’est également répandu en différentes régions de l’Europe. En France, on a constaté sa présence sur le littoral méditerranéen, dans la région lyonnaise et plus récemment dans la Nièvre. La femelle se trouve sous un bouclier circulaire de 1 millimètre à 1mm,5 de diamètre, de couleur ardoise. Elle-même est jaune-citron et présente peu de différence avec la cochenille ostréiforme. Elle s’attaque à tous les arbres fruitiers et même à certains arbres forestiers et d’ornement. Les espèces les plus redoutables sont la cochenille rouge du poirier et le pou de San José. En pompant la sève des arbres qu’elles attaquent, elles les affaiblissent et, d’autre part, les empoisonnent par certaines toxines qu’elles injectent dans leurs vaisseaux. La multiplication de ces insectes est rapide, beaucoup plus encore pour le pou de San José, qui peut avoir plusieurs générations par an, que pour les autres cochenilles, qui n’ont qu’une génération. On a pu remarquer que les invasions sont plus graves dans les vergers habituellement traités avec des bouillies bordelaises riches en chaux. De sorte qu’on peut conseiller de recourir de préférence aux oxychlorures de cuivre pour effectuer les traitements préventifs contre les maladies causées par des cryptogames. Traitements recommandés.— Les traitements peuvent être effectués soit en été, au moment où les larves viennent d’éclore et ne sont pas encore protégées par un bouclier, soit en hiver. Toutefois, les traitements d’hiver ne peuvent avoir d’efficacité que contre la cochenille ostréiforme, la cochenille rouge du poirier et le pou de San José. La cochenille virgule, très bien protégée par sa carapace, ne peut être atteinte par les traitements d’hiver. Les produits les plus efficaces sont les huiles blanches ou huiles de pétrole. Elles s’utilisent en hiver à la dose de 3 p. 100 environ et pendant le cours de la végétation à 1 p. 100. Elles recouvrent la carapace de l’insecte d’une couche très mince, mais continue, l’isolant complètement de l’air extérieur et provoquant une asphyxie rapide. En juin, l’huile blanche peut être simplement ajoutée aux bouillies cupro-arsenicales qu’on utilise à cette époque contre la tavelure et le carpocapse. Par contre, elle ne doit pas être mélangée avec les produits de traitement renfermant du soufre, comme, par exemple, les bouillies sulfocalciques. Il convient d’observer, en outre, un intervalle d’une quinzaine de jours entre le traitement aux huiles blanches et celui avec un produit soufré, ou vice versa. En résumé, on peut affirmer que, bien faits, les traitements contre les cochenilles donnent, à l’heure actuelle, d’excellents résultats et permettent d’atténuer considérablement les dégâts de ces dangereux parasites. E. DELPLACE. |
|
|
Le Chasseur Français N°622 Octobre 1948 Page 218 |
|