| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°623 Décembre 1948 > Page 246 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Ouverture |

|
|
Je suis parti ce matin, au petit jour, seul, par un temps sombre et qui ne fait rien présager de bon. Seul, un jour d’ouverture, dans ce pays où tout le monde a la chasse dans le sang, où cette journée fait couler, pendant la semaine qui la précède, des flots de paroles et donne lieu, la veille, à des plans combinés comme des plans de bataille. Seul, alors que c’est toujours en compagnie, à quatre, cinq et plus quelquefois que cette première sortie a lieu. C’est que, cette année, la vendange est commencée et que, vu le temps qui menace, on ne veut pas perdre le peu de récolte que la grêle a laissée. Le village est presque désert. Alors que, les autres années, dès quatre heures du matin, c’est un va-et-vient continuel, avec des appels de chasseurs et des aboiements de chiens, c’est le calme plat. Au dernier carrefour, rendez-vous habituel où l’on s’attend les uns les autres : personne. Et le vent marin souffle sous un ciel tout noir et menaçant. Sur la route non plus, personne encore, là où, d’ordinaire, les bandes de chasseurs se suivent à dix pas. Je quitte la route et prends le chemin des garrigues. Pas un chasseur ni un chien en vue. C’est inimaginable et je n’en peux croire mes yeux. Je pense : triste ouverture. Ça donnerait presque envie de retourner à la maison. Me voici au bout de la montée, là où commence la garrigue, royaume des perdreaux. Il fait jour et, déjà, à cent cinquante mètres, je les vois courir dans le chemin. Avec ce temps, ils vont être inabordables. D’autant plus que, depuis un mois, ils connaissent déjà la musique, car il y a des gens qui ne se gênent guère. Je hâte le pas, mais les cailloux roulent sous mes pieds et « brrr », j’entends partir la bande dans les petits pins. Ils ne vont pas être commodes, ce matin ! J’entre au fourré : un retardataire, surpris, me part sous le nez. Allons, voici la première pièce : un jeune mais beau tout de même, car nous sommes aux premiers jours de septembre. Je fais halte deux minutes pour le mettre dans mon carnier. En bas, sur la route, sur les chemins, commencent à s’apercevoir les charrettes et les bandes de vendangeurs. Le bruit des roues, les cris des gens et des chiens montent avec le vent qui roule de gros nuages et secoue les pins. Pas un coup de fusil, encore, n’a retenti, autre que le mien.
Et ainsi je continue, de coteau en coteau, de vallon en vallon, d’herme en herme, dans ces garrigues que j’aime pour leur charme rude et parfumé, mais auxquelles manque, aujourd’hui, le soleil. Et la garrigue sans soleil, ce n’est plus la garrigue. Il faut, en effet, à ce paysage tout en grisaille et en vert foncé, le grand ciel bleu et l’éblouissement de la lumière. Je passe la « borie » de Milhet, avec son bouquet de pins agités, longe les Cresses et me voici en face de la Baume. La masse verte des pins met une note sombre au fond de cette combe isolée. Je me rappelle les déjeuners d’autrefois, celui de ma première ouverture avec mon père, auprès de la fontaine glacée, sous l’ombre si fraîche où, parfois, trente ou quarante chasseurs étaient rassemblés. Le vent apporte quelques gouttes : c’est la pluie. L’horizon, du côté de la mer invisible, est noir et menaçant. Je cherche l’abri d’une vieille cabane en pierres sèches, affût de quelque amateur de chanterelle. Des perdreaux passent, trop loin, rasant le sol, poussés par le vent, et plongent dans le vallon. En voici un qui rappelle, tout près. Immobile, j’attends que la giboulée cesse. Dans les thyms et les lavandes, je le vois courir, tête haute et cou tendu. Il s’arrête, repart, jette encore un appel que le vent emporte. Un instant, je le perds de vue, puis le voilà escaladant une murette. Alors je me lève, mais il s’envole aussitôt, hors de portée. Alors, dans le sentier, arrive un grand lièvre qui n’a pas l’air bien pressé. À petits pas, à petits sauts, il se prélasse. Approchera-t-il assez pour être à portée de mon fusil ? Ah ! déveine. Le voilà qui fait demi-tour et disparaît. Si je pouvais le retrouver ! Je cherche. Brr ! Un perdreau part sur ma gauche d’une grosse haie de kermès bordant un amoncellement de pierrailles. Je le manque royalement ; abasourdi, j’oublie de lui envoyer mon second coup. À chaque instant, à présent, j’en vois voler ou courir, isolés ou par petits groupes, mais toujours au diable vert ! Soudain, un autre lièvre. Il vient vers moi, celui-là aussi, en plein chemin. Ce n’est pas celui de tout à l’heure, car il est de moins belle taille. Je suis derrière un mur que traverse le chemin. Anxieux, je l’attends, le doigt sur la détente, quand le voici qui débouche et s’arrête à trente pas de moi. Je le vois déjà dans mon carnier. Hélas ! un petit « clac » sec est le seul bruit que fait ma cartouche qui vient de rater. Ah ! les munitions de maintenant ! Surpris, je n’ai pas le temps de tirer mon coup gauche sur la bête, qui, déjà, d’un bond a rebroussé chemin de l’autre côté du mur. Je le retire quand il est déjà à une bonne distance. Mais en vain. Un chasseur surgit à qui je conte ma mésaventure. « Pas deux sans trois, me dit-il ; vous aurez le troisième. » Je ne prends pas son pronostic au sérieux et m’en vais, marri et découragé, quand le chien du bonhomme fait partir un autre oreillard que je tire, en cul, sur le chemin et qui se hâte de mettre de la distance entre lui et moi, laissant, pourtant, une touffe de bourre blanche. Cette fois, c’est la guigne des guignes, la noire, la vraie ! Je vais abandonner. Trois lièvres dans si peu de temps et tous partis ! Inutile d’insister. Je m’assieds sur un talus qui surplombe une friche nue, afin de déjeuner avant de partir. Je pose mon fusil désarmé et ouvre mon carnier sur mes genoux. Mais on dirait que ça trotte derrière moi. Je me retourne : encore un capucin ! Je jette carnier et déjeuner, saute sur mon arme et envoie, à quarante mètres, un coup de 7 à mon zèbre qui donne un coup de derrière de côté, grimpe le talus d’en face ... et se sauve. Cette fois, c’en est trop et je me demande si c’est bien vrai ou si je rêve ! Je déjeune sans grand entrain et, bien qu’il ne soit à peine que neuf heures, reprends le chemin du village en traînant des pieds dégoûtés. Que vous ai-je donc fait, ô vous, mon grand Patron ? Aurais-je enfreint, quelque jour, les règles du code du vrai chasseur pour me conduire en disciple de Braco, l’ange déchu, ou de Fusillot, l’incorrigible ? Et vous, belle déesse, antique mais toujours jeune Diane, vous aurais-je été, quelque jour, infidèle ? Vous savez bien que non, l’un et l’autre, pourtant. Alors, pourquoi tant de torture et d’humiliation ? Enfin, un perdreau que je dégringole me donne un peu de courage. Avant de rentrer, deux autres encore viennent accroître mon butin. Et, bien sûr, je pourrais m’estimer heureux avec mes cinq oiseaux. Tout de même, quatre lièvres en si peu de temps, dont trois tirés, et aucun dans le sac ! N’est-ce pas, ô vous mes frères en saint Hubert qui me lisez, que l’on peut appeler cela de la « guigne » ? Et je vous assure que je me souviendrai longtemps, et non sans regret ni rancœur, de cette ouverture qui s’annonçait, au départ, si morose et qui, malgré tout, eût pu être, pour un modeste chasseur, un vrai triomphe. FRIMAIRE. |
|
|
Le Chasseur Français N°623 Décembre 1948 Page 246 |
|
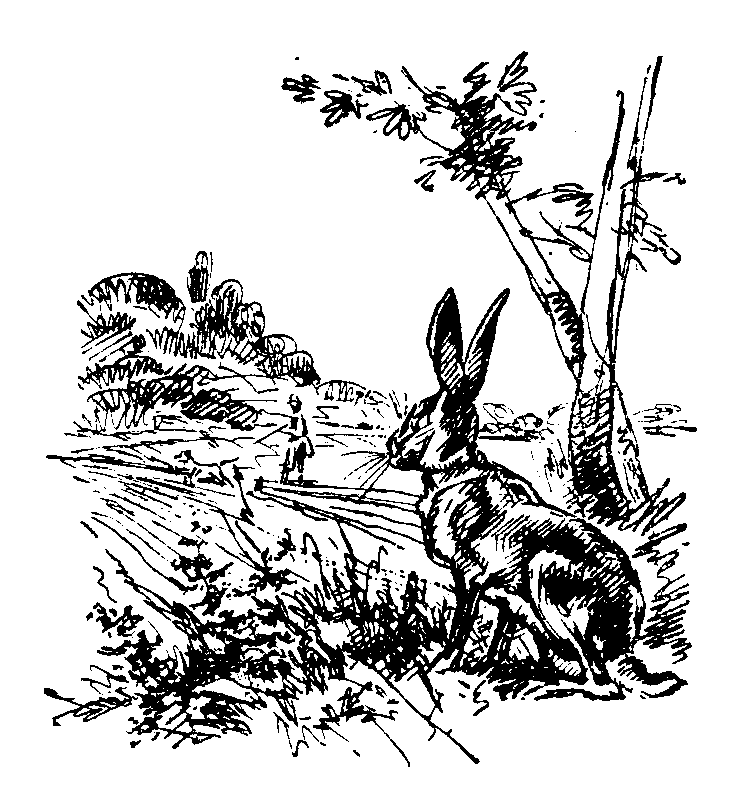 Je repars, jetant, de temps en temps, quelque caillou
dans une touffe, car, pour comble, je n’ai pas de chien. Mais les perdreaux ne
se bourreront pas aujourd’hui. J’en vois deux, là-bas, traverser un herme à
toutes pattes ; ils ont l’air, vraiment, d’avoir une sainte frousse. Ils
entrent dans une vigne, la traversent en vitesse et sautent sur la muraille qui
la limite : un, deux, d’autres encore qui grimpent sur le mur, sautent
d’un tas de pierres à l’autre, se tenant, toujours, à distance respectueuse :
cent mètres et plus. Les voilà disparus de l’autre côté. Enfin, je les pousse
plus bas, dans la Combe de Marcousse. Surpris, cette fois, car je les ai
tournés contre le vent, ils s’envolent, cinq, six, à droite, à gauche. Et en
voici un qui dégringole. Enfin, ce ne sera pas la bredouille.
Je repars, jetant, de temps en temps, quelque caillou
dans une touffe, car, pour comble, je n’ai pas de chien. Mais les perdreaux ne
se bourreront pas aujourd’hui. J’en vois deux, là-bas, traverser un herme à
toutes pattes ; ils ont l’air, vraiment, d’avoir une sainte frousse. Ils
entrent dans une vigne, la traversent en vitesse et sautent sur la muraille qui
la limite : un, deux, d’autres encore qui grimpent sur le mur, sautent
d’un tas de pierres à l’autre, se tenant, toujours, à distance respectueuse :
cent mètres et plus. Les voilà disparus de l’autre côté. Enfin, je les pousse
plus bas, dans la Combe de Marcousse. Surpris, cette fois, car je les ai
tournés contre le vent, ils s’envolent, cinq, six, à droite, à gauche. Et en
voici un qui dégringole. Enfin, ce ne sera pas la bredouille.