| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°623 Décembre 1948 > Page 286 | Tous droits réservés |
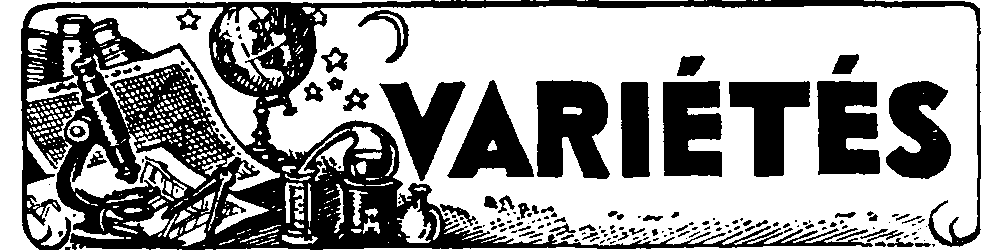
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
À travers le monde

|
Un théâtre chinois |

|
|
Nous sommes poussés vers une sorte de guichet grillagé, où l’on nous remet, en échange d’une liasse de dollars (il y en a bien pour vingt francs !), des tickets tout semblables à ceux du théâtre parisien, à cela près qu’ils sont sur papier pourpre et imprimé en chinois. Nous n’avons pas le temps de les examiner. Une seconde porte étroite, ornée d’un vieux rideau de velours cramoisi, nous absorbe ... et nous sommes au milieu du théâtre. Un vaste hall rectangulaire déjà plein d’une foule entassée, ravie, gloussante et respirante. Un déferlement d’électricité inonde un unique balcon disposé sur trois des côtés de la salle, et lui-même prêt à craquer sous le poids de ses occupants. Nous butons dans des chaises surpeuplées, disposées au hasard autour de petites tables. Puis voici des bancs de bois dont le dossier, en forme d’étagère, supporte le dîner de quelques affamés en train de se repaître : tasses de thé, soucoupes de viandes grillées et de sucreries. Dans le fond, une estrade étroite, haute d’un mètre. Un seul rideau derrière, d’un rose fatigué. C’est la scène. Pas le moindre portant, pas la moindre rampe, pas le moindre décor : ces détails sont méprisés du théâtre chinois ! Miraculeusement, nous avons pu dans un coin trouver deux chaises vides. Nous nous y asseyons et contemplons le spectacle. Celui de la salle. Il est pittoresque à souhait, et celui que nous attendons sur la scène ne saurait être ni plus tumultueux, ni plus tapageur, ni plus surprenant : une foule de messieurs à peu près dévêtus (la chaleur, il est vrai, rappelle l’équateur), discourant, plaisantant, riant, buvant du thé, mangeant — surtout mangeant ! — C’était bien la peine de nous presser de dîner avant de venir ! remarque Peter ... Jamais nous n’avons vu tant de dîneurs à la fois, vidant des bols de riz avec des baguettes plus goulues, ni dégustant avec plus d’évident plaisir ailes de canard laqué, saucisses de chien et foies de coq en brochettes ! Dans les jambes des mangeurs, et dans les nôtres, des enfants jouent et piaillent. Au milieu de tout cela, des garçons de restaurant parviennent à se faufiler, apportant des victuailles. Nous sommes pourtant bien au théâtre. D’ailleurs, voici un tintamarre grandissant contre lequel luttent en vain les causeurs, les deux mains en pavillon sur la bouche : c’est l’orchestre. Nous nous émerveillons, car nous n’avons pas encore vu, en Chine, un orchestre au grand complet. Près de la scène encore vide, les musiciens, en tenue de parade, sont rassemblés. D’abord cinq ou six joueurs de trompettes qui s’époumonent en conscience, tandis que les tambourinaires, à côté d’eux, frappent avec acharnement sur des peaux tendues. Il y a aussi de ces violons que nous connaissons bien, à deux ou à une seule corde, dont la crudité suraiguë, avec une cruauté persistante, perfore le tympan. Cependant, des hommes par là-dessus martèlent à contre-temps cette étrange symphonie, à l’aide de retentissantes claquettes de bois sec et de sonores battoirs de jujubier. Le Chinois est mélomane. L’orchestre a gagné. Le silence s’est presque établi dans la salle. Seul parfois un petit rire attardé descend du balcon, celui de quelque dame étourdie, et qui cache aussitôt sa confusion dans ses voiles : car le balcon est presque uniquement peuplé de dames, qui caquetaient tout à l’heure comme des perruches, mais qui, maintenant, s’apprêtent aux joies du spectacle. Et celui-ci commence. Sur l’estrade viennent de sauter des guerriers barbus, vêtus d’habits multicolores, soutachés d’or et surchargés de broderies. Ils s’agitent comme des diables et s’interpellent avec véhémence. Est-ce un ballet ? Est-ce une dispute ? Cela nous a tout l’air d’une bagarre. Les acteurs, en effet, après s’être lancé des clameurs de défi, en viennent aux mains. Ils se rouent de coups, s’arrachent mutuellement les moustaches, se roulent avec frénésie sur le sol, se relèvent, s’arrachent encore un peu de moustache ou de cheveux s’il en reste, se lacèrent de coups de sabre, hurlent et fulminent et, dans une clameur multipliée, sautent au milieu de l’orchestre, tout comme Lulli dans la représentation du Bourgeois Gentilhomme. C’était un ballet. Le public est délirant d’enthousiasme. Peter réclame du coton pour ses oreilles. Une pause. L’orchestre redouble ses efforts. Dans la coulisse, ou plutôt ce qui en sert, un recoin à gauche de l’estrade, sans aucun rideau pour les dissimuler, devant tous les spectateurs, les acteurs de la scène prochaine se préparent. On les voit s’attifer, se grimer, se pommader et se harnacher. Les costumes du théâtre chinois comportent non seulement des ornements de soierie, de clinquant et de brocart d’une déconcertante abondance et d’une richesse éblouissante, mais aussi des accessoires extraordinairement compliqués, fixés dans le dos, sur la tête de l’acteur, qui précisent le caractère ou le jeu de celui-ci. Chaque costume, chaque détail est symbolique. Ce personnage revêtu d’une robe de soie jaune (couleur, impériale) brodée de dragons d’or est un roi. Ces tuniques à l’éclat multicolore et pareilles à celles des généraux de l’antiquité sont celles de militaires. Une longue barbe rouge, une coiffure étrange ornée de plumes de faisans, et son propriétaire n’a besoin de se nommer à personne. Tout le monde l’a reconnu, c’est un magicien. Quant aux accessoires, pour moins imprévus et même intempestifs, dont s’agrémentent les acteurs, ils sont également compris immédiatement par le public. Ce général a des drapeaux fichés dans les épaules : c’est que son armée est présente derrière lui ; point de figurants inutiles ! Cet homme tient-il une rame ? Il est en bateau. Une cravache ? Il est à cheval. Le jeu lui-même n’est qu’une suite de conventions. Ainsi, le guerrier tué dans la bataille indique qu’il est frappé à mort par un geste de la main, tombe, puis aussitôt se relève et va contempler la fin du spectacle dans un coin de la scène. Quand cela lui paraît utile, l’acteur indique d’une phrase ce que doit imaginer le spectateur, et qu’un accessoire et un geste ne pourraient suffire à évoquer : « La mer en fureur envoie son écume jusqu’au sommet des remparts », ou bien : « La lune brille au sommet de la colline », ou encore : « La paix règne sur le village endormi », dit-il. Et voilà qui remplace avantageusement tous les décors ! Tout cela fait partie d’une règle du jeu admise une fois pour toutes par le public, éduqué depuis des siècles par la tradition. Gaétan FOUQUET. |
|
|
Le Chasseur Français N°623 Décembre 1948 Page 286 |
|
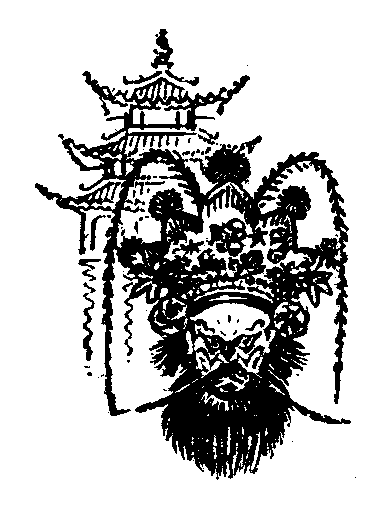 Le théâtre, vu de l’extérieur, a l’air d’un vaste
hangar. Seule à peu près, une lampe à gaz de pétrole, aveuglante, entourée d’un
halo d’insectes, distingue sa porte de celles qui sont voisines. Sur une
planche dorée, quelques caractères chinois sont tout de même le nom de
l’établissement. Comme tous les théâtres de Chine, celui-ci s’appelle
« jardin » de quelque chose : « Jardin des Joies
célestes », à moins que ce ne soit : « Jardin de l’Heureuse
Fortune », ou peut-être « de l’Harmonie vespérale », je ne sais
plus au juste, mais c’était quelque chose d’aussi ... simple et d’aussi
poétique. Malgré ce détail apaisant, c’est une ruée. En attendant les joies
célestes ou l’heureuse fortune, en dépit de l’harmonie vespérale, on joue ici
férocement des coudes et des hanches.
Le théâtre, vu de l’extérieur, a l’air d’un vaste
hangar. Seule à peu près, une lampe à gaz de pétrole, aveuglante, entourée d’un
halo d’insectes, distingue sa porte de celles qui sont voisines. Sur une
planche dorée, quelques caractères chinois sont tout de même le nom de
l’établissement. Comme tous les théâtres de Chine, celui-ci s’appelle
« jardin » de quelque chose : « Jardin des Joies
célestes », à moins que ce ne soit : « Jardin de l’Heureuse
Fortune », ou peut-être « de l’Harmonie vespérale », je ne sais
plus au juste, mais c’était quelque chose d’aussi ... simple et d’aussi
poétique. Malgré ce détail apaisant, c’est une ruée. En attendant les joies
célestes ou l’heureuse fortune, en dépit de l’harmonie vespérale, on joue ici
férocement des coudes et des hanches.