| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°624 Février 1949 > Page 291 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Au ferme ! |

|
|
« Au ferme ! » Le corniaud, chien de vaches ou roquet, vient de donner dans la brande, parmi les fourrés d’épines, de courts abois. À l’appel du louvetier, les quatre ou cinq fusils se placent rapidement, cernent le roncier. Et, dans un grand fracas, le goret démarre, salué de coups de chevrotines ou de balles (on n’avait guère le choix des munitions), tué, blessé ou manqué. Chasse passionnante qu’encadraient d’autres tireurs placés sur les lignes ou layons. Puis, en cas d’échec, on découplait ce que l’on avait comme chiens et l’on suivait tant bien que mal. Pas de rapprocheurs, peu ou pas de meutes ; seuls quelques cabots d’origine incertaine, mais souvent très mordants. Nous en avions connu de tels à la fin de l’autre guerre ; et même bien avant, mes souvenirs d’enfance évoquent un chien de berger, du nom de Ripus, grâce auquel, en forêt de Sudais, entre Blois et Amboise, les sangliers avaient été peu à peu décimés après l’invasion des Prussiens. Et pourtant, rien ou presque à donner dans les écuelles de nos fidèles auxiliaires. On leur refusait même le misérable « pain de chien » de 1917, boule de son et de balayures qui, du moins, trompait la faim, donnait, avec raves et carottes, un semblant de pâtée. Pas de meutes et pas de moyens de transport pour prendre les grands devants, à part nos vieilles bécanes aux pneus rafistolés. Des munitions au compte-gouttes et, comme armes, les rares fusils dont les occupants avaient, après combien de difficultés, consenti à débloquer de maigres lots. Oui, le mérite des lieutenants de louveterie fut exceptionnel, remarquable. Il est bon de le proclamer ; ce n’est pas trop tard, maintenant qu’ils ont purgé nos bois d’un contingent de bêtes noires vraiment excessif. Qu’en en juge par quelques chiffres puisés à bonne source : 2.000 sangliers tués dans la Vienne en 1944-1945 ; plus de 1.000 dans les Deux-Sèvres pendant le même hiver, dont une battue record de 23 animaux tués le 18 mars 1945 en forêt domaniale de Chizé. Bien typique fut, dans ce massif de 5.000 hectares, jouxtant les 3.000 d’Aulnay, la multiplication des sangliers depuis 1939 jusqu’à la Libération. Chizé n’avait pratiquement plus de sangliers depuis 1925, après en avoir recelé de nombreuses compagnies en 1914-1918. La forêt comporte de vastes parcelles de futaie plutôt claires, mais aussi quelques épais fourrés, plus fréquents en Aulnay. C’est dans ces « forts » que se cantonnèrent et se reproduisirent à outrance jeunes et grosses laies. De même qu’à Fontainebleau, forêt de promenade, contenant néanmoins des halliers d’étendue suffisante, les sangliers avaient proliféré au point de menacer rudement les cultures riveraines. Il va de soi que, dans les régions très boisées, l’Est, le Nord de l’Île-de-France, l’Ouest normand et breton, la Nièvre, le Bourbonnais, la guerre avait fait croître rapidement le nombre des bêtes noires ; ce qualificatif est d’exactitude assez douteuse, puisqu’on remarquait beaucoup d’animaux gris ou roux, à profils souvent dissemblables : groin allongé ou, tout au contraire, renfrogné, des types de cochons paraissant révéler des lieux d’origine fort différents. J’ai vu, le 17 janvier 1945, par temps de neige, au Rond-point d’Aulnay, neuf gorets au tableau, dont un gros mâle de 160 livres et huit laies de 60 à 100, parmi lesquelles une gorette presque isabelle avec des onglons blonds. Tous tués au ferme sous l’impulsion d’un excellent louvetier qui savait utiliser au maximum ses meilleurs tireurs. Parfois, l’on signalait une bête de poids très élevé ; tel ce cochon tué en forêt d’Orléans et pesant, vidé, 260 livres, ce qui devait faire, plein, environ 285. J’avoue n’avoir jamais vu mieux, bien qu’on ait signalé des animaux de 300 et plus. La forêt d’Orléans avait réalisé son maximum comme sangliers. Bien plus que Tronçais en Bourbonnais, où cependant, en 1914-1918, les cochons abondaient sur les 10.000 hectares du massif. Un louvetier en avait compté plus de cinquante sautant en bande la grande route de-Saint-Bonnet à Lurcy-Lévy dans les fonds de l’étang de Piraud. Mais Tronçais, en la dernière guerre, était très parcouru, très nettoyé par les exploitations, cela pour le plus grand bien des peuplements à éclaircir, mais aussi pour le constant dérangement du gros gibier ; or les sangliers réclament du calme ; ils fuient chasses à courre, sonneries de trompes, ateliers trop bruyants, trop animés des bûcherons. Et le sympathique rappel des ouvriers de forêt me fait songer à cet intrépide manieur de cognée des environs de Joinville, en Haute-Marne, ayant tué, m’a-t-on affirmé, à coups de hache, cinq dizaines de sangliers tenus au ferme par les écoutes grâce à deux roquets, véritables démons ; l’homme se glissait derrière la bête tenaillée par les chiens et lui assenait sur le crâne le coup d’assommoir. Tout aussi sportive était la chasse à l’épieu, renouvelée de l’ancien temps par des veneurs poitevins des environs de Lusignan : eux aussi accouraient au ferme, guidés par les abois des mâtins qui coiffaient le goret auquel le porteur d’épieu donnait, en plein flanc, le coup d’estocade ; il fallait pour cela des chasseurs aussi lestes que pleins de sang-froid, car le goret, tailladé, entraînait parfois son agresseur. Je note ces hauts faits à l’honneur de ceux qui dirigèrent ou encouragèrent de telles chasses dans les jours sombres de l’occupation. À partir de 1945, la diminution ou l’exode des sangliers s’accusa : exode si j’en crois de bons observateurs ayant vu des compagnies traverser la Loire du sud au nord en aval de Saumur ; diminution explicable par le nombre de laies tuées (j’ai noté, le même jour, dans un bois de 100 hectares de la Gâtine des Deux-Sèvres, trois laies alignées devant le pavillon de chasse et pleines de dix-sept petits). Depuis, la réduction s’est accentuée ; il ne reste guère, à l’heure actuelle, qu’une douzaine de sangliers sur les 5.000 hectares de Chizé, où le total des tableaux tombait de 200 à 100 dès l’hiver 1944-1945. Partout ailleurs, notamment en Lorraine, de sévères destructions étaient opérées par louvetiers, forestiers et tireurs de grande classe, comme on sait en recruter dans les forêts de vieille tradition cynégétique. Certes, nous ne demandons pas que le dernier sanglier quitte nos bois. La chasse des cochons est trop attrayante, parfois trop émotionnante, pour que de vrais nemrods l’abolissent à force d’excès. Mais il fallait parer au plus pressé, sauver récoltes, plantations et semis. C’est fait, grâce à nos vaillants louvetiers. Pierre SALVAT. |
|
|
Le Chasseur Français N°624 Février 1949 Page 291 |
|
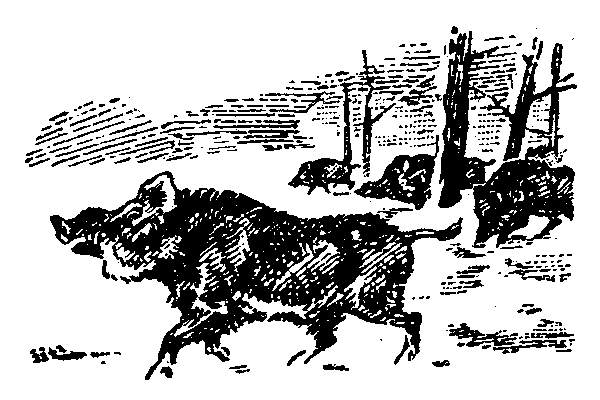 « Au ferme ! » C’était le cri de nos
louvetiers lorsque, après la dernière guerre, ils durent improviser leurs
chasses aux sangliers, attaquer avec des mâtins et faire entourer la bauge par
des tireurs de prudence éprouvée.
« Au ferme ! » C’était le cri de nos
louvetiers lorsque, après la dernière guerre, ils durent improviser leurs
chasses aux sangliers, attaquer avec des mâtins et faire entourer la bauge par
des tireurs de prudence éprouvée.