| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°624 Février 1949 > Page 295 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Les trappeurs |

|
|
Telles sont du moins les images conventionnelles qu’évoque pour nous cette profession, mais je crains bien que, grâce au progrès, tout ce pittoresque ne se perde. Le Peau-Rouge « moderne » porte un vieux veston et a troqué ses plumes rouges contre un lambeau de casquette, et le Cosaque ne lui cède en rien en élégance. Mais, sans pousser jusque dans ce pays de légende, nous pouvons trouver des trappeurs professionnels en France même, et j’en connais personnellement plusieurs. Un peu partout, à la campagne, il y a dans chaque ferme un ou deux pièges que l’on pose occasionnellement pour détruire les renards, lorsque ces derniers deviennent vraiment indiscrets dans les attentions qu’ils apportent à la basse-cour. Les gardes des grandes chasses, également, posent avec plus ou moins de succès des pièges dans les carrés boisés dont ils ont la surveillance, et certains sont même remarquablement adroits dans cet art. Mais tout cela n’est qu’une œuvre de destruction, où la vente des peaux n’intervient que comme utilisation accessoire d’un sous-produit. Dans les massifs montagneux fortement enneigés, tels que les Vosges, le Jura et les Alpes, il existe par contre des professionnels qui, s’occupant l’été comme ils peuvent, ont pour principale source de revenus leur astuce à capturer l’hiver les bêtes à fourrure. Personnellement, j’en connais quatre dans les Alpes, deux dans le Beaufortain, un dans le val de Montjoie et un dans la vallée de Chamonix. Les lignes de pièges qu’ils posent en forêt sont en général assez près de leur domicile, ne s’écartant guère à plus d’une quinzaine de kilomètres, bien que certains enragés n’hésitent point à prendre le train tous les huit jours avec leurs skis pour aller faire une « tournée » plus éloignée. En moyenne, sauf les cas de trop mauvais temps, les pièges sont visités une fois par semaine par leurs propriétaires. Dans les Alpes, les bêtes recherchées sont la martre, le renard et la fouine. Pour que leurs peaux aient une réelle valeur, il faut qu’elles proviennent d’un massif forestier où le froid et l’enneigement soient vraiment « sibériens ». Ces conditions sont remplies — et au delà — par les gorges et les vallées encaissées, proches des grands massifs de glaciers où, l’hiver, le soleil ne donne pas une seule fois d’octobre à avril, et où la neige s’amoncelle en couches profondes. Car, si curieux que cela paraisse, les études météorologiques ont démontré qu’il neige infiniment moins, par exemple, à l’observatoire Vallot à 4.000 mètres sur le Mont-Blanc, que dans certains ravins des vallées voisines, où les nuages de neige, souvent très bas, ne déversent jamais moins de cinq à six mètres par hiver, ce chiffre s’élevant parfois à huit ou dix mètres. Là, la « sauvagine » prend une fourrure exactement comparable à celle des meilleures provenances circumpolaires, et je n’ai pas la moindre illusion sur la qualité dans laquelle la classent les fourreurs. Des martres alpines de plus d’un mètre, prises en février ou mars, avec leur merveilleuse tache orange sous le cou et leur fourrure épaisse à pleines mains, ne sont pas revendues comme « martre de pays » au commerce de détail. Jusqu’à la forte baisse que l’on a constatée en 1948, ces peaux se vendaient, prises sur place, entre 8 à 10.000 francs, et certains renards variaient entre 2.500 et 3.000 francs. Le total des prises d’un « enragé » pouvant s’élever à une vingtaine de renards et sept à huit martres, il y avait là, pour un habitant d’un massif où toute autre source de bénéfice s’arrête pendant l’hiver, une source de gain non méprisable. Dès les premières neiges du début d’automne, le piégeur fait une tournée préparatoire, pour relever les traces. Il sait d’ailleurs, par son expérience des années précédentes, où logent presque tous ses « clients ». La neige en forêt est un livre merveilleux, mais terriblement fatigant à lire. Au détour d’un sentier, voici la trace d’un lièvre lancé à fond de train, avec les marques si caractéristiques de ses pattes de derrière portant à plat, et à côté la lancée d’un renard qui a balayé largement la piste de sa queue, par instants, et l’a chassé longuement dans la nuit claire et froide. Mais ce n’est pas là ce que cherche le chasseur, c’est la battue journalière, faite au petit pas, l’itinéraire fait et refait chaque nuit avec une ténacité de vieux garçon par le renard, qui explore les bois et les clairières toujours aux mêmes heures, avec ou sans résultats. De même, c’est la passée du putois ou de la fouine, acharnés à s’enfiler dans tous les trous de rochers et tous les murs de pierres sèches, à la recherche des mulots et des souris. C’est enfin, dans les grandes pentes où poussent drus et serrés les sapins, le pas infatigable de la martre en chasse, filant sur les sentiers, montant aux arbres pour y surprendre les oiseaux ou les écureuils engourdis de froid, guettant près d’un trou de souris et serpentant sans fin sous la lune, parmi le givre, le verglas et le silence du clair de lune. Le trappeur des Alpes en tournée file en skis aussi loin qu’il peut sur les chemins et va visiter ses pièges à pied, enfonçant jusqu’aux genoux et cramponné aux arbres et aux rochers, au fond de ravins où le ski est impraticable. Il a à lutter contre une double difficulté. D’abord, la méfiance de la bête, mais aussi le fait que, contrairement à ses confrères d’Asie ou d’Amérique, il ne piège pas dans un désert. Le paysan qui a mis un piège dans la haie de son jardin ne risque pas grand’chose ; le montagnard qui en a posé un près d’un sentier, dans une autre vallée, à quatre ou cinq heures de son domicile, et ne le reverra pas avant dix jours, doit le dissimuler avec une ruse suprême, sous peine de voir quelque passant, bûcheron ou braconnier, lui enlever sa capture et son piège avec. « Je la connais bien, me disait l’un d’eux à qui j’avais signalé une martre sur un éperon rocheux. Je vais lui mettre un piège attaché à une grosse pierre en équilibre, au bord du sentier. Comme ça, aussitôt prise, elle remuera le bloc, et hop ! disparus, piège et bête de l’autre côté de la crête, et dans le trou en bas de la pente. » Et, quelques jours après, il retrouvait sa capture comme il l’avait dit, à quatre-vingts mètres en contre-bas. Le bloc de pierre, dérangé par les secousses, avait escamoté piège, chaîne et martre, aussi nettement que le pêcheur sort sa truite du ruisseau d’un coup de poignet. Vie dure entre toutes. C’est le piégeur qui, de tous les habitants des hautes vallées, essuie les pires tempêtes et court les plus grands risques. Quand il s’avance en skis dans le silence, sous le ciel noir, il sait que la neige peut se mettre à tomber, lourde et drue, que le vent va hurler quand il sera tout en bas, dans le lit encaissé d’un torrent, à plusieurs heures de tout abri, et que la nuit arrive vite. Métier dangereux, car l’ouragan et les avalanches punissent de mort la moindre faute de sens montagnard, mais métier passionnant aussi, pour ces solitaires qui ont le privilège d’une chasse unique au monde, et de milliers d’hectares de solitudes où pratiquer sans contraintes. Et quel beau résultat lorsqu’on rentrant au foyer le chasseur jette sur la table, au milieu du cercle admiratif de tous les siens, une martre sans défaut, merveille de fourrure grandie dans le froid et les grands bois, dont la vente sera un bel appoint au budget familial. Mais je connais une ménagère — n’est-ce pas, amie Marcelle ? — qui lira ces lignes en hochant la tête et en se disant : « D’accord, mais quand il revient, ce bloc de neige et de boue, vous ne dites pas dans quel état, en dégelant, il me met ma cuisine ! » Et, comme les femmes ont toujours raison, je me garderai bien de la contredire, si ami que je sois de son mari, car elle fait d’exquises confitures d’airelles — et je ne sors pas en ville avec un col de manteau en martre ni un manchon de renard ... Pierre MÉLON. |
|
|
Le Chasseur Français N°624 Février 1949 Page 295 |
|
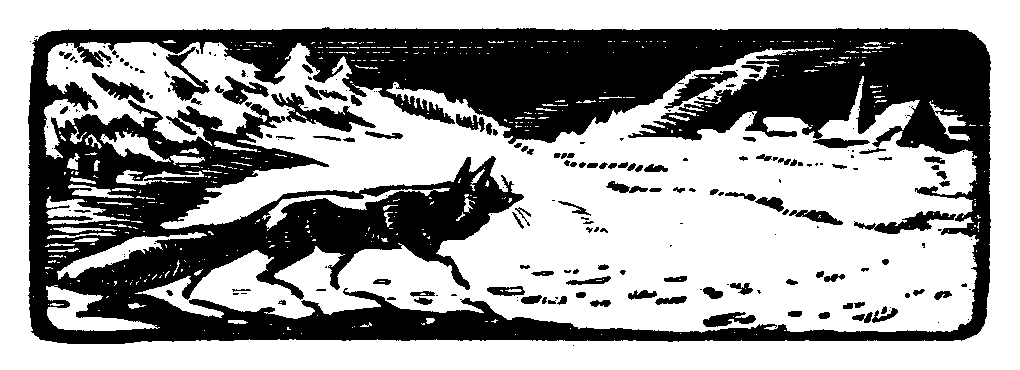 Ce mot, tout naturellement, évoque les solitudes du
Grand Nord, où les Indiens et leurs compères canadiens s’en vont, avec leurs
traîneaux et leurs attelages de chiens, poser des « lignes » de
pièges pour récolter les splendides fourrures dont se pareront les élégantes.
Ou bien encore une Sibérie grouillante de zibelines, pour la plus grande joie
de Cosaques bottés jusqu’au ventre et coiffés de bonnets d’astrakhan.
Ce mot, tout naturellement, évoque les solitudes du
Grand Nord, où les Indiens et leurs compères canadiens s’en vont, avec leurs
traîneaux et leurs attelages de chiens, poser des « lignes » de
pièges pour récolter les splendides fourrures dont se pareront les élégantes.
Ou bien encore une Sibérie grouillante de zibelines, pour la plus grande joie
de Cosaques bottés jusqu’au ventre et coiffés de bonnets d’astrakhan.