| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°624 Février 1949 > Page 297 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
La grande chasse en Indochine

|
Chasse aux bantengs |

|
|
Il est quatre heures du matin. Les deux pisteurs sont là. L’un entasse dans sa hotte-marmite riz, conserves, médicaments, en un mot tout ce qui est nécessaire pour passer la journée en brousse, et peut-être la nuit. L’autre met en bandoulière le bidon d’eau de trois litres et attache ensemble la hache et la scie en vue d’un dépeçage éventuel. Ces préparatifs achevés, nous allumons la cigarette du départ. En route, il est temps ! Déjà, là-bas, à l’est, l’horizon s’éclaircit ; dans une heure, il fera jour et, au lever du soleil, nous devrons être loin. Trois heures de marche seront en effet nécessaires pour atteindre les lieux de chasse, et il est rationnel d’utiliser les heures fraîches pour ne pas se fatiguer trop vite. C’est que juin, en pays d’Annam, n’est pas une plaisanterie et il faut avoir véritablement le diable au corps pour pratiquer la grande chasse en cette période caniculaire. Tout est sec dans ces clairières, où nous foulons une herbe brûlée de soleil, à moins que ce ne soit la cendre des feux de brousse. Et c’est bien osé d’avoir l’espoir de rencontrer une harde de bantengs dans cette région désolée. Je dis bien « rencontrer », car, si nous relevons une piste, il nous sera impossible de la suivre avec fruit, soit que nous ne puissions distinguer si elle est du matin ou de la veille, soit que nous soyons obligés de sacrifier un temps précieux à nous acharner sur des vestiges insuffisants. Chassons donc à la rencontre, seule façon aujourd’hui de tenter notre chance, en nous disant : « Que peuvent-ils manger ? ... » Car il y en a ; nous avons déjà coupé plusieurs pistes. Il est huit heures. Pas un souffle d’air. Le soleil nous assomme dans une atmosphère pesante ... Et notre bidon est quasiment vide. Nous ne pourrons persévérer si nous ne découvrons un point d’eau d’ici une couple d’heures, car, d’abord, elle est indispensable pour préparer le déjeuner. Et il y a aussi le retour. Je devine chez les pisteurs l’envie de tout plaquer, si bien que je prends la tête sans plus m’occuper d’eux. Tout à coup, à deux cents mètres, en plein soleil, se présente un troupeau de bantengs. Que font-ils à se rôtir là au lieu d’être sous bois ? Je file derrière un buisson où je m’accroupis, en faisant signe aux traqueurs de ne plus bouger. Avec des ruses de Sioux, je progresse péniblement de cinquante mètres. Les animaux sont toujours là. Mais pourquoi manifestent-ils de l’inquiétude ? ... Je suis à bon vent, avec le soleil derrière moi, et suis presque sûr qu’ils ne m’ont pas repéré. Alors ? Je tourne la tête et me voici fixé : les pisteurs, au lieu de rester dissimulés, m’ont suivi, avançant avec beaucoup moins de précautions que je ne le fis moi-même. Il m’est désormais impossible d’aller plus loin ; je dois tirer d’où je suis. Je situe, au travers des branchages, un beau taureau. Le coup claque, la bête tombe ... pour se relever et fuir avec le troupeau, dans un nuage de poussière. Mais, à la façon dont l’animal a chu, s’affalant de l’avant, je présume que la blessure est bonne. Cependant, l’examen de la place ne nous montre que quelques gouttes de sang, qui ne laissent pas une piste assez visible pour être suivie. Mauvais augure ! Je devine que nous ne rattraperons pas le blessé. On suit néanmoins les traces, que nous perdons et retrouvons plusieurs fois. Il est neuf heures ... Nous sommes pour abandonner, quand l’un des pisteurs, allongeant le bras sur la gauche, me dit : « Tigre ici ! » Souvent, je me suis entendu conter la même chose. Chaque fois, par acquit de conscience, Je suis allé vérifier. Toujours en vain. Alors, cette fois encore, j’ai dévié de mon chemin, mais sans grande conviction. Le terrain se présentait ainsi : le fourré d’où je sortais, une clairière d’une dizaine de mètres, un autre fourré. Les deux couverts sont reliés par un fossé naturel qu’ont creusé les ruissellements, profond d’un mètre, large de deux. J’ai déjà fait quelques pas dans la clairière lorsque du fossé part un rugissement. Comme catapulté, un superbe tigre bondit vers moi ... Second bond, second rugissement ... et le fauve est à cinq pas. Je le tire au coup d’épaule, comme on lâche une volée de dix sur une bécassine après son crochet. Je n’ai guère eu le temps de viser et j’ai tiré dans le tas, que j’ai d’ailleurs touché. Heureusement ! L’assaillant fait volte-face, traînant une cuisse brisée. Je perçois le bruit de ses bonds, trois rugissements espacés qui s’éloignent ..., puis tout retombe dans le silence, que trouble seul un chant de cigale ... Par curiosité, j’ai suivi pendant plusieurs centaines de mètres la piste du fauve qui, bien que handicapé par une patte inutilisable, réussissait des foulées de cinq mètres. Il ne perdait que peu de sang et, quoique sa blessure fût mortelle, j’abandonnai la poursuite, qui se serait vraisemblablement révélée ou trop longue ou dangereuse. J’avance que sa blessure était mortelle, car, l’ayant tiré de trois quarts avant gauche, il a fallu que le projectile le traversât de part en part pour briser la cuisse droite, mais il n’a sans doute perforé que les intestins, ce qui a permis au blessé de vivre encore plusieurs jours. Je repris la piste des bantengs aperçus au milieu de la matinée. J’étais sur eux une heure après. Je cherchai en vain le taureau touché. Il avait quitté le troupeau pour aller, je suppose, crever à l’écart. Nous n’avions point relevé ses pas lorsqu’ils se séparaient de ceux de la harde.
J’expédiai alors à l’agglomération la plus proche un pisteur, qui ramènerait des coolies pour enlever viande et massacre. À son retour, cet homme me rendit compte que le village était en émoi, le tigre blessé, l’ayant traversé par bonds, en rugissant. Cette déclaration me laissa sceptique, mais, voulant vérifier l’assertion du pisteur, je me rendis au village, le crochet à effectuer n’étant que de trois kilomètres. Il était situé à six kilomètres environ du point où j’avais tiré le fauve. Je pus constater la véracité des faits allégués et, de plus, remarquai, dans un trou d’eau boueuse où se vautraient des sangliers, les empreintes du tigre. Il était venu s’y baigner, l’eau était teinte de son sang. Les coolies voulurent me faire patienter jusqu’à la nuit pour essayer de le découvrir et de l’achever à la lanterne. Mais j’étais las et revins chez moi. Puis la rencontre était des plus aléatoires, le fuyard pouvant être parti fort loin et, en tout cas, devait me faire courir de grands risques, encore plus la nuit que de jour ... Récits d’Allain Le Broussard, |
|
|
Le Chasseur Français N°624 Février 1949 Page 297 |
|
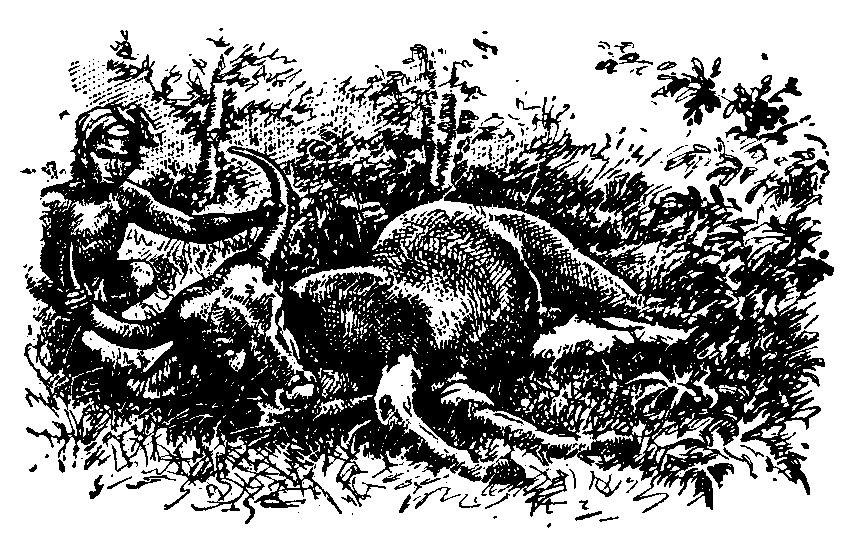 J’eus finalement la satisfaction d’abattre, dans ce
même troupeau, un taureau moyen, qui me paya de mes peines.
J’eus finalement la satisfaction d’abattre, dans ce
même troupeau, un taureau moyen, qui me paya de mes peines.