| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°624 Février 1949 > Page 311 | Tous droits réservés |
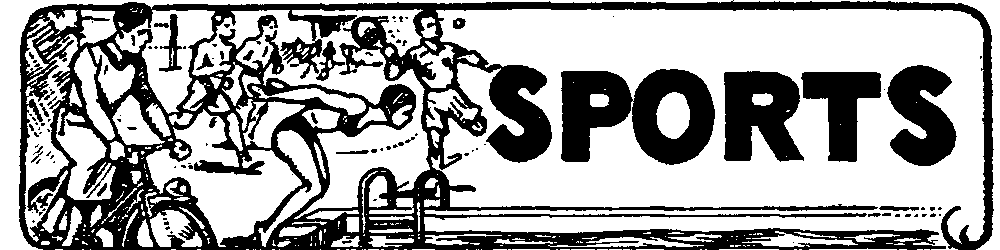
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Spéléologie

|
Premières armes |

|
|
Son plateau supérieur est en forme de fond de bateau, orienté sud-nord et en pente de 20 p. 100 descendant vers le nord. La plus grande partie est un lapiaz sillonné de fissures, de fentes, de puits à neige. La végétation est très pauvre, représentée dans la partie supérieure par de rares pins rabougris et des plaques d’herbe. La bordure du plateau domine de 400 mètres le versant sud-est du Grésivaudan, de 200 mètres le versant ouest de la Chartreuse ; au nord, le plateau s’affaisse en gradins vers la source du Guiers-Mort, point de résurgence des eaux de pluies engouffrées dans le lapiaz sommital. Au point de vue spéléologique, l’intérêt de la Dent est localisé dans les 400 mètres de terrain calcaire séparant le plateau du niveau marneux où s’écoule le Guiers-Mort. Deux grottes sont connues depuis très longtemps : d’une part, la grotte du Guiers-Mort, d’où sort la rivière à 1.311 mètres d’altitude ; d’autre part, le Trou du Glaz, à la base de la face ouest à 1.697 mètres. En 1899, E.-A. Martel, le grand précurseur de la spéléologie française, a fait un séjour éclair en Grande Chartreuse ; en quatre jours, il a visité trois grottes : celle du Guiers-Vif, celle du Guiers-Mort et le Trou du Glaz. Il n’y a pas lieu de s’étonner que, dans ces conditions, plusieurs boyaux étroits de cette dernière grotte aient échappé à ses observations, bien qu’il s’en-défende : « Nous étions cinq à fureter longuement dans les interstices de ce que nous avons pris pour le fond, et nous ne vîmes nulle issue, malgré cinq heures de scrupuleuses recherches dans les moindres fissures et recoins visibles. » En fait, au delà du terminus de 1899, nous avons relevé sur les parois de la grotte de très nombreuses inscriptions antérieures. Mieux encore, nous avons eu la chance de retrouver dans la région grenobloise deux anciens visiteurs qui ont pu nous confirmer leurs inscriptions laissées cinquante et même soixante ans plus tôt : Bandet, 1891, et Mélanie Dubois (vingt-quatre ans), 1881. D’ailleurs, le guide Joanne lui-même parlait, avant la visite de Martel, d’une galerie passant « au-dessus d’un cours d’eau souterrain dont les eaux se font entendre ». Il s’agit sans doute de l’extrémité de l’étage supérieur. On peut donc estimer que celui-ci était connu à peu près complètement avant 1900 ; il comprend trois parties bien distinctes : — une galerie facile de grandes dimensions ; — une zone de fractures où la galerie se subdivise en plusieurs boyaux étroits et comportant quelques puits : puits Martel, puits Perrin, puits de la Lanterne ; — enfin une nouvelle galerie plus petite que la première et se terminant à la Salle de Dôme, base d’un grand puits arrosé. De l’entrée, il ne faut guère plus de trois quarts d’heure pour atteindre le fond. À partir de 1923, le groupement de grimpeurs grenoblois « Les Jarrets d’Acier », sous l’impulsion de son président Henri More, poursuit l’exploration méthodique de la grotte ; ils jalonnent à coups de peinture, mais ne laissent malheureusement aucune trace écrite de leurs explorations. Leurs progrès sont lents ; et ce n’est qu’en 1930 qu’ils parviennent au bas du puits de la Lanterne, clé du second étage (ou étage inférieur) du Glaz. Ce puits comporte trois ressauts de 12 à 16 mètres chacun ; à sa base s’ouvre un passage très étroit, la Chatière, appelée autrefois « Le Polonais », à cause de la nationalité — ou du surnom — du premier qui l’a forcée. Cette étroiture franchie, on débouche dans une galerie plus vaste se poursuivant à gauche jusqu’à un bouchon d’argile, à droite jusqu’à un nouveau ressaut de 10 mètres, au delà duquel les dimensions atteignent 4 mètres sur 4 en moyenne. Cette galerie passe à côté d’un énorme puits, en traverse un autre et s’arrête devant un troisième. L’exploration en est à ce point en 1933 lorsque Robert de Joly, président de la Société spéléologique de France, est chargé par le Touring-Club de la continuer. Visitant les étages déjà connus, il s’arrête également devant le troisième puits qui lui semble infranchissable (il est seul à cet endroit), mais, par contre, descend le premier et le réseau qui lui fait suite jusqu’à une profondeur de 119 mètres au-dessous de l’entrée du Trou du Glaz. Dans ce réseau actif, il dilue un kilo de fluorescéine ; la coloration aperçue à Perquelin, cinquante-deux heures plus tard, prouve la communication du Glaz avec l’une des sources de ce versant, Guiers-Mort ou Fontaine Noire. Tels sont, en 1935, les renseignements que nous possédions sur le Trou du Glaz. Le 1er novembre 1935, nous sommes venus plutôt en curieux qu’en explorateurs, comme en témoigne notre heure d’entrée tardive : il est trois heures de l’après-midi. François Guillemin et sa femme sont mes compagnons et me guident dans l’étage supérieur qu’ils connaissent déjà ; tous deux alpinistes de longue date et membres du Groupe de haute Montagne sont attirés comme moi par cette grotte ; ma femme et Willy Hurlimann, pas très emballés par ce sport nouveau pour eux, nous accompagnent jusqu’au puits de la Lanterne, mais repartent ensuite vers le soleil. Notre équipement est constitué par de vieux vêtements de montagne mis au rebut. Notre éclairage se compose de boîtiers électriques ordinaires pendus au cou et d’une archaïque lanterne de voiture à cheval retrouvée par François dans un grenier. Quant au matériel, nous avons emprunté au Spéléo-Club de Lyon deux gros rouleaux d’échelles de corde à barreaux de bois, et un bien plus petit en électron ; l’ensemble est de la fabrication de Robert de Joly et forme tout l’actif du groupe. Le dépositaire de ce matériel nous a certifié qu’il y avait en tout 90 mètres d’échelles ; ajoutés à nos cordes alpines et aux « singes » de Kiki (Henri Brenot), destinés aux remontées à la corde lisse, cela doit nous permettre d’aller assez loin dans la grotte. À un quart d’heure de l’entrée, voici le puits de la Lanterne, trois mètres de diamètre avec une margelle qui fait presque le tour. Je déroule la première grosse échelle et l’accroche à un anneau scellé au bord du puits par les J. D. A. C’est la première fois que nous mettons le pied sur une échelle de corde, car, à Paloumère, Trombe n’en possédait aucune. En arrivant au bas du premier ressaut, je suis très surpris d’être presque à l’extrémité de l’échelle. Diable ! c’est cela leurs 40 mètres ? J’accroche la seconde à la suite et l’envoie au deuxième puits (P. L. 2). Bientôt, nous sommes en bas tous les trois. Quelques mètres plus loin, au delà d’un petit couloir bas, se présente un nouvel à-pic, le P. L. 3, qui semble plus profond que les précédents. Nous n’avons plus que la petite échelle métallique. J’attache une corde de 20 mètres en simple au providentiel piton J. D. A. — décidément, ils ont bien fait les choses — et descends en rappel. Celui-ci se termine par un surplomb agrémenté d’un petit ruisselet qui invite gentiment à ne pas s’éterniser au bout de la corde. En bas du puits, la galerie reprend, mais la voûte s’abaisse bientôt et l’on doit ramper sur une vingtaine de mètres ; la lanterne du cheval ne passe pas debout. Au bout de cette chatière, une bifurcation ; les dimensions étant plus grandes à droite, nous nous y engageons. À 150 mètres de là, encore un ressaut que nous nommons le P. L. 4, bien qu’il n’ait plus rien de commun avec le Puits de la Lanterne. À notre gauche, la base d’un puits forme une espèce de chapelle. Devant nous, 10 mètres à descendre, nouveau rappel où nous laissons une corde en double pour la remontée. La galerie s’agrandit : elle descend par un éboulis raide jusqu’à un petit puits colmaté et reprend en face de nous. Pour atteindre la suite de la galerie, un passage détourné se présente sous forme d’une double fenêtre dans la paroi de droite ; passant par la première, on accède à une étroite corniche bordant un énorme puits au fond duquel coule un ruisseau : c’est le puits descendu par de Joly il y a deux ans ; comme il a 36 mètres, nous l’appelons le P. 36. Il nous reste des cordes en abondance, mais seulement 10 mètres d’échelles, et nous ne pouvons pas le descendre. Continuons donc l’exploration du second étage auquel nous ramène le deuxième fenêtre et un court passage d’escalade. À 80 mètres, nouveau puits profond, arrosé cette fois, et coupant la galerie ; les cailloux que nous lançons tombent dans l’eau, ce qui lui vaut le nom de Puits du Lac. Une étroite margelle permet de le contourner sans trop de difficultés. Cent cinquante mètres plus loin, encore un puits, à première vue moins profond ; un second ressaut, que nous ne voyons pas aujourd’hui, le prolonge jusqu’à 60 mètres sous notre galerie ; ce sera le P. 60 ; ce puits est plus facile à franchir ; d’un côté à l’autre court une corniche très étroite, déversant vers le vide et gluante d’argile. C’est l’obstacle qui a arrêté de Joly ; il est assez peu engageant. Tenu à la corde, je m’y risque, les pieds glissent ; mais quelques prises de main assurent une stabilité suffisante et je passe. Devant moi, nouvelle bifurcation. À gauche, la galerie débouche dans un grand puits arrosé d’en haut, un rideau de pluie supprime toute visibilité (Puits Labour) ; la branche de droite se termine à un autre puits, sec celui-là (Puits Fernand). Prenant les directions à la boussole, comptant mes pas, je reviens au P. 60, puis nous repartons vers la sortie. Le P. L. 4 est remonté à la corde lisse, le P. L. 3 à l’aide des « singes ». Cette première visite a duré sept heures, elle nous a révélé l’importance tout à fait exceptionnelle du Trou du Glaz et nous a incités à en connaître davantage. Pierre CHEVALIER. |
|
|
Le Chasseur Français N°624 Février 1949 Page 311 |
|
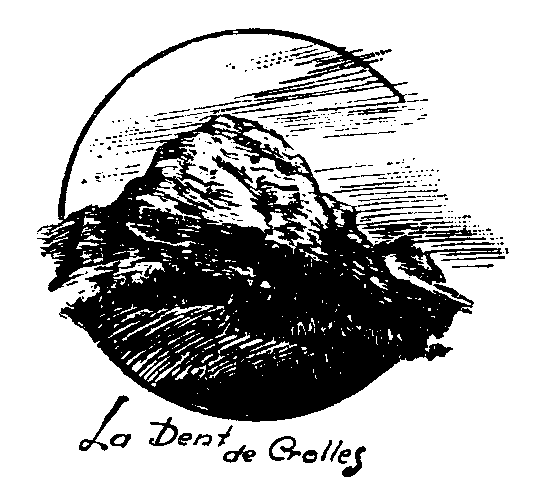 Aux yeux du voyageur qui remonte la vallée de
Grésivaudan en partant de Grenoble, la Dent de Crolles apparaît comme une
puissante molaire enchâssée dans de raides pentes d’herbes et d’éboulis. C’est
le sommet le plus élevé d’une longue crête calcaire qui s’étend sur vingt
kilomètres de long jusqu’au Granier, bordant le massif de la Grande
Chartreuse ; il domine de sa falaise abrupte le plateau des Petites
Roches, perché à mi-hauteur entre la crête et la vallée de l’Isère.
Aux yeux du voyageur qui remonte la vallée de
Grésivaudan en partant de Grenoble, la Dent de Crolles apparaît comme une
puissante molaire enchâssée dans de raides pentes d’herbes et d’éboulis. C’est
le sommet le plus élevé d’une longue crête calcaire qui s’étend sur vingt
kilomètres de long jusqu’au Granier, bordant le massif de la Grande
Chartreuse ; il domine de sa falaise abrupte le plateau des Petites
Roches, perché à mi-hauteur entre la crête et la vallée de l’Isère.