| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°625 Mars 1949 > Page 345 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Tirer … ou ne pas tirer ? … |

|
|
C’était dès après l’autre guerre. C’est bien vieux, cette ère révolue, cela ne doit plus guère intéresser que des fossiles, comme « votre serviteur ». Aussi, avant de sortir mon histoire, je commence par des excuses. En ce temps-là, les Victoires ailées nous avaient portés de la Champagne au Rhin. Depuis ce matin, mes chasseurs avaient été détachés à la garde du Quartier Général installé au château moyenâgeux du Schwanen See, et mon fanion jonquille et bleu flottait sous la poterne. Escorté de mon lieutenant — mon complice aussi en chassotes clandestines, — un universitaire à la belle barbe assyrienne de saint roi David pour jeu de cartes, j’achevais le tour des terrasses surplombant l’immensité du Hardt, quinze lieues de massifs forestiers. Novembre avait doré les futaies de hêtres et, par plaques, la fourrure bleutée des sapinières tranchait sur toute cette feuillée rousse à demi dépouillée. « Il y en a, là dedans, des coups de fusil à venir », avais-je rêvé tout haut. Maintenant, assis à la margelle de marbre d’un vaste miroir d’eau, nous regardions voguer une escadre de cygnes, emblèmes de la demeure. — Barfon, disais-je, cela m’étonnerait que nous ayons été détachés ici, hors tour et en vitesse, uniquement pour veiller su’ c’troupeau de volailles ; je croirais volontiers que le patron ... L’arrivée d’une estafette m’interrompit ; l’homme claqua les talons : — Mon capitaine, le Chef vous fait dire que le Général vous attend à sa popote. — Vous voyez, Barfon, c’était bien cela. Un planton m’ouvrit un hall aux dimensions de cathédrale. J’arrêtai sur le seuil, ébloui : depuis que le plus ancien maître du château avait commencé d’assembler ses trophées, tous les plus beaux records étaient conservés là. Des poutres au parquet, c’était un espalier de crânes d’aurochs, de mufles de bisons, de massacres d’élans, de bois de cerfs, de brocards et de daims, de cornes de chamois et de bouquetins. Les grosses figures bonasses des ours, les hures des sangliers, leurs groins monstrueux, les têtes des loups aux dents grinçantes, le rictus sanguinaire des lynx au regard bridé s’étageaient au long des murs. En place d’honneur, sur un socle d’ébène, un gigantesque ours brun, tout debout, couvert d’un écu blasonné, brandissait une masse d’armes et guettait les entrants de ses petits yeux de verre. J’en restai figé ; peu s’en fallut que j’en oublie d’apercevoir la haute stature du Général. Il m’attendait, debout devant une cheminée géante, en se grillant les mollets au brasier. — Alors, te voilà, braconnot ? Que l’on ne se récrie pas à ce tutoiement inhabituel à l’adresse d’un officier. Le général Kersaga, le grand vainqueur de Douaumont, était un vieil ami. Trente ans plus tôt, à sa sortie de Saint-Cyr, il avait servi aux Cambodgiens, sous les ordres de mon père ; ensemble ils avaient chassé le tigre, le paon, le buffle et les pirates. Il m’avait fait danser sur ses genoux, au temps de ma petite enfance. — Oh ! mon général, braconnier ! ... Si peu ! tout juste un méchant lièvre, à l’occasion, pour ma cuisine. — Oui, oui, oui, et cela malgré les circulaires du Grand Quartier. Et ton chevreuil de la forêt de la Reine, tu l’avais pris peut-être pour un capucin à cornes ? Et cet été, quand nous étions au repos à Toul, tous tes halbrans sur les lônes de Moselle ? On ne parlait que de tes canards, on racontait même que tes lieutenants ne pouvaient plus voir le salmis quotidien et voulaient tous se faire muter. — Ah ! cela c’est vrai, je le reconnais, il était temps de monter en secteur, ils auraient tous fini par me lâcher. — Bon, péché avoué ... je te pardonne. Et continue ! C’est à ce propos que je t’ai fait venir. Tu sais que depuis la guerre je n’ai plus touché mon fusil. Il m’en a coûté, mais j’avais mieux à faire. Maintenant c’est fini, nous sommes chez eux, je compte me repayer sur leur gibier. Oh ! sans aucun tralala, sans battues à grand orchestre. Je sortirai deux ou trois fois par semaine, en tout petit comité et, bien entendu, en civilisé : pas de massacre, et défense de tirer les chèvres, exactement comme nous le ferions chez nous. Il me faut un officier pour m’arranger cela ... Il paraît que tu t’es monté d’une meute ; comment est-il, ton équipage ?
— Tu as raison, tu garderas ton professeur, il me va. Tout le reste aussi, c’est exactement ce que je voulais. Tout à l’heure, tu confieras ta compagnie à ton sous-lieutenant : il est jeune, ça lui apprendra son métier. Dès demain, l’adjudant du train mettra une voiture à ta disposition avec un chauffeur sérieux, Ojardias. Tous les jours où le temps sera sortable, tu iras reconnaître les bons endroits et, quand tu auras quelque chose de bien, tu me préviendras. Mais pas de fla-fla surtout, discrètement, j’y tiens. En sortant, je retrouvai mon complice : il nourrissait les cygnes. De miette en miette, une boule y était passée. Ainsi sont les chasseurs : chérir les bêtes ou les fusiller. Je campai mon carreau dans l’œil et, du plus loin : — Ça y est, Barfon, ça y est, je suis nommé Grand Veneur, et vous serez mon sous-fifre. De ce jour commença l’une des belles époques de ma carrière. L’hiver de l’Armistice, si l’on s’en souvient, fut d’une rare clémence. Pas de froids polaires, ni de pluies diluviennes, peu de neige, maintes journées embellies d’un timide soleil. J’embarquais mon équipe dans la voiture d’Ojardias, et nous allions à la découverte. N’étant que deux fusils, nous recherchions de petites enceintes faciles. Ma meute n’était pas bavarde et nous attaquions à bas bruit. Du moins en ce qui concerne Barraud, brave paysan bourguignon : quelques coups de gourdin sur les fûts, ponctués parfois d’un : « Ho ... ho ... » caverneux. Pour Fatain, vigneron de Gironde, la « muette » était cruelle, d’autant qu’en son pays, où la palombe et l’ortolan forment le gros gibier, il n’en avait jamais tant vu. S’il se dérobait « une lèbre » devant lui, Fatain — p ... de Fataingn, ainsi qu’il s’apostrophait lui-même — s’étranglait de silence mal ravalé. Mais si, comme cela lui arriva, il tombait des deux pattes au milieu d’une famille de chevreuils à la reposée, alors cela débordait, il fallait que ça sorte : « Vé, vé ! ça les est, à vous, mon capitaine, à vous, tuez-les tous, milo diou ! » En arrivant près de moi, il souffrait mort et martyre de ne trouver que le seul brocard étendu : « Et alors, cette grosse bichette et ses petits mignons, mon capitaine, vous ne les avez pas tirés, non ? Aïe, aïe, aïe ! ... et tant de peine que tu te donnes, Fataingn, tout ça pour que ton capitaine les laisse passer ... Misère ! ce qu’il te faut voir ! » À l’aube de ce matin-là, une mince poudrée de neige avait blanchi la terre gelée, puis avait cessé. J’étais seul avec mes deux hommes, Barfon resté à quelque corvée. En descendant une ligne sous le Drachenfels, j’aperçus, très net, le pied de deux grands animaux marqué dans la neige, comme un cachet sur une cire. Ils étaient beaucoup trop gros pour être de chevreuil, et, sur la poudrée, les gardes de sangliers auraient marqué. J’eusse penché pour des cerfs — un grand daguet et l’autre moins fort, — n’eût été cet arrondi des pinces et de l’empreinte, qui me déroutait. Je restais indécis, lorsque, au loin sur le sentier, je vis venir le vieux Teufelmeyer, le garde-chef du domaine. Dans les premiers temps, il préférait éviter les intrus que nous étions ; peu à peu, les égards que nous avions pour son gibier, notre discrétion à prélever la dîme l’avaient apprivoisé. Quand il sut que nous respections les chèvres, il capitula. Maintenant, comme il était bonhomme, il nous rejoignait volontiers pour nous aider de sa longue expérience. D’un coup d’œil, il jugea le volcelest : — Deux daims, un grand-père et son jeune compagnon. Ils ne sont pas loin, c’est tout frais. La hêtraie pendait sous la Roche des Dragons vers un épais semis de sapineaux. Sur le « blanc livre des ânes », nous eûmes vite fait l’enceinte, le pied ne ressortait pas. Nous avions la chance d’être tombés sur une fin de nuit ; les bêtes, surprises par la neige, devaient s’en être abritées dans le bosquet de résineux. J’avoue que la tentation d’un doublé si rare faillit me jeter hors du devoir, mais le sens de la hiérarchie l’emporta. Une heure plus tard, la voiture d’Ojardias franchissait en trombe le pont-levis du Schwanen See. Quelques instants après, j’en ressortais avec le Général dans sa grosse Panhard. Le père Teufel nous attendait ; en mon absence, il avait encore raccourci la remise. — Je les garantis là, fit-il en désignant les sapins. Et Son Excellence vient avec moi. Nous montâmes vers la Roche. À sa base, il s’arrêta : — Da, der Herr Général. Un houx épais, piqueté de points rouges, masqua de son feuillage luisant la haute taille de l’Excellence et son bleu-horizon. À dix pas du poste, la coulée claire qu’avaient suivie les daims dégringolait dans la futaie. Le plan du vieux était simple : aller les reprendre par-dessous leur reposée, les réveiller sans effroi et les faire dérober doucement sur leur contre, jusque sous le fusil. Une poussée trop vive eût pu jeter les bêtes hors de la remontée, Fatain garda les chiens couplés. J’enlevai mes cartouches de mon fusil — mieux vaut ne pas tenter le diable, — puis Barraud, le garde et moi montâmes en râteau, tout en baguenaudant, tels d’honnêtes promeneurs. Teufel les aperçut le premier. Du geste, il nous stoppa, puis à mi-voix : — Herr Hauptmann ... Il me fit signe d’approcher. Je les vis. À trente pas, ils s’étaient mis debout, ils nous regardaient, vaguement inquiets ; l’ancêtre allongeait le col, la tête cabrée sous le poids des larges palettes plates et claires ; le jeune daguet, fluet encore, ne portait que deux maigres broches. Un instant, un rais de soleil, perçant la voûte grise, tira des robes fauves un reflet fleur de pêcher. Posément, les bêtes firent demi-tour et s’enlevèrent d’un trot léger vers la touffe glauque où la mort attendait. Le coup de fusil — un seul — sonna clair dans la hêtraie. Nous rejoignîmes. Le grand daim entrait en agonie, ses doux yeux chavirés. Un peu d’écume rose lui montait aux lèvres, et, sur le coffre roux, un filet de sang noyait les perles blanches. Son ultime ruade fit voler la neige avec la mousse. Ma foi, je fis comme Fatain et, sur un ton de reproche : — Et alors, l’autre, mon général, vous l’ayez regardé filer ? — Oui. Celui-ci avait fait son temps, mais, vois-tu, les enfantelets, je ne les tue pas. Petit daguet deviendra grand ... J’achevai : — Pourvu que Dieu ne l’envoie pas fusiller chez le voisin ! — Possible, c’est un autre qui l’aura sur la conscience. Le vieux Teufel semblait comprendre, il regardait le Général, passait la main dans sa longue barbe blanche et dodelinait du chef en faisant : — Ia, ia, so, so ... Aujourd’hui, j’ai trente ans de plus, je crois bien que ces deux sages avaient raison. Albert GANEVAL. |
|
|
Le Chasseur Français N°625 Mars 1949 Page 345 |
|
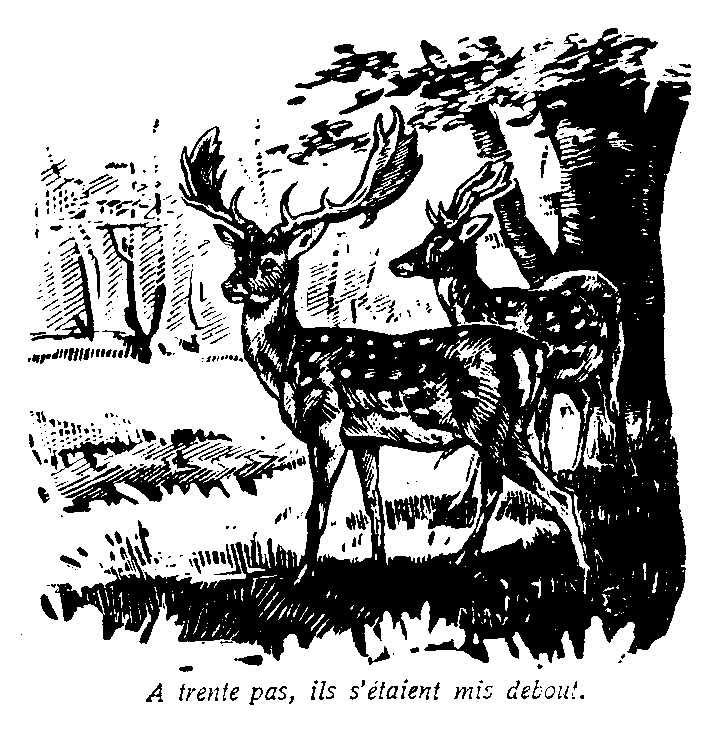 — Heu ! ... mon général, plutôt
modeste. J’ai un petit teckel, Maus ; on l’a ramassé dans une tranchée
boche, il n’y avait plus que lui de vivant ; il est gros comme trois rats,
mais il colle à la voie comme une sangsue, et, l’autre jour, il m’a gentiment
étranglé un grand chevrillard qui s’en allait la cuisse cassée. J’ai une korthals
qui nous a suivis dans la Somme — Miarka ; elle s’est un peu corniaudée
et jappe à la vue, elle a du nez et suit bien aux rougeurs. Comme traqueurs,
j’ai deux types dévoués, un peu bracos ; ils ont la passion dans le
ventre. Et, pour camarade, Barfon, mon lieutenant, un vieux birbe, avec une
belle barbe noire. Dans le civil, c’est un professeur de Faculté, mais vous
verrez, il est tout de même très bien. C’est un ami, cela m’ennuierait de le
lâcher.
— Heu ! ... mon général, plutôt
modeste. J’ai un petit teckel, Maus ; on l’a ramassé dans une tranchée
boche, il n’y avait plus que lui de vivant ; il est gros comme trois rats,
mais il colle à la voie comme une sangsue, et, l’autre jour, il m’a gentiment
étranglé un grand chevrillard qui s’en allait la cuisse cassée. J’ai une korthals
qui nous a suivis dans la Somme — Miarka ; elle s’est un peu corniaudée
et jappe à la vue, elle a du nez et suit bien aux rougeurs. Comme traqueurs,
j’ai deux types dévoués, un peu bracos ; ils ont la passion dans le
ventre. Et, pour camarade, Barfon, mon lieutenant, un vieux birbe, avec une
belle barbe noire. Dans le civil, c’est un professeur de Faculté, mais vous
verrez, il est tout de même très bien. C’est un ami, cela m’ennuierait de le
lâcher.