| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°625 Mars 1949 > Page 382 | Tous droits réservés |
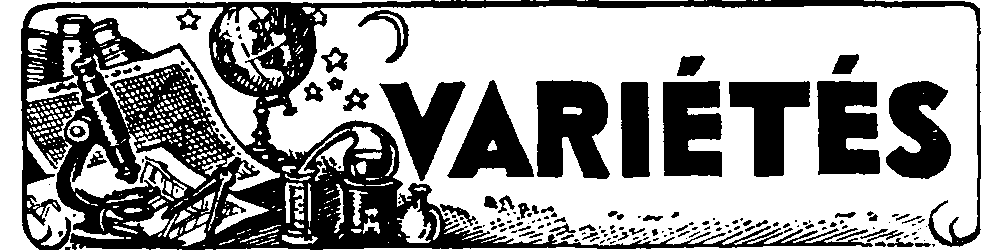
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Dans le grand Nord

|
Le trésor dans la neige |

|
|
Le récit qui suit relate la découverte, par le hardi explorateur Gilbert La Bine, des riches gisements de pechblende du Nord arctique, desquels le Canada tire actuellement du radium en quantité aussi importante que tous les autres gisements mondiaux connus. L’affaire n’alla pas aussi rapidement que La Bine l’avait espéré. Durant des mois, il chercha vainement à Toronto le confrère qui consentirait à braver les fatigues d’une expédition pour un but aussi incertain. Après de longues palabres, il décidait un prospecteur à l’accompagner ; mais l’homme se récusait au dernier moment, déconvenue qui se répéta plusieurs fois. Les gens estimaient que, du point de vue du mineur, le Nord lointain n’était qu’une utopie de visionnaire. Passe encore pour rechercher des filons dans le Nord du Québec ou dans le Nord de l’Ontario ; même recueillir des pépites dans les lits de rivières, comme au Kiondyke, on serait content d’y aller ; ce serait tout différent. Mais exploiter un gisement près du pôle ? Folie ! Gilbert La Bine se décidait déjà à retourner seul au Grand Ours, quand il trouva au dernier moment l’idéal compagnon : Charles Saint-Paul, du Lac Rouge, un vieil ami ; prospecteur d’argent et de cobalt depuis vingt-cinq ans, encore robuste comme l’acier, pourvu d’une vue merveilleuse et doué de toutes les qualités qui font un bon prospecteur. Il était aussi calme et pondéré que La Bine. Et lui aussi pouvait tomber en extase, quand la grande heure sonnait une fois tous les dix ans. À la fin d’avril 1930, six mois après la première tentative, le capitaine Brintnell déposait les deux prospecteurs et leurs 1.600 livres de bagage au Grand Ours, à 11 kilomètres de la falaise que l’on appellerait bientôt « La Bine Point ». Outre des boîtes de conserves, du porc et des haricots, un marteau et une hache, ils apportaient un canoé, ainsi que deux lames de fer qu’ils utiliseraient dans la construction d’un traîneau, fait de bois fraîchement coupé. Les provisions ne devraient durer que jusqu’à l’été. Après le dégel, ils attendraient Charles La Bine, car Gilbert avait arrangé avec son frère qu’il viendrait vers la mi-mai par un bateau de la Compagnie de la Baie d’Hudson qui, partant de Fort Mac Murray, suivrait le cours de l’Athabaska, du Slave et du Mackenzie pour aboutir au Grand Ours. Charles apporterait des moustiquaires, des parkas de toile pour les costumes d’été, des mortiers pour le broyage du minerai, des appareils photographiques, de la dynamite, un second canot muni d’un moteur à godille, des douzaines de foreuses à mains, une douzaine de paires de bas pour chacun, des mocassins et des œufs frais — et deux ou trois robustes garçons. Gilbert se proposait de rapporter à Toronto des centaines d’échantillons, provenant d’autant de formations de roche. Les gens de Toronto sauraient alors si les deux expéditions au Grand Ours présentaient un intérêt réel. Le transport par air des bagages de Charles aurait été trop coûteux, en face d’un projet fantastique dont personne ne pouvait prévoir l’issue.
Gilbert continua seul l’exploration. Mai céda la place à juin. Les jours devinrent plus longs ; les nuits plus claires ; la glace couvrant le lac durcissait. Mais la neige fondait déjà sur les falaises et la neige fraîche ne tombait plus. Saint-Paul se rétablissait lentement, et La Bine put désormais le laisser seul pendant deux ou trois jours. Portant son havresac et son marteau, Gilbert s’éloigna du rivage abrupt et marcha vers le nord, dans le chaos de collines que traversait le cercle polaire. Et ce fut alors qu’il vit surgir sous ses yeux un miracle : une véritable chaussée d’argent massif. Une large bande, assez spacieuse pour que deux camions pussent la suivre de front, traversait le désert de roches et serpentait sur les pentes d’une haute colline. Ni vous ni moi n’aurions appelé cela une « route en argent » : la minéralisation avait plutôt l’aspect du plomb fondu. Mais, aux yeux du prospecteur, cette chaussée d’un gris sale resplendissait des éclats de l’argent pur. Jamais La Bine n’avait vu autant d’argent natif accumulé en un seul endroit. Il se mit à l’œuvre avec son marteau et put détacher des pièces pesant de 80 à 100 livres : autant de morceaux dont l’argent était presque pur ... On n’aurait pu imaginer de l’argent d’une pareille qualité. « Si ce n’est pas là un phénomène isolé, pensa le joyeux prospecteur, j’ai bien trouvé le véritable Eldorado. » Et il poursuivit sa marche pour se rendre compte de la nature du terrain. Il avait parcouru environ 16 kilomètres, et son espoir commençait à se ternir, quand il se trouva soudain en face d’un « lac d’argent », dont la minéralisation était identique à celle de la « route ». Il trouva successivement trois endroits analogues. Il suivit les veines : elles s’allongeaient indéfiniment. Gilbert se sentit profondément remué. Il ne voyait pas ces choses avec les yeux d’un coureur d’aventures : il en jugeait d’après sa triple expérience d’ingénieur des mines, d’homme d’affaires et de géologue. C’est une fois tous les deux ou trois siècles que l’on découvre de l’argent en pareille abondance. Après la découverte, en 1163, du fameux gisement argentifère de Freiburg, en Allemagne, il faut attendre l’an 1545 pour signaler celle de Potosi, en Bolivie, le plus célèbre champ d’argent du monde. Au cours du même siècle, les Espagnols mettent à jour, au Mexique, les trois fabuleux gisements de Guanajuatto, de Zacatecas et de Pachuca. Trois siècles s’écoulent sans trouvailles sensationnelles jusqu’en 1859, date de l’ouverture du gisement de Comstock, en Nevada. En 1904 et 1905, le Canada entre en jeu avec la ruée vers le cobalt, en Ontario. Et c’est enfin l’extraordinaire aventure de Gilbert La Bine et de sa chaussée d’argent natif sur le cercle arctique. Transporté de joie, Gilbert reprit le chemin de la tente. Il avait la conviction absolue que ce qu’il venait de voir pouvait se comparer en richesse à Potosi, à Zacatecas et aux mines de l’Ontario. Il en oubliait ses concessions de cuivre. Le cuivre attendrait jusqu’à ce qu’il subît une hausse de prix et que les transports fussent meilleur marché. C’était une mine d’argent, non une mine de cuivre, qui devait s’ouvrir sur la rive du Grand Ours, une mine d’argent qui porterait l’étrange titre « Eldorado Gold Mines Limited ». Souriant à cette idée, il hâta le pas, pour montrer à son ami son havresac rempli d’argent. Que dirait ce pauvre Saint-Paul à moitié aveugle ? Il ne pourrait pas voir les échantillons. Croirait-il son récit ? Il était midi — le troisième jour depuis qu’il avait quitté Saint-Paul ; malgré les rayons du soleil, il faisait très froid quand il atteignit le rivage du lac, à environ 1.600 mètres du campement. Soudain, ses yeux s’accrochent à un promontoire rocheux ; il ôte ses lunettes aux verres fumés pour mieux voir. Il n’en croit plus ses yeux : la roche est tachetée de toutes les couleurs imaginables : le brun, le jaune, le vert, le bleu, le rose et le noir se coudoient. De sa vie, La Bine n’a jamais vu une minéralisation aussi variée. Et il reconnaît le promontoire : c’est la falaise qu’il avait aperçue lors de sa première expédition. Il énumère les différents métaux que contient la roche : cobalt, argent, or, cuivre, bismuth ... Et il aperçoit soudainement une pierre noire de la grosseur d’une prune : du pechblende, le minerai qu’il a vainement cherché pendant dix ans, qu’il désespérait de trouver, et qu’il trouve maintetenant par hasard ! D’un coup de marteau, il détache de la falaise la pierre noire, noir de suie. Et il la soupèse dans sa main. La Bine se souvient des échantillons qu’il possède à Toronto et d’autres qu’on lui a montrés : des échantillons de pechblende venant de Bohême, du Portugal, du Colorado et d’Afrique. La pièce qu’il a en main est d’une teneur supérieure ; c’est le pechblende le plus pur qu’il ait vu. C’est ce qu’il constate dans l’instant ; et il examine de nouveau le promontoire, cherche la veine, la trouve, la suit. Elle le fait descendre dans le lac. Quelle direction va-t-elle prendre ? Il remarque une petite île qu’une quinzaine de mètres séparent du point de la rive où il se tient. Avançant sur la glace, il l’atteint et constate que la veine se prolonge sur l’îlot. Soulevé par une joie délirante, il retourne en courant au promontoire, découvre une deuxième veine, une troisième, une quatrième. Et il s’attarde là jusqu’au crépuscule ... Saint-Paul croira-t-il tout cela ? C’est à peine croyable. La chaussée d’argent n’est plus rien devant le précieux pechblende, du pechblende à haute teneur, peut-être aussi riche que les huit tonnes d’où Mme Curie tira son premier gramme de radium ! Un gramme de radium coûte 70.000 dollars. S’il est un minerai dont le transport, même du pôle Nord, serait profitable, c’est bien ce pechblende, avec le radium qu’il contient. Il serait d’une plus faible teneur, il ne fournirait pas un gramme de radium pour huit tonnes, que son extraction sur le cercle arctique assurerait encore de gros profits. « Que l’argent attende donc ! pensait l’enthousiaste prospecteur. Qu’il attende une hausse des prix et une diminution du coût du transport ! Ce ne sera pas une mine d’argent, et encore moins une mine de cuivre, qui étrennera le rivage du Grand Ours, mais bien une mine de radium, sous son paradoxal titre de « Eldorado Gold Mines Limited ! » Edgar LAYTHA. |
|
|
Le Chasseur Français N°625 Mars 1949 Page 382 |
|
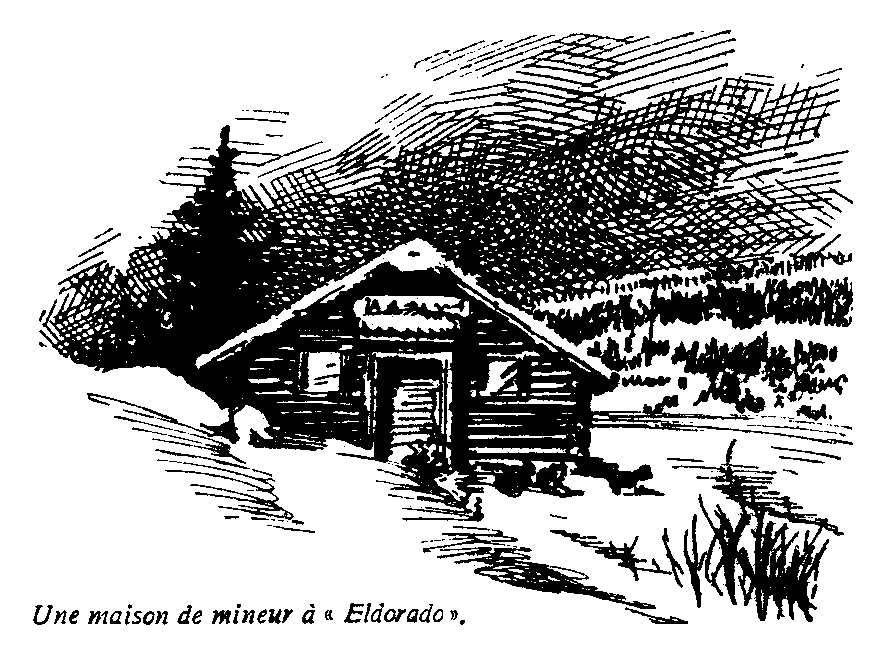 En attendant Charles, les deux pionniers s’attelèrent
à leur toboggan, car ils ne pouvaient pas encore se procurer des chiens. Quand
soufflait une légère brise, ils dressaient même une voile qui les secondait. Et
ils commencèrent l’exploration systématique des rivages. Trop souvent, la tempête
et le froid les gardaient prisonniers dans leur tente. Durant des semaines
entières, le soleil lui-même leur joua un méchant tour : Saint-Paul
contracta la « cécité de la neige ». Pendant des jours et des jours,
il dut rester inactif dans son sac de couchage, les yeux enflammés et
douloureux.
En attendant Charles, les deux pionniers s’attelèrent
à leur toboggan, car ils ne pouvaient pas encore se procurer des chiens. Quand
soufflait une légère brise, ils dressaient même une voile qui les secondait. Et
ils commencèrent l’exploration systématique des rivages. Trop souvent, la tempête
et le froid les gardaient prisonniers dans leur tente. Durant des semaines
entières, le soleil lui-même leur joua un méchant tour : Saint-Paul
contracta la « cécité de la neige ». Pendant des jours et des jours,
il dut rester inactif dans son sac de couchage, les yeux enflammés et
douloureux.