| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°626 Avril 1949 > Page 391 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Chasseurs de canards |

|
|
Cependant, à bien y regarder, on apercevait, de loin en loin, jalonnant les rives, des silhouettes, les unes immobiles, d’autres se mouvant lentement le long des bordures avec quelques chiens courant au-devant. Chasseurs de canards, ils guettaient les vols au passage ou les poursuivaient inlassablement d’un trou à l’autre. De temps en temps une détonation retentissait dans le grand silence glacé et l’on voyait passer, remontant le courant ou haut dans les nues, des oiseaux soit isolés, soit par petits groupes, quelquefois par files plus importantes, le cou tendu et l’aile rapide. Au coin du ruisseau qui, descendant à travers les terres, vient se jeter dans le fleuve, je rencontrai le vieil Augustin. Vêtu de vieux velours à la teinte passée, chaussé de sabots, coiffé d’une casquette à rabats lui retombant sur les oreilles avec, par-dessus, un vieux cache-nez qui entortillait sa face mal rasée, il me reconnut. Il parlait les mâchoires serrées, retroussant les lèvres qui découvraient deux râteliers jaunâtres et fort ébréchés d’où suintaient des traînées de salive que la grosse boule de la chique, passant d’une joue à l’autre, teintait parfois de brun. — Ah ! monsieur, me dit-il, ils sont fous. Il n’y a plus moyen de tirer un canard. À quatre-vingts, cent, cent cinquante mètres, on tire quand même ; et les canards montent, montent et s’en vont jusqu’à la nuit. Ils sont fous, je vous dis. Ce n’est plus la peine d’aller à la chasse. Ah ! autrefois, il y a vingt ans de ça, ce n’était pas la même chose. Il n’y avait pas tous ces chasseurs de la ville qui, parce qu’ils ont des fusils à cinq coups, croient pouvoir tuer à toutes distances. Alors on tuait des canards comme on voulait. Moi qui vous parle, tenez, ceux que j’ai tués dans ma vie rempliraient bien un wagon. Maintenant, on vient dix fois pour rien. De temps en temps, de bon matin, on en surprend quelqu’un dans le ruisseau ; puis c’est fini jusqu’à la nuit. Et le soir, ils sont une bande d’enragés qui, chaque jour, sont là à tirer jusqu’à des sept et huit heures du soir. Comment voulez-vous que les canards se posent ? Il faudrait qu’ils en veuillent ! Et il lança de côté un long jet de salive qui alla s’étaler sur un galet. Une salve de détonations, venues de l’autre rive, nous alerta. Nous restâmes un moment blottis derrière les bourdaines à voir évoluer, hors de portée, une bande de colverts qui, bientôt, disparut à l’horizon. Je laissai le vieux chasseur et, pour me réchauffer un peu, remontai le fleuve jusqu’au grand tournant de Basset. À deux cents mètres, au bord de la glace, quelques canards étaient posés ; leurs silhouettes, l’une à côté de l’autre, se découpaient en noir sur blanc. Ils étaient là en plein découvert, impossibles à approcher, immobiles et tête dressée, prêts à fuir à la moindre alerte. Je les regardai un instant, retenant mon chien par le collier et me dissimulant derrière une touffe. Un coup de feu les fit se lever ; ils redescendirent au ras de l’eau, puis s’élevèrent et allèrent se perdre au fin fond de la plaine gelée, je me levai et me trouvai face à face avec ... le Diable ! Ne croyez pas à une blague, car le Diable, à ce moment-là, existait bel et bien en la personne d’un chasseur de ce village riverain. Pourquoi l’avait-on ainsi surnommé ? Je ne sais ; mais il est de fait qu’il avait une drôle d’allure dans son accoutrement, sans recherche, je vous assure, car les chasseurs paysans se moquent bien de leur mise. Petit, disparaissant dans une vaste capote militaire qui avait été bleu-horizon, mais qui, à présent, délavée par le temps et le grand air, avait pris la teinte neutre des horizons d’hiver, le visage osseux, coupé d’une moustache à la gauloise sur laquelle descendaient, de son nez bleui par le froid, deux épaisses chandelles de glace, la tête perdue dans un vieux passe-montagne de laine, béant par endroits, ses petits yeux vifs pétillaient comme braise. Il était, lui aussi, chaussé de gros sabots d’où sortaient quelques brins de paille, et armé d’un vieux fusil à chiens qui, à l’occasion, faisait bien son service. — Vous les avez vus ? me dit-il. Je les ai tirés pour qu’ils se lèvent et vous les envoyer. Mais ils sont malins, allez ; ils y voient clair. Le fils en a tué deux ce matin, dans le pré, derrière la maison. Sa barque était là, sous la falaise, amarrée au bord de la glace. Il voulut bien me passer sur l’autre rive. Je le remerciai en lui promettant « bouteille » pour la prochaine foire. Rien d’autre ne pouvait lui faire plus de plaisir et lui démontrer davantage ma gratitude. Je redescendis. Plus bas, à cinquante mètres du courant, dans l’immense plaine de galets, un petit trou creusé par quelque crue gardait de l’eau qui ne prenait jamais. On y surprenait souvent quelque isolé, canard ou sarcelle. En m’approchant avec précaution, j’arrivai sur le bord d’où partit, effrayée, à deux mètres de moi, une cane qui n’alla pas loin. Et cela me réchauffa un peu. Au fond de l’île était la cohue des chasseurs. J’y retrouvai, comme toujours, les mêmes, entre autre le gros L ..., du village de Lamure, qu’on apercevait à trois ou quatre portées de fusil à peine, dominant la plaine et dont pointait le clocher gris de sa petite église où, une fois l’an, à l’occasion de la Sainte-Agathe, le curé du canton vient dire la messe en grande pompe. Celui-là aussi était un fameux « canardier ». Matin et soir il était là, planté dans les « vorgines », sabots aux pieds et le feutre enfoncé jusqu’aux oreilles. Oh ! il ne courait pas, lui ; il laissait faire les autres qui lui envoyaient le gibier. Que de fois, avant le jour, croyant arriver le premier pour surprendre les canards, j’ai aperçu de loin, dans la nuit finissante, le point rouge de sa cigarette qui seul me le décelait ! Il était ménager de sa poudre, car il chassait pour vendre ; aussi ni bécassines, ni vanneaux, ni autres oiseaux difficiles ne le tentaient. Des brûle-poudre, disait-il, en secouant la cendre de sa cigarette qui tombait sur sa bedaine. Lui aussi se plaignait du vacarme qui remplissait ce coin de marais, où, autrefois, seul ou presque, il faisait de si belles chasses. Nous bavardâmes un moment.
Le docteur aussi était là, barbe givrée et pipe aux dents, toujours aussi prolixe de paroles. — Ah ! j’en ai eu des aventures, allez ! Et que de fois j’ai « gayé » par des temps pareils avec de l’eau jusqu’à mi-cuisse ! J’ai bien tremblé un peu, pourtant, la fois qu’un lièvre, surgi des broussailles sous la berge, se trompa de route et partit sur la glace recouverte d’un peu de neige. Je le fusillai juste au moment où il arrivait au bord de l’eau. La glace était mince et on n’y pouvait aller debout. Mais à plat ventre, je me dis qu’elle devait porter. En rampant, je mis bien un quart d’heure à franchir la quinzaine de mètres qui me séparaient de la bête. La glace, sous moi, se fendait avec des craquements sinistres ; elle tint bon tout de même. Mais quand je revins au bord, à reculons, en traînant mon lièvre, j’avais chaud, je vous assure, malgré les dix ou douze degrés en dessous qu’il faisait ! ... Chasseurs de canards ! Quelle passion profonde les anime, au delà de toute imagination ! Il faut être de la « corporation » ou avoir dans son entourage un de ses représentants, pour être fixé sur les possibilités de témérité et d’endurance que leur a données la nature. Quant à moi, je me réjouis de me compter parmi cette cohorte un peu spéciale à laquelle j’ai eu la joie d’appartenir, de fait, pendant plus de vingt ans et dont je ne suis plus, hélas ! malgré moi et à mon grand regret, qu’un membre honoraire. Car, lorsque je songe qu’en deux saisons de chasse je n’ai chaussé mes cuissardes qu’à trois ou quatre rares occasions, je ne puis, je l’avoue, que prétendre à l’honorariat. Et d’être ainsi privé de mes chères séances de barbotage dans le fouillis des marais et des longs affûts dans les crépuscules glacés des soirs d’hiver, je pourrais, tel Orphée ayant perdu son Eurydice, chanter que Rien n’égale ma douleur. Pourtant, du fond de mon cœur passionné, je chasse encore, mais en souvenir. FRIMAIRE. |
|
|
Le Chasseur Français N°626 Avril 1949 Page 391 |
|
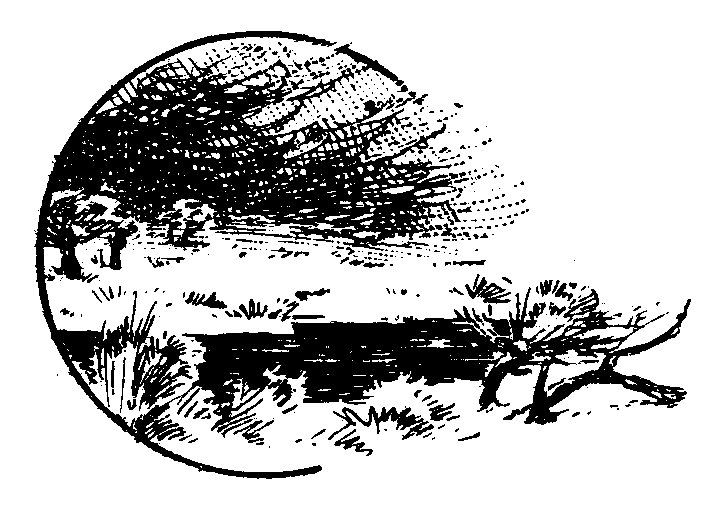 Le fleuve descendait lentement, étalé sur son lit de
graviers, entre deux larges rives de glace qui en rétrécissaient le courant.
Les eaux, claires aux endroits sans fond, verdâtres là où il y avait quelque
profondeur, coulaient mollement, comme épaissies par le gel. Au loin, un ciel
trouble et gris noyait l’horizon. Une « sibère » glaciale soufflait,
meurtrissant le visage, et quelques minuscules flocons de neige, éparpillés,
voltigeaient dans le vent qui les poussait et allait les plaquer contre les
troncs des arbres et les talus tournés au nord. Il faisait trop froid pour
neiger, mais on sentait que si la bise fléchissait, adoucissant le temps, ce
serait alors la grande avalanche, dont le ciel était lourd, qui s’abattrait sur
la terre. Tout paraissait désert, triste et sans vie sous la dure étreinte de
l’hiver qui pesait sur la terre comme une chape de plomb. Les troupeaux étaient
à l’abri dans la chaude haleine des étables, et les gens, blottis dans les
maisons, les fermes et les masures, attisaient à longueur de journée les grands
feux de bois ou de genêts sous l’immense manteau noir des cheminées
campagnardes. Le long des rives, les arbres noircis dressaient leurs
silhouettes mortes. Les grands taillis d’osiers, sans feuilles, avaient perdu
toute leur mystérieuse fraîcheur et les plantes étaient affaissées sur la terre
durcie comme si rien n’y devait plus repousser.
Le fleuve descendait lentement, étalé sur son lit de
graviers, entre deux larges rives de glace qui en rétrécissaient le courant.
Les eaux, claires aux endroits sans fond, verdâtres là où il y avait quelque
profondeur, coulaient mollement, comme épaissies par le gel. Au loin, un ciel
trouble et gris noyait l’horizon. Une « sibère » glaciale soufflait,
meurtrissant le visage, et quelques minuscules flocons de neige, éparpillés,
voltigeaient dans le vent qui les poussait et allait les plaquer contre les
troncs des arbres et les talus tournés au nord. Il faisait trop froid pour
neiger, mais on sentait que si la bise fléchissait, adoucissant le temps, ce
serait alors la grande avalanche, dont le ciel était lourd, qui s’abattrait sur
la terre. Tout paraissait désert, triste et sans vie sous la dure étreinte de
l’hiver qui pesait sur la terre comme une chape de plomb. Les troupeaux étaient
à l’abri dans la chaude haleine des étables, et les gens, blottis dans les
maisons, les fermes et les masures, attisaient à longueur de journée les grands
feux de bois ou de genêts sous l’immense manteau noir des cheminées
campagnardes. Le long des rives, les arbres noircis dressaient leurs
silhouettes mortes. Les grands taillis d’osiers, sans feuilles, avaient perdu
toute leur mystérieuse fraîcheur et les plantes étaient affaissées sur la terre
durcie comme si rien n’y devait plus repousser.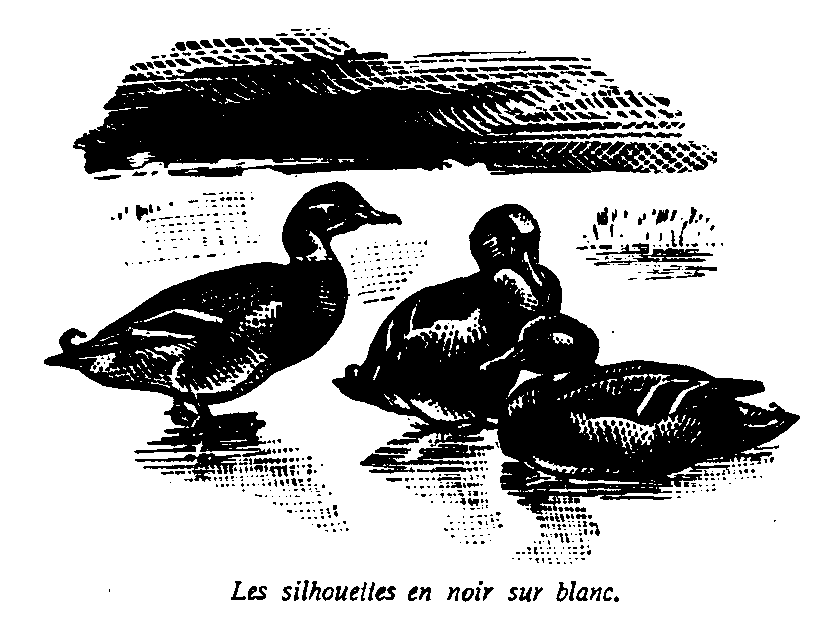 C’est à lui qu’il arriva, un jour de grand froid,
pour un canard tombé sur la glace qui ne portait pas assez pour qu’on pût s’y
aventurer, de quitter pantalon et d’aller chercher l’oiseau en cassant la glace
devant lui avec un gros caillou, dans l’eau jusqu’à la poitrine. Il eut son
canard, certes, mais il s’en repentit, car il en eut pour deux mois de lit et
n’en mena pas large pendant quelques jours. Mais il faut croire qu’il y a un
bon Dieu pour les chasseurs de canards comme pour les ivrognes ! Sans quoi
combien auraient trépassé avant l’heure !
C’est à lui qu’il arriva, un jour de grand froid,
pour un canard tombé sur la glace qui ne portait pas assez pour qu’on pût s’y
aventurer, de quitter pantalon et d’aller chercher l’oiseau en cassant la glace
devant lui avec un gros caillou, dans l’eau jusqu’à la poitrine. Il eut son
canard, certes, mais il s’en repentit, car il en eut pour deux mois de lit et
n’en mena pas large pendant quelques jours. Mais il faut croire qu’il y a un
bon Dieu pour les chasseurs de canards comme pour les ivrognes ! Sans quoi
combien auraient trépassé avant l’heure !