| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°626 Avril 1949 > Page 430 | Tous droits réservés |
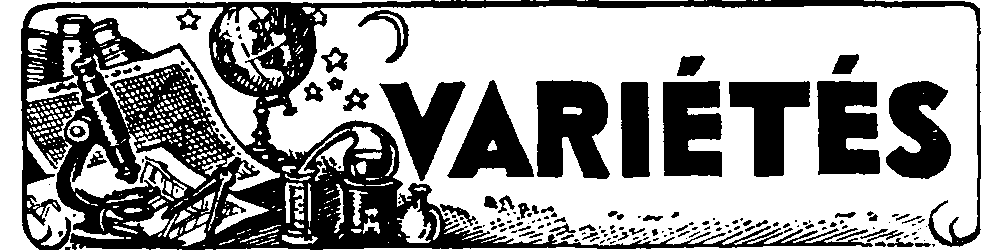
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Notes de voyage

|
En Albanie |

|
|
Shqiptare ! L’Albanie ... La « Zeta » du Moyen Age ... Drapeau rouge à l’aigle noir, médiéval, byzantin. Que de noms français nous accueillent sur ce rivage ! C’est Robert Guiscard et Bohémond ; Pierre de Courtenay, comte d’Auxerre, petit-fils de Louis le Gros, et Philippe Chinard, ce seigneur de Chypre au nom de paysan, amiral d’outre-mer marié à la belle-sœur d’un Comnène, qui mourut poignardé par sa femme, et dont la tête fut exposée dans un plat d’or. C’est Hugues Chabot et Jacques de Baligny, et Louis, comte de Beaumont-le-Roger, frère de Charles le Mauvais, roi de Navarre. Et tous ces Baltcha, souverains serbes issus de la famille française des Baux-en-Provence, qui, au XVe siècle, dominèrent Raguse et l’Albanie. Bien d’autres encore, comme le général Roze qui, en 1797, épousa à Janina la belle Zoïtza, au milieu de réjouissances orientales qu’accompagnait le chant de La Carmagnole. Aventure joyeuse et colorée qui allait se terminer dans le sang : l’année suivante, trahis, décimés, les derniers soldats français, obligés à écorcher et à saler les têtes de leurs camarades tués, furent conduits, pieds nus, sans boire, à Janina, puis à Constantinople, où ils moururent d’épuisement. Le ciel devait les venger : le responsable de ces cruautés, Ali Tépéléni, « lumière des lumières », comme l’a chanté Victor Hugo, périt trente ans plus tard, de la plus atroce manière, et sa tête tranchée, sa tête de vieillard de quatre-vingt-deux ans, allait être suspendue aux portes du sérail. Et Durazzo, l’antique Épidamne, témoin des luttes de César et de Pompée, puis des prédications de saint Paul, où aujourd’hui nous abordons, ne vit-elle pas flotter pendant plus d’un siècle sur ses murailles byzantines la bannière fleurdelysée des comtes d’Anjou, rois de Naples et de Jérusalem ? Un « coup d’auto » nous mène à Tirana, où les bâtiments modernes des ministères et les hôtels luxueux côtoient de vieux quartiers qui rappellent Brousse ou Damas. Des avenues sans constructions et des constructions sans avenues. Dans les bazars, de grands vieillards osseux fument leur pipe au seuil des échoppes, et, le soir, tandis que s’allument les feux dans les campements de tziganes, la voix bêlante du muezzin s’élève dans la tiédeur alanguie du crépuscule. L’Albanie, ce champ de bataille traditionnel où s’affrontèrent l’Orient et l’Occident, a gardé de cinq siècles d’oppression turque une empreinte dont elle ne peut se libérer, quelle que soit sa rancune contre une tyrannie barbare et stérile. Oui, malgré le campanile moderne et l’aérodrome, malgré les voitures américaines et le « Magasin du Louvre », c’est bien l’Orient des minarets et des bazars qui nous accueille, avec ses femmes voilées en bas de coton rose et vernis noirs, ses petites victorias poussiéreuses et son cri de guerre, le « Dieu le veult » des Infidèles : « Backchich, backchich ! ... » Dans les vitrines fleurit le couvre-pieds en satin piqué qui est à l’Orient ce que le parapluie est à l’Afrique noire et le tire-chaussettes violet au monde arabe : raffinement suprême et symbole même de prospérité. Demande-t-on un renseignement ? Pour répondre non, de la tête, on vous dit oui ... Ah ! nous y sommes bien, dans cet Orient crasseux, vicieux, fainéant, bavard et superficiel, où tout est faux et trompeur, les bijoux, les drogmans, les sourires, les horaires des transports et le prix des tapis. D’ailleurs, Tirana, n’est-ce pas « Téhéran », et son nom même n’a-t-il pas été choisi pour évoquer les victoires persanes de Suleïman Pacha ? Il y a de tout, dans les cars albanais, pêle-mêle : hommes, femmes, puces, chèvres, édredons, pastèques et lits pliants. Chacun de leurs départs est un événement, chacun de leurs tours de roue un tour de force, et chacune de leurs arrivées une tolérance du ciel. Mon voisin de droite a la ceinture farcie de pistolets et de poignards qui me défoncent les côtes ; celui de gauche, un derviche barbu, ne tarde pas à dormir sur mon épaule. Il ronfle de toutes ses végétations, et elles se posent là ! des végétations tropicales ! Un vieux tette son fume-cigarettes, et tout le monde chante, là dedans, à plein gosier — pas le même air naturellement. Voici, sur la route de Scutari, Alessio, la Lyssos de jadis, qu’aurait fondée, dit-on, Denys, l’ancien tyran de Syracuse, l’homme à l’oreille. C’est ici que mourut, en 1467, Jean Castriot, prince de Moghiena : Skanderberg, le Cid albanais, léguant à Venise la tutelle de son fils. Onze ans plus tard, les Turcs émiettaient ses ossements pour en faire des amulettes, si grande était sa renommée en pays musulman. Notre Ronsard l’avait chanté, et il fallut que son arrière-petit-fils, le marquis de Saint-Ange, dernier de ses descendants directs, fût tué à Pavie par des Français. Scutari, la Skodra du roi Gentius, la Skodra de Mahmoud le Noir, a gardé de son passé belliqueux la vieille citadelle de Rosaphat. Elle tombe en ruines. Une légende racinienne s’attache à cette place forte. Conquise sur un prince serbe par Bajazet, celui-ci l’aurait rendue en échange d’une jeune fille dont la radieuse beauté faisait rêver le sultan dans ses palais de Brousse et d’Andrinople. La forteresse domine le lac et le réseau de lagunes et de marécages qui le relient à la mer. Parmi les herbes aquatiques, vit une profusion de hérons, de grues et de sarcelles. On distingue des villages de pêcheurs, montés sur pilotis, coiffés de chaume, comme des cités lacustres de nos ancêtres et les huttes tahitiennes au bord des lagons du Pacifique. Les « lundras » des pêcheurs, barques plates aux extrémités relevées, glissent sur l’eau, chargées de poissons étranges, les ouklievas, métis de sardines et de harengs.
Les femmes de la montagne sont descendues pour vendre leurs produits, emmitouflées, engoncées, malgré la chaleur, les malheureuses, comme des Esquimaudes, dans d’épaisses jupes noires à larges godets maintenues par une ceinture de métal. Et puis des corsages, des châles, des bas, des jambières, noirs toujours, et d’un affreux noir à reflets marron : Mme Nanouk à un enterrement. Une lourde frange bombée de cheveux luisants déferle au ras des yeux. Sous leurs fardeaux énormes, ces femmes montrent un visage accablé. Dans les Alpes albanaises, à Boga, petit village au fond d’un ancien lac, commence mon trajet à pied parmi les rudes tribus du Nord (des gens qui, au siècle dernier, mouraient de mort violente dans la proportion de 70 p. 100). Longues étapes en pleine nature sauvage, loin des routes. Le sentier muletier gravit des pentes boisées de sapins et de hêtres, franchit des cols où la neige s’attarde. La route devient pénible et solitaire. Parfois on croise une caravane de petits chevaux agiles à longues crinières — de vrais joujoux, — avec une mèche laineuse en travers du front et des colliers de perles bleues — contre le mauvais œil ... Les cordes et longes sont en poils de chèvre nattés. En tête marchent les femmes, courbées sous le poids des lourds berceaux qu’elles s’accrochent dans le dos. Deux petits bras sortent des couvertures. On dit que les hommes les respectent ; mais ils préfèrent la conversation au coltinage — c’est normal. Eux, les messieurs, suivent tranquillement, la cigarette aux lèvres, à cheval bien souvent, le fusil pendu à l’épaule et passé sous le bras — ventre en l’air et gueule en avant,— ceinturés de cartouchières, pittoresquement vêtus d’une culotte à pont blanche, galonnée de noir (elle a l’air de ne pas tenir et semble dater de leur première communion), et d’une veste brodée. Petit chapeau de clown en feutre blanc sur la tête ; grosses chaussettes de couleur et sandales pointues aux pieds. Ils calent leur bâton derrière les omoplates comme les ours dans les foires. De beaux hommes. Les ethnographes nous les présentent comme les spécimens d’Européens les plus réussis, avec les Écossais. Lamartine les a nommés les « Circassiens de l’Adriatique ». Ce sont ces gaillards qui fournirent des mercenaires, indifféremment, à l’Espagne, à Venise et aux Turcs (à la France aussi, mais ce fut moins heureux). La Grèce leur doit les plus fameux héros de son indépendance, les Botzaris, les Tzavellas, les Karaiskaki, dont les lithographies ornent les bistrots de l’Hellade, furieux batailleurs chers à Victor Hugo, qui allaient incendier sur leurs brûlots la flotte turque ancrée dans les ports les mieux défendus. Théti et sa petite chapelle de montagne ; murs blancs, pignons et toiture en écailles de bois cendrées par le temps. Le pays manque de prêtres ; c’est un franciscain de Scutari qui dessert la chapelle. Catholiques et musulmans, se partageant le pays, ont dressé partout, côte à côte, le minaret et le clocher. Ce manque de cohésion religieuse, aggravé par le fractionnement géographique, a retardé l’indépendance du pays. La contrainte musulmane n’a pas eu raison du ferment chrétien. La race elle-même n’est pas homogène. Les Tosques du Sud diffèrent totalement des Guègues du Nord. Les chrétiens tosques sont en grande partie schismatiques, et les chrétiens guègues adhèrent au rite latin. On dit même que les musulmans tosques sont chiites, et les guègues sunnites. La division du peuple albanais en « phars », ou clans, a été une autre entrave à l’idée de patrie. « La seule chose qui soit immuable chez les Albanais, c’est la passion de l’indépendance et de la gloire. Cette passion de la gloire est le trait dominant de leur caractère et la source de leur héroïsme : c’est la terre des héros de tous les temps. Leur héroïsme se trompe quelquefois d’objet et prend le pillage pour l’ambition. On conçoit qu’Homère y ait trouvé Achille, la Grèce Alexandre, les Turcs Skanderberg, hommes de même race, de même sang, de même génie. » En vérité, on ne comprend pas très bien ce que Lamartine a voulu dire. Serait-ce qu’Achille et Alexandre étaient Albanais ? Comment dire la poésie des étapes villageoises, la paix des heures lasses dans ces hameaux suspendus, l’homérique douceur des accueils ? Jacques SOUBRIER. |
|
|
Le Chasseur Français N°626 Avril 1949 Page 430 |
|
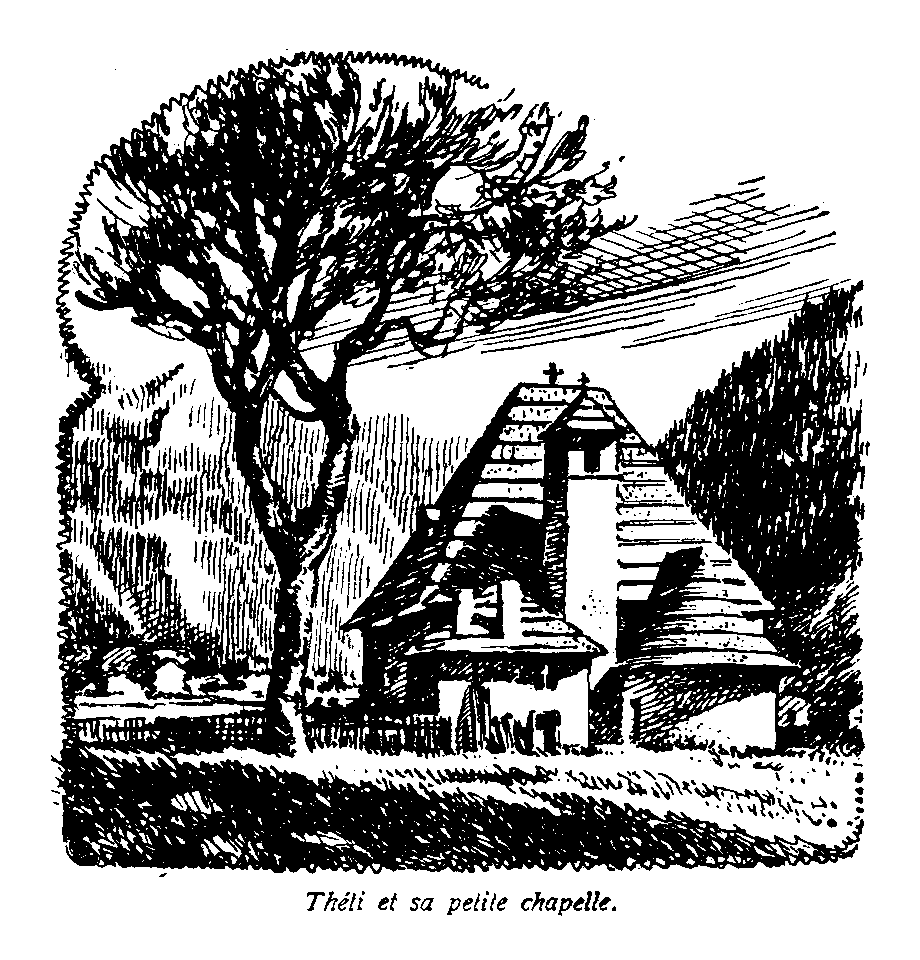 À deux kilomètres de la ville, au pied de la
citadelle, s’alignent les bazars turcs où apparaît déjà l’ambiance
orientale : costumes bigarrés, chiens pelés, chevaux martyrs — sang
et mouches — odeur d’ambre et de poisson pourri, de crasse et de suint, de
poussière et de viande grillée. J’achète un costume de fête albanais : une
veste rouge à la hussarde soulignée de ganses noires, brodée d’argent et d’or
en soutaches. Noir du deuil encadrant le rouge du sang versé sur les champs de
bataille et vengé par les actions d’éclat : les broderies d’or. Pour
compléter : une toque blanche, une chemise brodée, une ceinture multicolore,
un pantalon de laine blanche à galons noirs. Ceux-ci ressemblent aux rubans de
réglisse qu’à l’époque de mes classes j’achetais chez le concierge du lycée.
Tout est neuf, sauf le pantalon. On ne peut pas trouver, paraît-il, de pantalon
neuf. Et il gratte !
À deux kilomètres de la ville, au pied de la
citadelle, s’alignent les bazars turcs où apparaît déjà l’ambiance
orientale : costumes bigarrés, chiens pelés, chevaux martyrs — sang
et mouches — odeur d’ambre et de poisson pourri, de crasse et de suint, de
poussière et de viande grillée. J’achète un costume de fête albanais : une
veste rouge à la hussarde soulignée de ganses noires, brodée d’argent et d’or
en soutaches. Noir du deuil encadrant le rouge du sang versé sur les champs de
bataille et vengé par les actions d’éclat : les broderies d’or. Pour
compléter : une toque blanche, une chemise brodée, une ceinture multicolore,
un pantalon de laine blanche à galons noirs. Ceux-ci ressemblent aux rubans de
réglisse qu’à l’époque de mes classes j’achetais chez le concierge du lycée.
Tout est neuf, sauf le pantalon. On ne peut pas trouver, paraît-il, de pantalon
neuf. Et il gratte !