| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°627 Mai 1949 > Page 435 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
À l'étalage |

|
|
Plus loin, deux sarcelles, deux jolies petites sarcelles d’hiver, deux mâles aux couleurs chatoyantes, à la fine tête où le liséré blanc se dessinait entre vert et marron, poitrail maillé de gris, croupion paré de touches jaune pâle ; le cou allongé, l’aile à demi ouverte, elles paraissaient encore se livrer à l’une de ces ascensions en chandelle dont elles sont coutumières pour dérouter le chasseur et éviter son plomb. Et non loin d’elles, sombre et solitaire, une poule d’eau laissait pendre ses longues pattes vertes, comme quand elles filent au ras de l’eau. Tout le marais, vous dis-je, était là. Car, auprès d’un souchet au bec en spatule, et comme tombés du plein ciel, trois vanneaux, trois pauvres vanneaux aux têtes confondues et pressées dans le même collier, se balançaient, verts et blancs, l’aigrette morne. Où était-elle leur grande plaine unie, parsemée de flaques luisantes, où leurs silhouettes dressées, toujours aux aguets, mettaient des taches mouvantes qui, soudain, d’un bond, devenaient de grands papillons aux dessous de neige ? La « petite reine » était là, elle aussi, pauvre éclair aujourd’hui éteint, au plumage terni et ébouriffé, et dont le bec démesuré avait tant piqué dans les vasières. Un couple de pluviers dorés, liés par le bec comme pigeons se becquetant, montrait leur gris plumage moucheté d’or, à côté d’un courlis au bec bizarrement courbé. On voyait même, parée des teintes rousses de l’automne, la mystérieuse dame mordorée, princesse royale des sous-bois ombreux, mais que l’on trouve aussi près des marais voisins. Ronde, dodue, elle attisait la gourmandise. Enfin, tout en haut, comme posées en file sur la même branche, tout une brochette de grives : jolies musiciennes, grosses litornes gris cendré, petites mauvis aux retroussis cuivrés. Ce sont là hôtes des bosquets et des haies ; mais ne les trouve-t-on pas, elles aussi, au marais, quand, aux approches du printemps, et lorsque buissons, sorbiers et alisiers ont perdu, durant les frimas, leurs dernières baies, elles vont chercher dans les lieux mouillés les vers qui y foisonnent ? Je contemplai longtemps tous ces pauvres corps pantelants, aux plumages ternis, dont les yeux, si vifs quand la vie les éclaire, étaient si enfoncés dans leur orbite qu’on ne les apercevait plus. Je ne voyais, en eux, non pas que des mets destinés à orner les tables cossues et à flatter les palais gourmands et sensuels, mais des habitants de ces grandes solitudes qu’aiment à parcourir les chasseurs. Je regardais s’arrêter les passants, curieux seulement des prix inscrits sur les étiquettes. Se doutaient-ils un peu de tout ce qu’il y avait de mystère dans ces pauvres choses sans vie ? Savaient-ils, eux gens des villes, dont la plupart ignorent tout des choses de la nature, les distances infinies qu’ils avaient parcourues, les cieux qu’ils avaient sillonnés, les pays lointains qu’avaient survolés leurs ailes robustes, les tempêtes qu’ils avaient affrontées avant de venir échouer là à l’étal d’un marchand ? Grandes plaines polonaises, côtes découpées du Danemark, brumes épaisses des mers nordiques, marécages et forêts sans fin de la Prusse-Orientale, polders et lagunes de Hollande, baies de nos fleuves de France les avaient vu défiler, haut dans le ciel, par bandes joyeuses ou en longues files déployées qui laissaient en chemin, sur leur passage, toujours quelqu’un des leurs, payant ainsi, chaque année, le lourd tribut aux bêtes ennemies et aussi à la grande passion des chasseurs. Combien de fois avaient-ils fait le voyage dont le dernier venait de s’achever ? Si ces grands voyageurs que sont les migrateurs pouvaient un jour parler, que de choses magnifiques et inconnues de nous, leurs supérieurs, dit-on, ne nous apprendraient-ils pas ! Pour moi, je restai là pensif un long moment, mon regard allant de l’un à l’autre, après avoir répondu au marchand qui me demandait ce que je désirais : « Mais rien, monsieur, je regarde, simplement », ce qui le fit se retourner en levant les épaules. Mais que de choses intimes, que de souvenirs renaissaient dans mon âme de chasseur ! Peut-être ces canards, suivant la grande vallée du fleuve dont j’avais tant parcouru les rives, s’étaient-ils posés un jour au bord des galets que mes bottes avaient foulés. Qui sait, me disais-je, s’ils ne se sont pas arrêtés là où, naguère, mon plomb a fait tant de. victimes ? Peut-être ces deux bécassines ont-elles vermillé dans les marais de la Garenne et connaissent-elles les touffes de joncs des gravières où plusieurs ont fait, sous mon plomb, à ma grande joie, leur dernier crochet ? Ne les ai-je pas entendues passer, quelque soir, invisibles dans la nuit, poussant leur kreek ! kreek assourdi, quand je faisais la passée aux canards ? Des vanneaux, il y en avait aussi, chaque année, dans les grandes étendues de galets qui s’étalent entre les marais et les pins ; peut-être ces trois-là étaient-ils parmi les bandes que l’on poursuivait inlassablement, mais qui se levaient toujours hors de portée. Et cette bécasse, l’oiseau qui a toujours fait battre mon cœur à l’approche de Novembre, et dont le grand œil noir renferme toute la mélancolie de l’automne, n’aurait-elle pas, pour arriver jusqu’ici, fait escale en quelque bois connu, bois du Betz, bois des Ages, sombre bois des Dames, forêts du Lubéron ou du Levézou, où mes Jambes ont tant couru ? ... Elle est peut-être passée de l’un à l’autre, un jour là, un jour ailleurs, au gré de sa fantaisie et des vents, ou suivant quelque ruisseau dont je connais bien les abords. Quant aux grives, leur bande ne s’est-elle pas posée, en cours de voyage, sur un de ces sorbiers ou de ces alisiers où, blotti dans ma cabane de branchages, j’en ai tant abattu dans le matin naissant ? ... Mais ma rêverie fut interrompue par le bruit de ferraille d’un tramway qui passait. Un couple en descendit, qui s’arrêta devant l’étal : « Ce sont des bécasses », dit, d’un air entendu, l’homme à sa compagne en lui montrant les canes. Je n’en attendis pas davantage, et, tournant les talons, repris mon chemin parmi la foule toujours pressée et indifférente. FRIMAIRE. |
|
|
Le Chasseur Français N°627 Mai 1949 Page 435 |
|
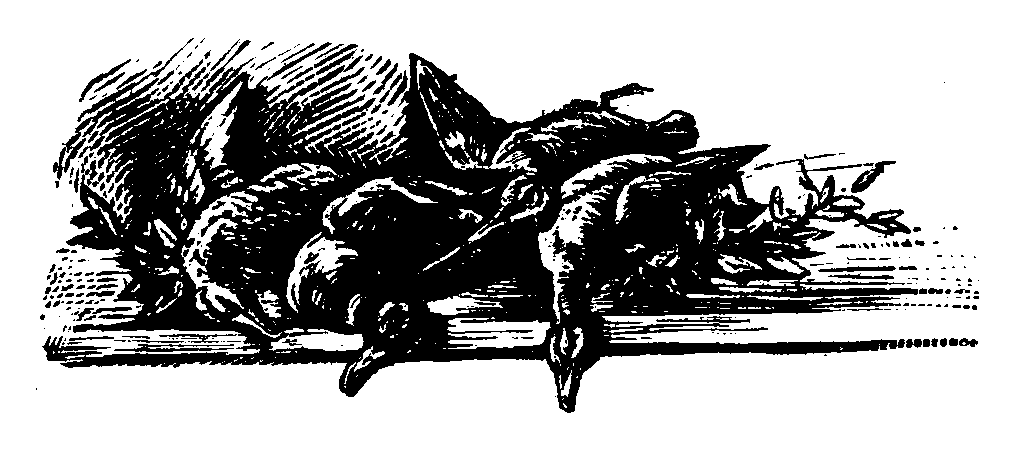 Je les ai vus ce matin, par ce jour doux et embrumé
de décembre, si doux qu’il faisait plutôt penser à une matinée de printemps.
Ils étaient là réunis, offerts à la vue et à la gourmande convoitise des
passants. Au beau milieu trônait, comme de juste, un magnifique colvert, dont
la tête et le cou resplendissaient de reflets d’émeraude, avec le mince collier
blanc, le large poitrail aux rousseurs luisantes et l’épaisse cuirasse du duvet
garnissant les dessous. Je m’amusai à dérouler du doigt le bel accroche-cœur
bronzé de son croupion, qui, tel un ressort, se recroquevillait chaque fois que
mon doigt le lâchait. Auprès de lui deux canes se pressaient, plus petites,
deux canes à la livrée terne, sans parure, uniformément grises, qui semblaient
se blottir auprès de leur beau mâle, comme lorsqu’elles l’accompagnaient,
fidèles, sur le marais lointain.
Je les ai vus ce matin, par ce jour doux et embrumé
de décembre, si doux qu’il faisait plutôt penser à une matinée de printemps.
Ils étaient là réunis, offerts à la vue et à la gourmande convoitise des
passants. Au beau milieu trônait, comme de juste, un magnifique colvert, dont
la tête et le cou resplendissaient de reflets d’émeraude, avec le mince collier
blanc, le large poitrail aux rousseurs luisantes et l’épaisse cuirasse du duvet
garnissant les dessous. Je m’amusai à dérouler du doigt le bel accroche-cœur
bronzé de son croupion, qui, tel un ressort, se recroquevillait chaque fois que
mon doigt le lâchait. Auprès de lui deux canes se pressaient, plus petites,
deux canes à la livrée terne, sans parure, uniformément grises, qui semblaient
se blottir auprès de leur beau mâle, comme lorsqu’elles l’accompagnaient,
fidèles, sur le marais lointain.