| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°627 Mai 1949 > Page 440 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
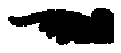
|
Le tir de chasse devant les chiens |
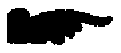
|
|
Le tir, la chasse et les chiens, qui, au premier abord, paraissent indissolublement liés, sont, en réalité, trois choses différentes. On peut tirer sans chasser. Il n’est pas difficile de chasser sans fusil et sans chiens, avec un furet et des bourses. Enfin, en ayant recours à de bons chiens, on prend, quand on en est capable, sans brûler une cartouche. Certes, lorsque, à force de pratiquer le tir, la chasse et les chiens, on arrive à coordonner leur action, ils s’entendent, à merveille tous les trois et forment un tout idéal, trop naturel en apparence pour l’être effectivement. Rares, en effet, sont ceux qui savent y parvenir. Ainsi : qui tire bien connaît mal la chasse et ignore tout des chiens, qu’il n’aime pas ! Qui n’est pas trop novice en l’art de chasser n’arrive pas à tirer convenablement ! Qui s’entête à s’accompagner d’un chien n’est pas capable de le conduire ! L’absence d’un membre de l’association : tir, chasse et chiens, dénature le tir de chasse. On le confond alors avec la contrefaçon du tir de chasse intégral, c’est-à-dire avec le tir de chasse devant les chiens. Il est bon de faire une distinction entre le « tir de chasse » et le « tir à la chasse ». Ce n’est pas du tout la même chose. Aussitôt qu’on abandonne la plaque pour pointer un fusil de chasse sur un but en mouvement, on pénètre dans le domaine du tir de chasse. Cependant, il n’est pas nécessaire, pour s’y livrer, que ce but fuyant soit représenté par une pièce de gibier. Le ball-trapp est là pour le prouver. Par d’ingénieuses combinaisons de projection, il reproduit, autant qu’il est possible, les principales directions d’envolées, telles qu’elles se produisent à la chasse. Il s’en rapproche dans le rapport où sa complexion de catapulte lui permet d’imiter la nature. Quoi qu’il en soit, il propulse, dans un style de démarrage foudroyant, une coupelle friable qui prend son départ avec une vitesse extrême appelée à décroître au lieu de s’accentuer, comme celle du gibier, à mesure que la distance s’allonge. Nous citons cette particularité, connue de tous les tireurs, simplement pour marquer la première différence initiale qui commence à creuser le fossé séparant le tir de chasse et le tir à la chasse. Malgré toutes les précautions prises par le premier pour s’amalgamer au second, il ne peut empêcher qu’on s’attaque à un but inerte, qui est mort avant d’être mis en miettes par les plombs, et ne possède que la vie artificielle sans réflexes dont on s’efforce de l’animer. En plus de cela, les faits et les circonstances qui entourent le tir, dans un stand, sont peu comparables à ceux qui vous attendent sur les divers terrains où l’on chasse. Au stand, on a toujours le temps de se placer à sa guise, et l’on peut user de la possibilité qui vous est offerte de tenir son fusil épaulé, afin de lancer le coup plus rapidement. On commande, également, soi-même, le départ du pigeon d’argile : complaisance assez peu dans la manière du poil et de la plume. Donc pas de surprises et, par conséquent, suppression d’une grande part des émotions qui vous guettent à la chasse. La seule capable de vous troubler, sur la planche, se rencontre dans la gêne et dans l’énervement qui s’en suit de tirer en public, car il est bien rare, à moins d’un cas particulier, de s’adonner au ball-trapp à l’écart de toute compagnie. Cette sorte d’émotion n’étreint d’ailleurs pas souvent ses fidèles habitués. L’avantage est grand de ne se heurter à l’imprévu que sous des formes prévisibles ! Il existe cependant de par le monde des écoles spéciales, dites : de chasse, où l’on s’emploie à masquer l’imprévu avec une bonne volonté méritoire, au long d’un parcours s’étendant sur un terrain, tantôt boisé, tantôt découvert, s’efforçant de représenter celui qu’on bat le plus communément à la chasse. Dans la pratique, cette bonne volonté se manifeste par l’apparition d’un pigeon d’argile prenant brusquement son essor, ou d’un chariot, portant une silhouette de lapin, s’enfuyant sur ses rails. C’est, en somme, de l’incertitude ordonnée qu’on vous apprend à vaincre méthodiquement pour la transformer en routine. De même que l’imprévu, la préoccupation de ne pas manquer devient inexistante. Lorsqu’on tire à côté d’un but artificiel, on a la facilité de le remettre tant qu’on veut au bout de son fusil. C’est une énorme supériorité. À la chasse, il en va autrement : c’est elle qui commande et distribue les chances de tirer. Le souci de ne pas manquer une occasion dont le retour n’est pas assuré vous talonne, vous crispe et vous laisse dans une disposition morale peu favorable au tir. Chaque École de Chasse enseigne sa méthode. C’est une excellente chose en ce qui concerne les débutants, exception faite pour les tempéraments trop récalcitrants. En revanche, elle l’est moins pour ceux qui ont déjà chassé et se sont façonné une manière de tirer parfois très différente de celle qu’on veut leur inculquer. Lorsque des habitudes considérées comme mauvaises sont bien ancrées, il est plus sage de les exploiter, autrement dit de tenir compte de leurs exigences, au lieu de vouloir les détruire. Qu’elles proviennent de la complexion du tireur ou d’une arme mal adaptée à laquelle il a voulu s’accoutumer coûte que coûte, elles ont des racines profondes d’une extraordinaire vitalité. Dans la réalité des choses et des faits, les méthodes proposent et la chasse ordonne. Une conception du tir de chasse, aussi parfaite semble-t-elle être, ne peut répondre à toutes les éventualités. C’est pourquoi les Écoles de Chasse sont utiles tant qu’on ne regarde pas le tir qu’elles enseignent comme la reproduction exacte de celui qu’on pratique à la chasse. À la chasse, les circonstances inconnues à l’École ne sont pas rares, auxquelles il faut bien faire face avec les seuls moyens du bord. On doit donc ne pas trop s’étonner si, pour y parvenir, on ne fait guère de différence entre les bonnes et les mauvaises habitudes. On se trouve devant la conséquence normale de ce que les trois quarts des chasseurs n’ont pas reçu du sort la faveur d’en récolter de bonnes. Le petit chasseur surtout, que rien n’a préparé aux difficultés du tir de chasse. Pour se familiariser avec elles, il n’a généralement ni ball-trapp, ni assez de gibier à sa disposition : il est donc naturel qu’il s’y prenne comme il peut. Qu’on veuille bien ne pas s’y tromper ! Cette remarque n’est pas un éloge des mauvaises habitudes. Si l’on parvient à ne pas tirer trop mal en s’y abandonnant, elles sont loin d’être obligatoires. Notre ambition se borne à expliquer pourquoi le tir à la chasse est un exercice spécial où le facteur personnel est prépondérant devant les initiatives à prendre, et qu’on doit isoler de tout ce qui n’appartient pas à son essence particulière, pour en saisir les complications séduisantes. Le tir a la chasse exige la chasse, et ce petit bout de phrase est moins chargé de naïveté qu’il n’en donne l’impression ! Il s’acquiert, ce tir, par la chasse elle-même, et non par des instructions théoriques. L’auxiliaire naturel de la chasse est le chien. Sans lui, à part de rares exceptions, elle se réduit au simulacre d’elle-même. Il la situe à sa place exacte et lui donne son vrai caractère, ce qui permet au tir qu’elle provoque de jouer loyalement son rôle conclusif sans falsifier les contingences. Nous verrons par la suite ce que peut être son mécanisme dans la pratique. Raymond DUEZ. |
|
|
Le Chasseur Français N°627 Mai 1949 Page 440 |
|