| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°627 Mai 1949 > Page 449 | Tous droits réservés |
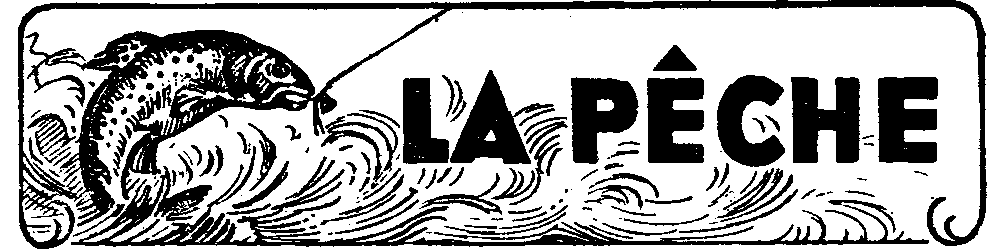
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
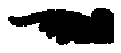
|
L'anguille |
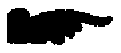
|
|
Faut-il protéger l’anguille ? ... Non. Faut-il la proscrire ? ... Non. Faut-il donc laisser faire la nature ? ... Non encore. Telles sont les réponses à la petite enquête faite par votre serviteur deux ans avant la guerre de 1939, et qui n’avaient encore pas pu trouver place dans ces colonnes. « Et alors ? diront nos confrères, que convient-il donc de faire à son égard ? » Ne pas la détruire tout à fait, mais chercher à en diminuer le nombre là où elle abonde par trop, telle est la solution de sagesse qui s’impose.
Au rebours des anadromes : aloses, esturgeons, lamproies et saumons, dont la croissance se fait en mer et qui nous fournissent un apport fort appréciable de nourriture qui ne coûte presque rien à notre cheptel aquatique, il en est tout autrement de l’anguille. Celle-ci, née en mer fort loin de chez nous, pénètre dans nos fleuves à l’état d’alevin (civelles, piballes, bouirons, etc.), les remonte, ainsi que nombre de leurs affluents, et s’y nourrit en décimant nos espèces autochtones. Devenue adulte, engraissée à nos dépens, elle redescend à la mer, et — entendez-vous bien ? — nous ne la reverrons plus ; elle est, désormais, entièrement perdue pour nous. À vrai dire, il nous faut cependant faire une discrimination. Les mâles ne remontent guère au delà de la limite des eaux saumâtres où le flux de la marée se fait encore sentir. Ces poissons n’atteignent pas une forte taille et ne sont pas bien nocifs, car ils trouvent dans les estuaires une nourriture très abondante de larves, vers, mollusques et crustacés marins ; ils ne s’attaquent guère aux poissons. Ce sont ces mâles que capturent en quantité nos pêcheurs des régions côtières, notamment en les péchant à la « vermée ». Ceux-ci, on peut les négliger. Malheureusement, il n’en est pas de même des anguilles femelles. Celles-ci parviennent très haut dans beaucoup de nos cours d’eau ; j’en ai trouvé jusque dans nos rivières à truites du Velay, à quelque 800 kilomètres de la mer. Elles sont d’une voracité inouïe ; au bout de seulement quelques mois, elles atteignent 0m,70 de longueur et le poids de 700 à 800 grammes. On conçoit qu’une croissance aussi rapide ne se fait pas sans dommage pour nos espèces indigènes, si l’on sait que ces anguilles dévorent les œufs sur les frayères et les petits alevins du premier âge incapables de se soustraire au danger par la fuite. Et que dire de ces grosses femelles de 4, 5, 6 livres et plus, capturées si rarement par nos pêcheurs. Leurs organes sexuels, atrophiés pour une cause inconnue, annihilent en elles l’instinct de migration et elles ne redescendent plus à l’Océan. Cantonnées dans les profondeurs ou dans les lieux remplis d’obstacles et d’inviolables cachettes, elles n’en sortent que la nuit pour dévorer les œufs par myriades, s’attaquer aux alevins des grandes espèces et aux adultes des petites : goujons, loches, chabots, vérons, etc. Quels poissons pourraient vivre dans un milieu peuplé de grosses anguilles ? Aucun. Elles font le vide autour d’elles dans un périmètre souvent important. Or nous ne sommes point suffisamment armés pour combattre d’aussi sournois adversaires. La pêche à la ligne — d’ailleurs peu efficace — est formellement interdite pendant la nuit. Il est, en outre, rigoureusement défendu aux membres des sociétés de poser, dans leurs lots amodiés, des cordeaux de fond, même durant le jour. Si les fermiers de pêche jouissent d’un peu plus de latitude à cet égard, c’est toujours en quantité insuffisante qu’ils peuvent délivrer des permis de cordeaux et d’engins tels que : nasses, tambours, verveux, bosselles, etc. Quant aux filets : carrelets, éperviers, sennes, tramails, trubles, etc., ils ne prennent les anguilles que très rarement. Le meilleur remède à la situation ci-dessus exposée consisterait dans le recours aux mesures suivantes : 1° Faculté, pour les sociétés de pêcheurs à la ligne dont les lots sont réellement menacés, de faire poser par leurs gardes assermentés des cordeaux de nuit appâtés uniquement d’ablettes mortes séchées au soleil, dont l’anguille est friande, mais que les autres poissons dédaignent. 2° Licence, aux fermiers, d’accorder un nombre de permissions de cordeaux ainsi appâtés supérieur à celui actuellement admis, amplification du nombre d’engins fixes et surtout des bosselles qui ne prennent guère que les anguilles. 3° Autorisation donnée à certains meuniers, usiniers, etc., de placer à demeure, au coursier de leur établissement, des nasses ouvertes du côté amont, pendant les quelques semaines que dure « l’avalaison » des anguilles (10 octobre à début novembre). 4° Rétablissement, pendant la même période, des anciens « gords » partout où ce sera possible. 5° Intensification de la pêche des civelles et livraison facilitée de cette excellente friture aux grands centres urbains. Si la coordination parfaite de ces diverses mesures pouvait être obtenue, il peut sembler possible de constater, dans un temps passablement réduit, la diminution, en assez forte proportion, du nombre de ces poissons indésirables et, dans une large mesure, l’atténuation de leurs méfaits. C’est là tout ce que, présentement, on peut raisonnablement demander et obtenir ; je crois être à peu près sûr d’être d’accord en cela avec les nombreux confrères qui ont à se plaindre des ravages des anguilles, dans leurs cantonnements de pêche. R. PORTIER. |
|
|
Le Chasseur Français N°627 Mai 1949 Page 449 |
|
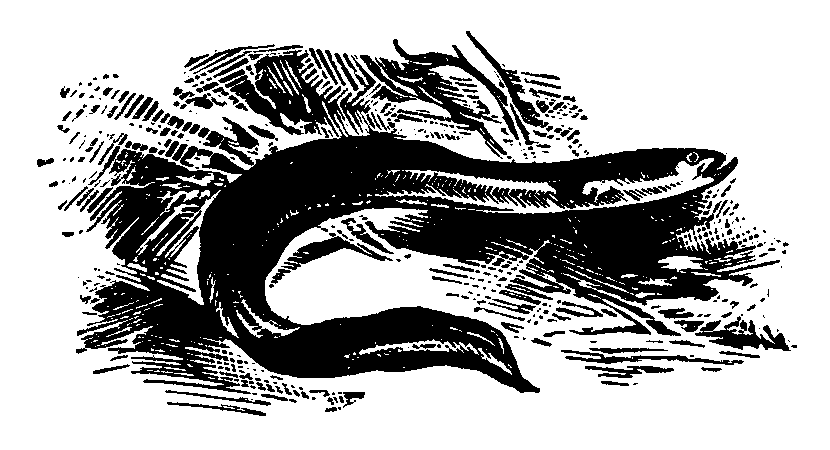 Car, si l’anguille est un excellent manger, elle se
montre aussi fort nuisible pour nos si précieux poissons indigènes.
Car, si l’anguille est un excellent manger, elle se
montre aussi fort nuisible pour nos si précieux poissons indigènes.