| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°631 Septembre 1949 > Page 632 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Chasses de brousse

|
La mort de Kpo la panthère |

|
|
À Abidjan, je fis connaissance de ceux qui ont appris la forêt et qui la violent avec leurs mains de tâcherons. Il faut avoir des mains pour monter dans le bois, pour mener cette vie des coupeurs qui m’a passionné quelques semaines. Et je remontais du côté d’Agboville où, à une trentaine de kilomètres de la voie ferrée, je devais trouver une exploitation magnifique et des chantiers dont je parlerai. Sur le sentier que nous suivions, après avoir quitté l’auto, la forêt se referma et les noirs qui nous faisaient la route taillaient, abattaient au coupe-coupe, à la matchette, la végétation qui se liait et rendait le passage inextricable. Les derniers qui avaient pris ce raccourci ; c’étaient les porteurs de vivres montés il y a quinze jours pour le ravitaillement.
Depuis, j’ai vu les ramifications qui portent les voies à wagonnets pour le transport des bois, des outils, des manœuvres. C’est par un de ces engins que je fus porté à une quinzaine de kilomètres de là, en pleine forêt, chez un maître de chantier qui vivait seul avec son fusil, son chimpanzé et son perroquet, et conduisait un chantier de deux cents hommes du bois. La case était vaste et haute, montée en rondins à peine équarris, avec une large véranda pour abriter du soleil et un triple toit pour défendre de la pluie. Un marmiton noir cuisait les repas du chef, qui menait une vie solitaire, avec une bibliothèque bien montée, des disques pour son phono, et une imposante réserve de boîtes de conserves. Avec un pisteur indigène, qui n’avait pas son pareil pour appeler sous le couvert la biche harnachée, il « faisait la viande », presque chaque jour, pour ses travailleurs, abattant antilopes, éléphants et de ces grands singes rouges qui peuplaient les arbres dans les étroites clairières où il m’entraîna à sa suite pour des guets à la grosse bête, si dangereuse à chasser en forêt. Mais mon compagnon était un fameux fusil. Je veux raconter une aventure assez curieuse qui nous arriva dans une de ces sorties. On trouve rarement une panthère dans ces verdures trop épaisses, et c’est pourtant d’une panthère qu’il s’agit. Ce coupeur emmenait parfois à la chasse son singe. La bête était très familière et comprenait certainement pas mal des intentions de son maître. Nous en avons eu la preuve maintes fois. Ce jour-là, nous étions sortis de très bonne heure, par temps bouché. Une brume dans laquelle on suffoquait, tellement elle était chaude, épaisse. Monsieur — car ce chimpanzé s’appelait « Monsieur » — suivait dans nos pas comme il avait l’habitude de le faire, s’arrêtant quand nous prêtions attention à quelque mouvement de la forêt, épiant comme nous, immobilisant ses yeux, qui d’habitude tournaient bien rond dans l’orbite, nous singeant avec une fidèle application. Nous cherchions cette belle antilope de forêt dont le pisteur avait la veille relevé la trace, et qui devait venir boire à une mare claire qu’il s’agissait d’aborder à travers un poto-poto, la boue qui enlise. Nous avions cherché un passage. Le jour allait naître. J’ai dit la belle exubérance de la première fusée de lumière sur la savane. En forêt, le matin à moins de franchise et le ciel semble prendre bien plus de la terre qu’il ne donne. Le jour est, comme tout dans le bois, poussée végétale, effort du vert, et fièvre des boues. Par où tomberait un rayon de clarté, de cette clarté qui ne réussit qu’à sourdre au plus violent des midis clairs ? Le prestige du matin est plus secret en forêt, mais il procure une émotion étrange, parce qu’on craint que le tour de magie rate, et que, d’un seul coup, la nuit souillée de traînées claires n’absorbe ces lueurs surnaturelles. Rien ne vient du ciel, l’aube arrive au ras du sol, dans les racines, les sous-bois de mousses, et c’est l’arbuste qui s’allume, la feuille qui luit, les frondaisons qui se chauffent, et comme par en dessous, de reflets blafards. En même temps, le bois s’élève. C’est l’ascension quotidienne des fûts géants, ces cimes tendues, comme en montagne d’hivers blancs à la montée des pics, quand les monts se redressent, prennent toute leur taille et qu’arrive avec le jour la dernière aiguille, la « demoiselle » du silence, toute rose de la première caresse. Mais la montagne a le sang vif. La grande forêt s’exhausse avec lenteur. Devant nous, dans les éclaircies des branchages, la mare était déjà un centre, un miroir de cette lumière suspendue dans le brouillard. Nous avancions avec précautions. Le moment était unique. Tout à coup, Monsieur qui, jusque-là, nous suivait, passa d’un souple bond silencieux devant son maître, s’immobilisa, barrant l’étroite piste. Je ne puis pas dire maintenant : j’ai vu le geste. Non ... L’ordre était dans la mimique du visage, l’expression du regard. Monsieur, impérieusement, comme un chien d’arrêt, immobilisait un morceau de cette brousse, interdisait toute fuite, toute évasion, et il offrait ce monde soumis au bon plaisir de son maître. Ce n’était pas l’antilope ... l’antilope qui était là, en train de boire et que mon camarade et moi avions aperçue, d’abord par son image dans l’eau. Nous n’étions pas seuls à être venus l’attendre. Se peut-il que sans le secours d’un geste, d’une indication, enfin, de ce chien vertical, figé, et c’était peut-être dans la peur, nous ayons, ensemble, tourné la tête et cherché du regard, non pas sur le sol, mais en haut, dans les branches où elle s’était tapie, la panthère ... si sombre de pelage, si luisante dans des reflets d’encre que je crus un moment avoir la chance de trouver la panthère noire que certains prétendent imaginaire, et que certains chasseurs assurent avoir abattue en Afrique du Sud. Non ... C’était bien Kpo, la panthère au manteau brun jaunâtre, marquetée de taches noires, Silgou des Peuls du Soudan.
J’ai passé quelques semaines sur ces chantiers d’abatage. Le matin, l’annonce du travail était faite par un gong, un morceau de rail pendu à un fil de fer, près de la case du chef. Le village des travailleurs était à quelque cent mètres de là : les mêmes baraques de rondins, les feux à trois pierres, campement habituel des coupeurs. La pluie ne cessait pas. J’avais pris la formule vestimentaire de mon compagnon et je sortais seulement vêtu d’un slip de bain, pour avoir un « blanc » sec à endosser quand nous revenions à la case. Il pleuvait sans arrêt, sur les chantiers des tronçonneurs, des scieurs, garçons qui équarrissaient à la matchette et qui étaient d’une habileté rare pour tailler les lames d’écorce jusqu’au bois, pour donner au tronc cette forme de parallélépipède, qui est celle des billes marquées au feu ou par cloutage, à la marque du chantier. Dans la pénombre verte où monte, sucrée, fade, enivrante et malsaine, l’odeur de boue végétale, de mousses qui pourrissent en eau, de déchets, d’écorces odoriférantes, dans la moiteur sourde qui fait en même temps sourdre votre sueur pénible dans cet air mouillé, saturé d’eau, c’est une agitation étonnante. René GUILLOT.Illustrations d’après Pierre Dandelot. |
|
|
Le Chasseur Français N°631 Septembre 1949 Page 632 |
|
 La belle découverte ... Nous arrivons dans une
zone déboisée où on a construit une scierie à vapeur avec une locomotrice dont
le volant est immense. Je le regarde. Il n’a pas, depuis la voie ferrée,
traversé la forêt en pièces détachées ... C’est une imposante masse de
fonte, d’un bloc. Alors, on me dit comment il fut porté, dans des temps
héroïques, où il fallait conquérir la brousse à pieds nus. Sur la tête ...
Oui ... Trois cents porteurs soutenant une gigantesque plate-forme de
planches sur qui reposait le volant. On dressait la masse à bout de bras, au
sifflet. On marchait dans la forêt ouverte au chant de l’homme, On reposait à
terre au sifflet ... Il n’y avait pas d’autre moyen.
La belle découverte ... Nous arrivons dans une
zone déboisée où on a construit une scierie à vapeur avec une locomotrice dont
le volant est immense. Je le regarde. Il n’a pas, depuis la voie ferrée,
traversé la forêt en pièces détachées ... C’est une imposante masse de
fonte, d’un bloc. Alors, on me dit comment il fut porté, dans des temps
héroïques, où il fallait conquérir la brousse à pieds nus. Sur la tête ...
Oui ... Trois cents porteurs soutenant une gigantesque plate-forme de
planches sur qui reposait le volant. On dressait la masse à bout de bras, au
sifflet. On marchait dans la forêt ouverte au chant de l’homme, On reposait à
terre au sifflet ... Il n’y avait pas d’autre moyen.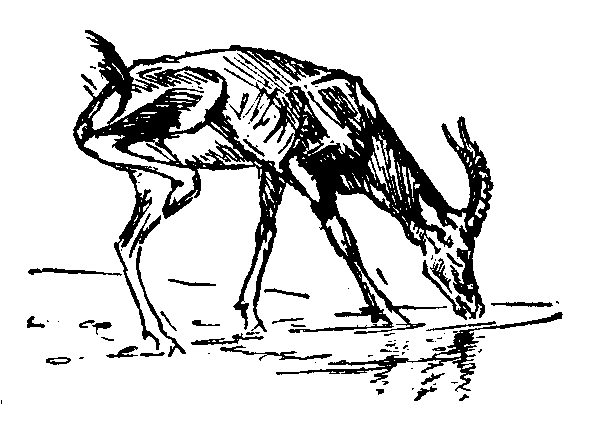 L’antilope a dressé ses cornes au coup de feu, et
elle s’est élancée en ouvrant du poitrail, le bas fourré. Kpo est tombée comme
une feuille morte.
L’antilope a dressé ses cornes au coup de feu, et
elle s’est élancée en ouvrant du poitrail, le bas fourré. Kpo est tombée comme
une feuille morte.