| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°632 Octobre 1949 > Page 676 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Le cerf-volant |

|
|
Il ne s’agit pas du coléoptère à larges pinces, ainsi nommé par les écoliers, et que les bienheureux gosses des pays où l’on en trouve se font un malin plaisir de couler dans le cou ou dans la culotte de leurs condisciples. Il s’agit d’un cerf-volant authentique, en papier ou en toile, dont on peut attendre dans certains cas de surprenants effets. Je déjeunais, il y a bientôt... mettons trente ans, sur un des belvédères les plus fréquentés des Alpes. Comme de juste, la cohue des pseudo-touristes n’avait point ménagé les peaux de saucissons et les écorces d’oranges qui, avec les papiers gras, jalonnent la piste de la civilisation en marche. Il convient cependant de laisser la nature aussi propre en sortant que l’on désirerait la trouver en entrant ; aussi, muni d’une canne ferrée, j’eus vite fait de me transformer en « mousquetaire ». Le mot de « mousquetaire » est un des plus jolis de l’argot parisien, il désigne ceux des jardiniers du Bois de Boulogne qui, armés en guise de rapière d’une tige de fer aiguë à poignée de bois, piquent au hasard de leur promenade tous les papiers laissés sur les pelouses par les promeneurs en mal de pique-nique.
Ce furent les cris d’étonnement des assistants qui me firent lever la tête. Là-haut, il y avait maintenant trois grandes buses de montagne, qui tournaient en rond à la suite l’une de l’autre, et de temps en temps l’une d’elles se détachait, piquait à fond sur un des bouts de papier voltigeants et l’empoignait à pleines serres, croyant sans doute tenir quelque oiseau. On entendait nettement le choc, et le crissement du papier déchiré. Puis le rapace remontait, déçu, pour se précipiter une seconde fois sur un nouveau leurre. Et cela dura jusqu’à épuisement du stock, les oiseaux continuant longtemps encore à tourner en rond, en cherchant sans doute l’explication du phénomène. Souvent j’ai songé que l’on pourrait ainsi, au moyen d’un cerf-volant de petite taille, attirer les oiseaux de proie à portée de fusil, mais je ne sais pourquoi je n’ai jamais fait cette expérience. Par contre, un de mes amis suisses s’y est livré tout un automne, et voici l’essentiel de ce qu’il a constaté. Le cerf-volant, en papier tendu sur des baguettes, avait la forme d’un oiseau, les ailes ouvertes, peint de brun moucheté de blanc. Il en avait été fabriqué une dizaine d’exemplaires, qui ne furent pas de trop. Une ficelle légère — en fait une grosse soie de pêche à lancer — permettait la montée sans trop charger l’appareil. Il fallut chercher assez longtemps une crête offrant quelques broussailles, où pouvoir se cacher à la vue perçante des rapaces. Finalement un endroit parfait fut repéré, au-dessus d’une forêt, où l’on voyait souvent se poser des buses, et à proximité d’une grande paroi rocheuse où nichaient deux aigles. Le premier cerf-volant fut lancé, et arrêté à environ 40 mètres de corde. Dix minutes plus tard, il était complètement démoli par les attaques d’un tourbillon de corneilles et de choucas. Un second eut instantanément le même sort. L’aventure s’annonçait assez mal. Pourtant, en utilisant les périodes où tous ces « corbeaux » étaient sans doute occupés ailleurs, les expérimentateurs arrivèrent à faire voler tranquillement leur engin, l’un surveillant la venue possible des corneilles, l’autre prêt à rentrer la « ficelle » à grandes brassées. Il y eut des cresserelles qui venaient « faire le Saint-Esprit » à proximité, sans attaquer. Les buses se décidèrent, mais il fallut pour cela « lâcher » près de 100 mètres. La proximité de la crête — et le fil, qu’elles voyaient certainement — les rendait méfiantes. Elles vinrent tourner à proximité, poussant leurs cris aigus, et se tinrent sur leurs gardes. Tous les essais pour les faire descendre en ramenant sournoisement le fil furent vains. Cependant le fil ne faisait point retour directement à la cachette des observateurs, mais à une quinzaine de mètres de là, à un point de l’arête herbeuse, parfaitement nu, où un anneau de rappel avait été fixé à un piquet invisible, enfoncé de toute sa longueur. Quant aux aigles, ce fut une autre histoire. Ils partaient tous les jours ensemble de leur vire rocheuse, pour s’en aller très loin, selon la tradition constante des oiseaux de leur race, qui évitent de faire des dégâts dans le voisinage de leur aire. En un quart d’heure, ils étaient sortis de la vallée et avaient gagné leur territoire de chasse dans un massif montagneux voisin. N’ayant point de petits, à l’automne, ils ne revenaient pas à intervalles réguliers, chargés de leurs prises, mais mangeaient n’importe où, au hasard des captures. Le soir seulement, peu avant le coucher du soleil, on les voyait revenir très haut, rentrant à leur perchoir de roc. Pendant plusieurs jours, ils semblèrent ne point voir le cerf-volant, puis un soir ils se décidèrent, eux aussi, à planer pour l’observer. Les expérimentateurs avaient monté un leurre de couleur plus claire, presque blanc, et lui avaient donné toute la ficelle disponible, environ 150 mètres, de sorte que le vent balançait le faux oiseau en oscillations d’une plus grande amplitude que d’ordinaire. Soudain, un de ceux qui regardaient les deux aigles à la jumelle vit le plus gros — la femelle — replier ses ailes vers la queue et basculer, la tête en avant. En un éclair, comme tombe une pierre, il fut sur le cerf-volant, l’agrippa, le déchira, cassa la ficelle de soie, puis, lâchant sa prise, remonta en ramant puissamment des ailes. Un instant ils tournèrent en criant, descendant peu à peu, comme curieux d’en savoir plus long, puis ils durent distinguer les deux hommes blottis sous une voûte de branchages entrecroisés, car ils partirent soudain tout droit, du côté opposé à leur station accoutumée. Et on ne les revit jamais. Une fois leur méfiance éveillée, ils quittèrent définitivement la vallée. Les buses continuaient à tourner, les corneilles à s’acharner avec colère ; un jour, un milan noir passa, rapide. Mais les deux aigles considéraient maintenant cet oiseau artificiel avec le plus profond mépris. Les chasseurs qui avaient espéré pouvoir, profitant de la curiosité des rapaces, s’offrir quelques coups de feu à belle portée en furent pour leurs illusions. Il eût fallu tirer à la carabine, et même un aigle qui plane, à près de 100 mètres, est une cible presque impossible à atteindre. Ces oiseaux énormes sont tout en plumes et en muscles. Formidables quant à la puissance des ailes et des pattes, les aigles les plus grands, une fois plumés, n’auraient pas le corps plus gros qu’un poulet de forte taille, et, malgré les hâbleries de certains chasseurs qui prétendent placer leur balle comme avec le doigt, il y a beaucoup de place inoccupée autour d’un aigle qui plonge à toute vitesse. Le cerf-volant n’est donc pas près de remplacer le grand duc, pour la destruction des rapaces à la hutte. Je dis bien des rapaces — et non des nuisibles, — car j’ai mon opinion bien arrêtée là-dessus. Il constitue simplement un moyen curieux d’observer en plein vol les grands voiliers. Un après-midi pendant lequel on voit tourner, des heures durant, cinq où six grandes buses, ou encore quelque énorme pygargue de marais, n’est point chose tellement banale, surtout si on les observe à la jumelle, ce qui permet de voir le travail porteur énorme des grandes plumes écartées du bout des ailes. Et il est toujours intéressant de surprendre de près ces animaux ignorant la présence de l’homme, dans tout le calme et la simplicité de leur vie libre. Pierre MÉLON. |
|
|
Le Chasseur Français N°632 Octobre 1949 Page 676 |
|
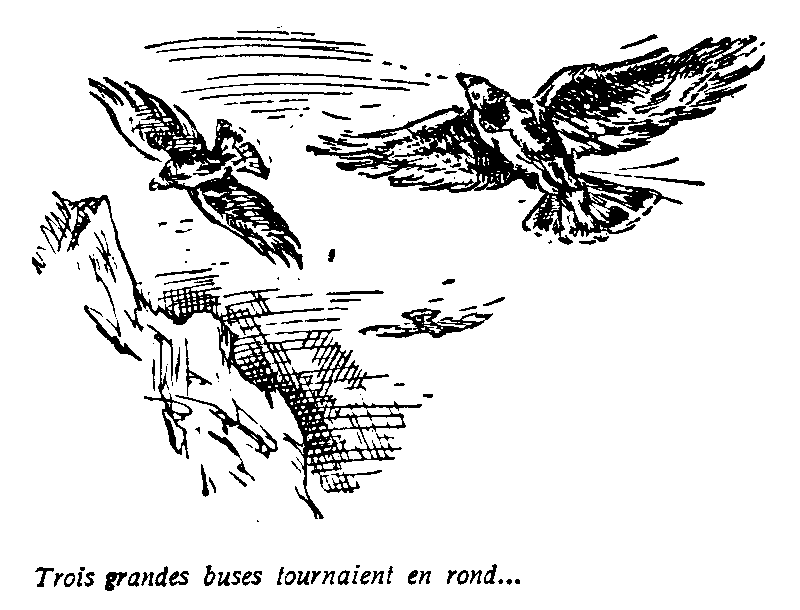 Une fois ma canne garnie d’un respectable stock de
vieux papiers, je m’en fus jusqu’au bord à pic d’une paroi et, appuyant mon
soulier sur le tas, je débrochai toute ma collection. C’est ainsi que
le-cuisinier arabe, passant la broche brûlante entre son gros orteil et les
autres doigts de pied, et appuyant sur les gigots du rôti, envoie d’un geste
élégant le « méchoui » se prélasser sur le grand plat où il baignera
dans son jus. Mais, moins heureux que Sidi Mohammed, je ne réussis pas du
tout-mon tour d’adresse. Au lieu de descendre bien sagement dans le vide et de
disparaître au bas de la pente, mes vieux papiers, sitôt libérés, se mirent à
faire preuve d’indépendance. Il faisait ce jour-là un coquin de petit vent du
sud, comme les aiment les amateurs de vol à voile, qui remontait contre les
rochers et s’empara, un par un, de tous mes chiffons de papier. Bientôt il y en
eut huit ou dix au-dessus de la crête, qui montaient à qui mieux mieux au
hasard de ce que les pilotes appellent maintenant des ascendances, de plus en
plus haut, de plus en plus petits, et dont je finis par ne plus m’occuper.
J’avais recommencé une seconde cueillette.
Une fois ma canne garnie d’un respectable stock de
vieux papiers, je m’en fus jusqu’au bord à pic d’une paroi et, appuyant mon
soulier sur le tas, je débrochai toute ma collection. C’est ainsi que
le-cuisinier arabe, passant la broche brûlante entre son gros orteil et les
autres doigts de pied, et appuyant sur les gigots du rôti, envoie d’un geste
élégant le « méchoui » se prélasser sur le grand plat où il baignera
dans son jus. Mais, moins heureux que Sidi Mohammed, je ne réussis pas du
tout-mon tour d’adresse. Au lieu de descendre bien sagement dans le vide et de
disparaître au bas de la pente, mes vieux papiers, sitôt libérés, se mirent à
faire preuve d’indépendance. Il faisait ce jour-là un coquin de petit vent du
sud, comme les aiment les amateurs de vol à voile, qui remontait contre les
rochers et s’empara, un par un, de tous mes chiffons de papier. Bientôt il y en
eut huit ou dix au-dessus de la crête, qui montaient à qui mieux mieux au
hasard de ce que les pilotes appellent maintenant des ascendances, de plus en
plus haut, de plus en plus petits, et dont je finis par ne plus m’occuper.
J’avais recommencé une seconde cueillette.