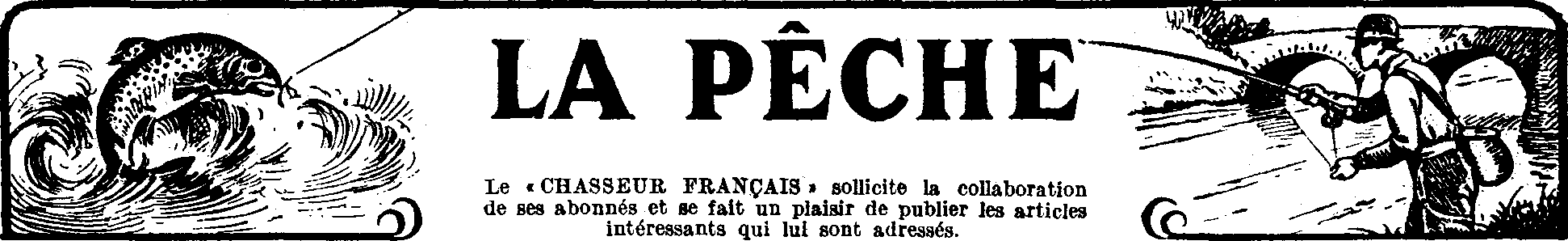| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°634 Décembre 1949 > Page 792 | Tous droits réservés |
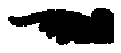
|
Les labres |
|
Quand la figuiero broco, C’est un dicton des pêcheurs marseillais : « Quand le figuier bourgeonne, les rouquiers sont dans la roche. » En effet, les rouquiers ou labres (1) ne vivent pas toujours sur les bords ; ils s’éloignent l’hiver et ne viennent qu’au printemps sur leur territoire traditionnel. Ils viennent pour s’unir. Le mot est exact : fait presque unique chez les poissons, le mâle et la femelle s’unissent. Ils s’apparient et le demeurent tout au moins au long d’une même saison, ne se quittant pas, habitant l’un avec l’autre comme deux amoureux, tout à côté de leur nid. Ce mot, lui aussi, est exact : fait rare chez les poissons, les labres bâtissent un nid. C’est, avec celle de l’épinoche, la frayère qui possède le plus de droits à porter ce nom. L’analogie avec les mœurs nuptiales des oiseaux est frappante : les labres établissent une aire pour leur ponte. Sur le fond, mâle et femelle apportent dans leur bouche des brins d’algues ou de plantes marines, de petites pierres, des coquillages, et les disposent en couronne. Pendant ce temps, qu’un autre poisson ne s’avise pas d’approcher ! Il serait chassé, poursuivi. La ponte des œufs s’accompagne d’une singulière danse nuptiale. Celle-ci a pu être, fait rare, fort bien observée en aquarium, au musée de Monaco, au printemps de 1948 ; c’est d’après les observations faites alors que nous la décrivons ici. Les deux poissons se dressent presque verticalement, museau en l’air, bouche ouverte, ouïes gonflées, nageoires déployées, et ils avancent, reculent, avancent, reculent en battant des nageoires pectorales. Cependant les œufs et la laitance, émis avec prodigalité, recouvrent le fond du nid. Puis les parents poussent du museau les matériaux de la cuvette et les agglutinent plus ou moins avec les œufs. Le couple ne quittera pas les alentours immédiats du nid, et, dans cette surveillance, le père se montrera plus assidu que la mère, sans doute fatiguée par son énorme ponte. Il ne prend plus guère de nourriture, ce qui a permis à des écrivains (en particulier Conrad Gesner, érudit suisse qui vivait en France au XVIe siècle) de s’extasier sur les soucis paternels de ce poisson : il veille tant sur sa progéniture, disait-on, qu’il en oublie de manger ... La vérité est connue pour tous les poissons à ponte gardée depuis fort peu de lustres : si, au moment du frai, certains poissons ne mangent pas, c’est tout simplement que la maturation des glandes génitales s’accompagne de la sécrétion d’un mucus qui obstrue les voies digestives. Les restes des nids subsistent après l’éclosion des alevins. Les plongeurs, l’été, en observent parfois, mais ne savent pas, en général, ce que signifient ces tas, ces couronnes, ces cratères de brindilles mêlées à des cailloux et à des fragments de coquilles. Chose curieuse, ils voient aussi, et très fréquemment, les labres dans leur attitude nuptiale. Ils n’imaginent point que ce soit là une manifestation sexuelle et pensent simplement que ces poissons cultivent une singulière manie ; ils disent : le labre « fait le beau ». Comme la saison des amours est passée avec le printemps, il s’agit sûrement là d’une persistance de réflexes sexuels dont le monde animal offre nombre d’autres exemples. Une autre attitude est particulière aux labres, et surtout aux crénilabres paon : c’est une sorte de somnolence sur un rebord rocheux ; plus ou moins caché par des algues, le poisson semble flotter, immobile, à demi couché sur le flanc, toutes nageoires déployées. En pareil cas, c’est un exploit de débutant, pour un chasseur sous-marin, que de le harponner. La chasse aux labres n’est d’ailleurs jamais difficile. Autrefois, lorsque les poissons n’étaient pas encore adaptés à ce nouveau danger qui leur tombe du ciel, elle était même enfantine : le poisson qui débouchait d’une forêt d’algues n’y retraitait pas s’il voyait un chasseur ; ou bien il pratiquait la tactique de l’autruche, se cachant la tête dans les algues ... et présentant admirablement ses flancs à la flèche. Aujourd’hui, il est plus circonspect et se fie moins à son mimétisme. Quand il aperçoit un homme, il pénètre complètement dans les frondaisons. Là, on ne peut guère songer à le découvrir, vert dans la verdure. Mais, tôt ou tard, il se montrera curieux. Aussi toute la tactique est-elle de guetter ce moment depuis la surface, où l’on doit rester immobile, à plat ventre, respirant par le tuyau du respirateur : le labre finira bien par pointer son museau hors des algues. Alors, sans hésiter, il faut plonger rapidement vers lui et tirer. Plus nettement qu’aucun autre, ce poisson vit dans les algues et les plantes marines. Il y croque des crustacés, des coquillages, y gobe des vers, des gastéropodes ou des poissons. Il y pénètre souple comme elles, ondulant, les faisant onduler. Il s’y cache, ton dans ton. Il n’en ressort qu’avec circonspection. Il ne passe dans une clairière que rapidement, surtout le tourdre qui semble, en pareil cas, un soldat traversant sous la mitraille un terrain découvert. Jamais on ne le rencontre en pleine eau ; et, comme on ne peut le voir sous le couvert de sa forêt, on ne l’aperçoit guère qu’à la limite des frondaisons, parfois à demi sorti, parfois passant et repassant nonchalamment dans les taillis, les buissons, les bosquets de son domaine. Ainsi, la chasse sous-marine et la plongée moderne permettent-elles l’observation directe de poissons qui, jusqu’ici, échappaient à peu près aux regards. La pêche des labres n’offre rien de très particulier : ils sont les classiques « grosses prises » de la pêche au boulantin, depuis les barques, sur fonds rocheux ; mais leurs touches ne sont pas toujours en rapport avec leur taille ; un simple petit serran peut tirer bien plus qu’un gros rouquier. On prend les plus petits à la canne depuis le rivage. Les professionnels, eux, les capturent en raclant les fonds d’algues et les herbiers de plantes marines, avec le chalut dans l’Océan, avec le gangui en Méditerranée ; à la saison du frai, donc au printemps, quand ils viennent à la côte, on les prend aussi aux filets d’entremaille. Mais, victimes par excellence de l’affreux instrument de destruction totale qu’est le gangui, les labres se raréfient chaque année davantage : ils sont tous pris dans leur jeune âge par la gueule dévorante de ce filet qui racle impitoyablement tous les fonds où ils vivent. Enfin, nous ne pouvons terminer ces articles sur les labres sans évoquer leur fin : la bouillabaisse. Ils sont en effet, avec les rascasses et les chapons, le constituant essentiel de ce célèbre plat, soit que, petits, on les écrase dans le bouillon, soit que, plus gros, on les serve entiers. Poissons de bouillabaisse et poissons vivement colorés, ce sont par excellence les poissons de Provence ; mieux, les poissons marseillais. Pierre DE LATIL.(1) Voir Le Chasseur Français de novembre 1949. |
|
|
Le Chasseur Français N°634 Décembre 1949 Page 792 |
|