| Accueil > Années 1950 > N°635 Janvier 1950 > Page 10 | Tous droits réservés |
Une chasse en Savoie

|
Ouverture sur le roi des cailles |

|
|
Cela remonte à trente ans ; j'avais le bonheur de posséder un chien incomparable : Perdreau. Il m'avait été vendu à deux mois par un commerçant grenoblois sous l’étiquette garantie de « Saint-Germain ». Je ne connaissais que la mère, une bête superbe. Perdreau prit toutefois rapidement l'allure un peu massive de nos vieux Braques français. Il devait en avoir toutes les qualités traditionnelles. Passionné pour la chasse, affectueux, docile, ardent, rapportant sur le coup de fusil, obéissant sans hésitation au geste et au premier commandement, il battait au petit galop, en croisant devant moi, toujours à portée de fusil, un terrain considérable. D'un nez à toute épreuve, rien ne lui échappait ; il arrêtait parfaitement, quoique peu longtemps il faut le reconnaître, toute pièce de valeur, coq, perdrix, bécasse, etc., mais, lorsqu'il tombait sur un petit gibier coureur se dérobant sans cesse comme le râle, il avait sa manière à lui d'obliger le récalcitrant à se lever immédiatement.
Pour terminer cette brève présentation, je me permets de citer comme une preuve d'intelligence vraiment humaine les faits suivants garantis d'une sincérité absolue. Il y a trente ans, le gibier était encore très abondant. Les chasseurs n'avaient point atteint ce nombre disproportionné qui rend aujourd'hui la chasse si problématique, car il faut bien reconnaître, aussi pénible que ce soit, que depuis longtemps l'équilibre est rompu entre le gibier et le chasseur. La loi du nombre est impitoyable, comme tout ce qui est mathématique. Très entraîné, en pleine force, tirant beaucoup, je manquais moins souvent qu'aujourd'hui, ou plutôt qu'hier, sur les coups difficiles. Lorsque, cependant, il m'arrivait de faire du bruit pour rien deux fois de suite, Perdreau me regardait de travers, puis se mettait au pied. Il me faisait ainsi clairement comprendre, en langage de chien, qu'il était inutile de travailler plus longtemps pour un maladroit. Alors je m'arrêtais, je le caressais, je lui disais : « Fais-moi confiance encore un peu », et il repartait de l'avant. Mais voici bien davantage. À tout chasseur il est advenu de voir une pièce de gibier disparaître sous le coup de fusil et d'insister outre mesure pour la faire rapporter. Le chien cherche avec ardeur et ne trouve rien, il faut finalement admettre que le gibier a été manqué ou, ce qui est pire, « démonté ». Un coq, une perdrix, un canard désailés se retrouvent difficilement. Lorsque donc j'insistais à mon tour avec cet entêtement que donne la conviction. Perdreau s'acharnait dans ses recherches, croisant et recroisant ses quêtes, puis tournant en rond sur le lieu présumé. Cela durait cinq, dix minutes, parfois plus. Brusquement, il pointait, agitant sa queue courte et, docile, me rapportait, avec cette énorme grimace qui, chez le chien, est l'expression du rire ... la bourre de ma cartouche tenue entre deux dents. Cette présentation impeccable, narquoise et quelque peu spectaculaire, clamait hautement, toujours en langage de chien : « Mon vieux, voilà tout ce que tu as tué ! » Cette preuve, souvent répétée, de qualités exceptionnelles de nez, de docilité, d'affection pour le maître et, surtout, d'une intelligence vraiment supérieure a eu le don d'irriter, en le blessant dans son orgueil, un invité de passage, compagnon de chasse d'un jour et fusil réputé. Je n'ai guère besoin d'ajouter que sans rien dire, par politesse, je fis bien le serment que jamais plus Perdreau ne chasserait pour un imbécile. À l'âge de sept ans, cet admirable chien fut estropié par un automobiliste ivre, qui dévia sa voiture pour le heurter sur le bord de la route. Je n'avais pas de fusil, et ce fut très heureux pour l'homme, ou tout au moins sa voiture. Perdreau est mort dans mes bras, ses bons yeux fixés sur les miens ; je l'ai pleuré comme un être très cher. Mais voici la partie de chasse. Les marais de Savoie ont toujours été très riches en râles. Ils constituent le terrain classique, affectionné par ce gibier. Je n'ai pas à m'étendre sur « le roi des cailles ». Tous les chasseurs de plaine connaissent ce petit échassier aux ailes d'un brun plus ou moins ardent. Cette tonalité lui vaut d'être communément baptisé râle rouge pour le différencier du râle d'eau ou râle noir, de valeur très inférieure. Le « roi des cailles » est de la grosseur d'un jeune pigeon. Son vol est lourd et il ne s'y décide qu'à la dernière extrémité. Très sensible au bruit, rusé et piéteur émérite, il n'a point son pareil pour se faufiler sous les herbes hautes, se dérober par des crochets savants, enfin épuiser les forces des jeunes chiens et la patience du chasseur. C'est un migrateur. Ses gros passages coïncident avec ceux du becfigue. Comme lui, et avec lui, il s'engraisse volontiers dans les prairies fraîches, les luzernes, les maïs à fourrage qu'il rencontre en chemin. Sa chair est aussi succulente que celle de son petit commensal. C'est un régal des gourmets ; je ne lui connais rien de supérieur en finesse, et on ne peut pas plus lui opposer le fumet tant apprécié des bécasses qu'en matière « champignons », par exemple, on pourrait mettre en rivalité l'admirable parfum d'une morille et la saveur puissante d'une truffe. Ce sont choses non comparables. Le râle rouge est aussi appelé « râle des genêts ». Je ne crois pas que ce soit le même oiseau, car il existe un râle plus petit, franchement gris, fréquentant des terrains plus secs que nous appelons entre chasseurs « râle gris ». Le roi des cailles était autrefois le gibier de fond de notre belle vallée du Grésivaudan. Il achève malheureusement de disparaître, comme tout gibier fréquentant les cultures, vaincu par la multiplication des faucheuses et l'emploi, souvent inconsidéré, des arséniates.
Nous n'avions point de bottes et nous venions d'atteindre la limite de la partie sèche. Devant nous, à perte de vue, le marais s'étendait, magnifique, silencieux, vide d'agitation humaine, et cela lui donnait une puissance attractive énorme. Il devait renfermer quantité de beau gibier aquatique, canards, bécassines, etc. ... Il fallut renoncer. Nous espérions chasser au coteau le lendemain et refaire par surcroît une partie du même terrain, certains d'y retrouver encore des rois de cailles, échappés de la veille ou nouveaux venus. Un télégramme m'attendait à l'hôtel. Notre chasse était finie ; belle chasse certes, mais je pense encore avec regret à l'occasion exceptionnelle que nous avions manquée. C'était période certaine de passage. S'il nous avait été donné de chasser quarante-huit heures comme nous devions le faire dans ce paradis, bien qu'avec un seul fusil, mais avec un chien qui s'appelait Perdreau, mon sac et celui de mon ami n'auraient contenu qu'à grand'peine le gibier rencontré. Jean LEFRANÇOIS. |

|
Le Chasseur Français N°635 Janvier 1950 Page 10 |

|

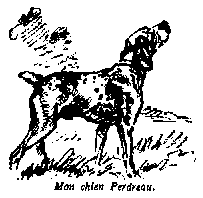 Sur un léger pointé, il décrivait rapidement un arc de
cercle, revenait sur moi, et l'oiseau, pris entre chien et chasseur, était bien
contraint de prendre son essor. Nous verrons dans un instant l'efficacité de
cette tactique.
Sur un léger pointé, il décrivait rapidement un arc de
cercle, revenait sur moi, et l'oiseau, pris entre chien et chasseur, était bien
contraint de prendre son essor. Nous verrons dans un instant l'efficacité de
cette tactique. Je faisais donc partie de l'admirable chasse d'Albertville, une
des plus intéressantes qui soit, ou qui fût, car j'ignore ce qu'elle est
devenue. Elle comportait les plus beaux marais que l'on puisse souhaiter, des
coteaux riches en lièvres et perdrix et des lots importants en montagne.
Hélas ! je ne possédais pas de voiture. Il fallut compter avec le train et
un train « omnibus ». J'emmenai avec moi, sans son fusil, parce que
je n'avais qu'une carte, un agréable compagnon avec qui je devais chasser de
nombreuses années en montagne par la suite. C'était jour d'ouverture. Nous
n'arrivâmes qu'à midi à la gare la plus proche : Grésy-sur-Isère. Nous
étions en chasse à deux heures de l'après-midi par une chaleur intense, soit
dans des conditions déplorables. En bordure du marais, fusil à la bretelle,
quelque peu endormi et fumant par surcroît une pipe capiteuse, un râle passa,
me frôlant le visage. Trop tard. Je secouai ma pipe et me mis à chasser
sérieusement. En moins de dix minutes, dans les premières « laîches »,
Perdreau leva un roi de cailles, je tirai. Il me l'apporta. Cinquante mètres
plus loin, j'en tuais un autre. À quatre heures, j'en avais dix-neuf. Nous
arrivions au-dessous du hameau de Notre-Dame-des-Minières, point de repère que
je recommande, si ces terrains privilégiés sont toujours accessibles aux
chasseurs et ont conservé leur immense intérêt cynégétique d'antan. Mon
attention fut retenue par un doublé un peu rapide, sur ma droite, les premiers
coups de feu que j'entendais tirer par un confrère. J'eus la curiosité de me
diriger vers ce confrère. Je trouvai un très vieux chasseur du pays absolument
désespéré. Il excitait en vain un chien impossible. Il venait de manquer la
première pièce de la journée : « Un beau rouge, monsieur, quel
malheur ! » Je me fis indiquer la vague remise. Perdreau leva une
fois de plus et me rapporta « le beau rouge ». Je remis à ce brave
homme son oiseau si envié. Il me remercia, les larmes dans les yeux, je venais
de tirer et tuer le vingtième de la série, je possédais en outre quelques
pièces moins intéressantes, râles noirs, gringes et une ou deux cailles.
Je faisais donc partie de l'admirable chasse d'Albertville, une
des plus intéressantes qui soit, ou qui fût, car j'ignore ce qu'elle est
devenue. Elle comportait les plus beaux marais que l'on puisse souhaiter, des
coteaux riches en lièvres et perdrix et des lots importants en montagne.
Hélas ! je ne possédais pas de voiture. Il fallut compter avec le train et
un train « omnibus ». J'emmenai avec moi, sans son fusil, parce que
je n'avais qu'une carte, un agréable compagnon avec qui je devais chasser de
nombreuses années en montagne par la suite. C'était jour d'ouverture. Nous
n'arrivâmes qu'à midi à la gare la plus proche : Grésy-sur-Isère. Nous
étions en chasse à deux heures de l'après-midi par une chaleur intense, soit
dans des conditions déplorables. En bordure du marais, fusil à la bretelle,
quelque peu endormi et fumant par surcroît une pipe capiteuse, un râle passa,
me frôlant le visage. Trop tard. Je secouai ma pipe et me mis à chasser
sérieusement. En moins de dix minutes, dans les premières « laîches »,
Perdreau leva un roi de cailles, je tirai. Il me l'apporta. Cinquante mètres
plus loin, j'en tuais un autre. À quatre heures, j'en avais dix-neuf. Nous
arrivions au-dessous du hameau de Notre-Dame-des-Minières, point de repère que
je recommande, si ces terrains privilégiés sont toujours accessibles aux
chasseurs et ont conservé leur immense intérêt cynégétique d'antan. Mon
attention fut retenue par un doublé un peu rapide, sur ma droite, les premiers
coups de feu que j'entendais tirer par un confrère. J'eus la curiosité de me
diriger vers ce confrère. Je trouvai un très vieux chasseur du pays absolument
désespéré. Il excitait en vain un chien impossible. Il venait de manquer la
première pièce de la journée : « Un beau rouge, monsieur, quel
malheur ! » Je me fis indiquer la vague remise. Perdreau leva une
fois de plus et me rapporta « le beau rouge ». Je remis à ce brave
homme son oiseau si envié. Il me remercia, les larmes dans les yeux, je venais
de tirer et tuer le vingtième de la série, je possédais en outre quelques
pièces moins intéressantes, râles noirs, gringes et une ou deux cailles.