| Accueil > Années 1950 > N°635 Janvier 1950 > Page 27 | Tous droits réservés |

|
Le sport le plus simple |

|
|
Il y a beaucoup de gens qui ne font pas 500 mètres à pied par jour. Cela présente des inconvénients. Ne servant plus à rien, les jambes dégénèrent et s'atrophient. La diminution manifeste de la taille moyenne chez les peuples civilisés — motorisés peut-on dire — porte sur le raccourcissement des membres inférieurs, qui, au lieu de représenter la moitié de la taille totale, en sont maintenant au-dessous, de 5, 8 et jusqu'à 12 centimètres. Cette dysharmonie corporelle est particulièrement fréquente chez les femmes, qui marchent encore moins que les hommes ; mais ceux-ci en sont aussi très souvent atteints. En outre, l'abstention de la marche supprime un exercice physique qui, bon gré, mal gré, assurait à l'organisme une grande part des utiles effets de l'activité corporelle. La paresse fait que la plupart des hommes ne se résignent à l'exercice que contraints parla nécessité. N'étant plus obligés de marcher, ils réduisent presque à rien le fonctionnement de leurs muscles, ce qui réduit parallèlement celui de leurs poumons, de leur cœur, de presque tous leurs organes ; cette erreur aboutit nécessairement au manque de force et au peu de résistance à la fatigue. On peut mesurer cette décadence en comparant les marches de 30 à 40 kilomètres par jour, avec armes et bagages, qu'effectuèrent sans se fatiguer non seulement les soldats romains, mais ceux de Napoléon et même ceux du second Empire, et ce que font et peuvent faire les armées modernes entraînées pourtant, à ce qu'on dit, aux sports violents et aux exercices périlleux. Cette valeur, qu'on pourrait appeler locomotrice, des anciens soldats n'était pas due uniquement à l'entraînement militaire qu'on leur faisait subir. C'est habitués aux longues marches qu'ils arrivaient au régiment : il n'était paysan qui ne fît fréquemment 20 à 30 kilomètres pour se rendre aux marchés ou à la ville voisine ; il n'était citadin qui n'en fît de 4 à 8 par jour pour aller à ses affaires ou baguenauder dans sa ville. Toutes ces occasions forcées de déambuler leur sont maintenant épargnées. Mais il leur faudrait revenir à la marche par raison de santé, la considérer comme un exercice nécessaire de culture physique, la pratiquer délibérément « pour se faire du bien ». On admet volontiers que la marche est le plus naturel des exercices. Cependant, en éducation physique, alors qu'on fait la part belle à beaucoup d'exercices dits naturels, comme le grimper à la corde, la quadrupédie et la reptation, on ne s'occupe guère de la marche normale, de son enseignement et de sa pratique. Je crois même qu'en entraînement militaire ,on ne s'inquiète plus de sa technique, alors que jadis elle a suscité, surtout parmi les officiers d'infanterie, beaucoup d'études et d'expériences du plus haut intérêt. Pour naturelle qu'elle soit, la marche est un exercice difficile qui ne s'accomplit que par la coordination de très nombreuses contractions musculaires, qui ont pour but d'assurer à la fois l'équilibre et la progression. Dressé verticalement sur ses deux pieds, qui ne lui construisent qu'une « base de sustentation » très petite par rapport à sa taille et à son poids, l'homme, lorsqu'il se tient debout et lorsqu'il marche, s'équilibre bien plus malaisément que les quadrupèdes. Aussi l'homme, au contraire des autres animaux, doit-il apprendre à marcher, et il y met quelque temps. L'enfant le fait par instinct et par imitation des grandes personnes. Il se met debout, en équilibre bien instable, vers un an ; à deux, il fait ses premiers pas incertains et mal coordonnés ; il a tendance à courir pour rattraper son équilibre, qui lui échappe, et il se réfugie volontiers dans la « progression à quatre pattes », quand il se fatigue trop à trottiner. Cette éducation spontanée, instinctive, aboutit rarement à une marche correcte. Il est probable que, jadis, la pratique forcée de la marche obligeait enfants et jeunes gens à acquérir une « technique » convenable, à pratiquer une marche de bon rendement. Mais les enfants d'aujourd'hui, portés dans les bras, roulés en voiture, transportés en auto, montés en ascenseur, ne marchent plus assez pour se perfectionner, par expérience personnelle, dans cet exercice compliqué. Il s'ensuit qu'à dix ans ils marchent encore sans précision ni fermeté, traînant les pieds et vacillant des genoux. Aussi auront-ils répugnance à marcher, et ne marcheront guère, leur vie durant. Comme nous l'avons dit, ce sont surtout les femmes qui prendront une horreur obstinée de cet exercice, sans se rendre compte que pieds tournés et plats, chevilles épaisses, cellulites, varices et oedèmes sont les conséquences fatales de cette inutilisation de leurs jambes. L'éducation de la marche devrait faire partie de l'éducation physique des enfants et jeunes gens. C'est commencer par la fin que les initier à des sports que l'on ne peut pratiquer efficacement que si l'on est assez robuste et alerte. N'est-il pas illogique d'apprendre à courir et à sauter alors que l'on ne sait pas marcher ? Alors que les exercices sportifs ne sont pratiqués que par intermittences et pendant la jeunesse, la marche peut devenir un exercice de tous les jours et que l'on peut pratiquer avec goût et profit jusqu'à l'âge le plus avancé. Il ne s'agit que d'apprendre à marcher correctement, ce qui est marcher facilement et élégamment, puis de s'habituer à des promenades pédestres sur d'assez bonnes distances. On y prendra plaisir, comme à tout ce qu'on fait bien, et, par ce moyen si simple, on se trouve défendu, jusqu'à la fin de ses jours, contre les déplorables effets de la sédentarité et de l'inaction corporelle. Dr RUFFIER. |

|
Le Chasseur Français N°635 Janvier 1950 Page 27 |

|
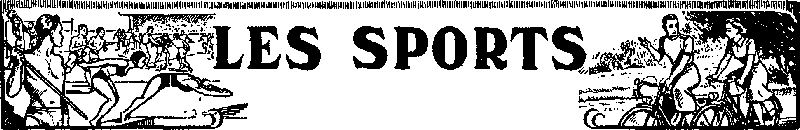
 A marche tombe en désuétude. C'est l'effet évident des
engins mécaniques de transport que le progrès met de plus en plus abondamment à
notre disposition. Jadis, seul le cheval aidait l'homme à se déplacer ; le
chemin de fer ne lui facilita que certains longs parcours qui lui laissaient la
tâche de se rendre à la gare, parfois éloignée. Aujourd'hui, l'auto,
particulière ou publique, lui assure même ses allées et venues quotidiennes.
A marche tombe en désuétude. C'est l'effet évident des
engins mécaniques de transport que le progrès met de plus en plus abondamment à
notre disposition. Jadis, seul le cheval aidait l'homme à se déplacer ; le
chemin de fer ne lui facilita que certains longs parcours qui lui laissaient la
tâche de se rendre à la gare, parfois éloignée. Aujourd'hui, l'auto,
particulière ou publique, lui assure même ses allées et venues quotidiennes.