| Accueil > Années 1950 > N°635 Janvier 1950 > Page 38 | Tous droits réservés |
Le vignoble

|
Accidents et maladies |

|
|
Bien que nous soyons obligé d'insister plus sur quelques-uns que sur d'autres, nous serons forcé d'être concis et de proscrire beaucoup de détails souvent nécessaires. Cette nomenclature demandera plusieurs études. Le sujet est tellement étendu ! Parmi les accidents non parasitaires, nous verrons ceux dus à des causes physiologiques et ceux provoqués par des conditions météoriques. Quant aux maladies parasitaires, elles se divisent en deux grands groupes : Les maladies cryptogamiques ; Les ravages dus aux insectes. Nous nous efforcerons, autant que la place nous le permettra, de publier des figures à l'appui de notre texte. Parmi les accidents dus à des causes physiologiques, nous trouvons : La Chlorose ou jaunisse, phénomène produit par le manque d'azote ; la matière colorante de la feuille : la chlorophylle, naturellement verte, devient jaune. La chlorose peut être passagère ou constante ; elle est passagère au printemps par temps froid et pluvieux après le départ de la végétation, le sol manquant d'azote par suite du défaut de nitrification. Aux premiers beaux jours, les feuilles reverdissent lentement. Dans les sols calcaires, destructeurs de matières organiques azotées, il en est tout autrement : le jaunissement dure beaucoup plus longtemps, surtout par temps pluvieux et froid. Les porte-greffes sont du reste plus sensibles que nos anciens plants francs de pied. On atténue la chlorose par l'épandage de sulfate de fer à raison de 300 à 500 grammes par mètre carré de surface, et en badigeonnant les plaies de taille avec une solution concentrée à 50 p. 100 de ce même produit. Ces deux traitements se complètent. On aura quelquefois intérêt, par temps très sec, à introduire dans le sol le sulfate de fer en solution diluée, l'effet sera plus rapide. Les verrues, étudiées au début de ce siècle, se présentent par des proliférations abondantes de tissus à la surface inférieure des feuilles. On a remarqué qu'elles étaient provoquées par un excès de lumière et qu'elles apparaissaient plus particulièrement dans les forceries. Le folletage, ou apoplexie, se produit sur certaines souches en pleine vigueur, les feuilles se flétrissent, les sarments se dessèchent et la couche meurt. Nous avons constaté que ce phénomène se produisait en quelques jours. On ne saurait incriminer le manque d'eau, car l'apoplexie se produit dans les sols profonds et humides. On admet, pour une cause mal expliquée, un rétrécissement des vaisseaux des racines arrêtant l'apport de sève. Mais ce ne semble n'être là qu'une supposition. Quoi qu'il en soit, il n'y a qu'à arracher la souche et replanter après désinfection du sol au sulfure de carbone. Le rougeot, comme son nom l'indique, est un rougissement des feuilles ; là, la chlorophylle se colore en rouge. Le phénomène apparaît vers juin-juillet ; on attribue jusqu'à plus ample informé, ce phénomène à un refroidissement brusque. L'ercissement est un accident qui se produit par temps très chaud et sec. Les grains de raisin restent petits, d'un ton vert bleu, et arrivent à maturité sans atteindre leur grosseur normale. C'est un des méfaits de la grande sécheresse. La coulure est produite par la non-fécondation des fleurs due soit à une mauvaise constitution de celles-ci, soit à des froids accompagnés de brouillards ou de pluie, enfin à un excès ou un manque de vigueur du cep. On y remédie dans une certaine mesure par un ou deux soufrages à la floraison. On aura intérêt à éliminer les cépages sujets à la coulure. Le millerandage, lui, est dû à l'avortement de quelques grains et provient d'une mauvaise fécondation. Le grain reste petit et est appelé : millerand.
Comme la coulure, le millerandage a les mêmes causes et on y remédie en partie par les mêmes effets. On aura intérêt à évincer les cépages sujets au millerandage. Parmi les accidents dus à des causes météoriques, nous avons : La grêle, qui cause le plus souvent la destruction presque complète de la récolte, rend la taille difficile et compromet la récolte de l'année suivante. On a préconisé plusieurs remèdes ; d'abord les toiles-abri coulissant (à la façon d'une tenture) horizontalement au-dessus de la rangée de plants à protéger. Ce procédé, très efficace, entraîne une mise de fonds considérable. On lui a préféré la fusée paragrêle, qui ne fait que retarder la chute des grêlons. Car il faut que le nuage déverse son contenu quelque part. En somme, ce procédé limite les dégâts. La gelée, qu'on pourrait qualifier de sournoise, arrive sans crier gare. Un ciel clair, absence de vent au sol, et au lever du soleil raisins et pousses de sarments sont grillés. Nous avons vu détruire presque entièrement, de cette façon, la récolte du vignoble de Pouilly-sur-Loire, il y a quelque vingt ans. On a écrit de nombreux articles sur la protection des gelées : appareils avertisseurs, sonores ou non ; nuages de fumée allumés ou non automatiquement; débourrements et labours tardifs ; enfin, la vigne montée sur fils de fer surélevés quand elle est conduite de cette façon. Tous ces moyens sont recommandables à la condition d'être employés tous à la fois. Il faut remarquer cependant que des rideaux de fumée sont surtout efficaces dans les grands vignobles, principalement organisés en coopératives. Les gelées ont quelquefois fait apparaître les broussins, qui sont des protubérances spongieuses se formant au collet de la souche et à la base des bras. Celles-ci sont dues à un excès d'apport de sève par suite de la disparition des feuilles. Les broussins pouvant être le réceptacle de maladies cryptogamiques, il faut les enlever en se servant d'un instrument tranchant, ensuite badigeonner la plaie avec une solution concentrée de sulfate de fer à 50 p. 100. Le grillage atteint les raisins qui brunissent ; le phénomène se produit après une insolation violente suivant une période brumeuse. Cet accident se produit plus particulièrement dans les serres. Nous avons vu à peu près tous les accidents non parasitaires dont est sujet le vignoble ; dans la prochaine étude, nous commencerons la description des maladies parasitaires cryptogamiques. V. ARNOULD,Ingénieur agronome. |

|
Le Chasseur Français N°635 Janvier 1950 Page 38 |

|

 la demande de nombreux lecteurs, nous allons examiner les
accidents et maladies du vignoble.
la demande de nombreux lecteurs, nous allons examiner les
accidents et maladies du vignoble.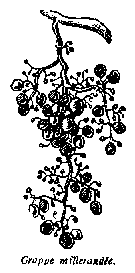 Les grappes millerandées ont la forme caractéristique de la
figure ci-contre ; elles sont formées de grains non serrés d'inégale
grosseur.
Les grappes millerandées ont la forme caractéristique de la
figure ci-contre ; elles sont formées de grains non serrés d'inégale
grosseur.