| Accueil > Années 1950 > N°637 Mars 1950 > Page 131 | Tous droits réservés |

|
Les canepetières |

|
|
Voilà un oiseau inconnu, je crois, de pas mal de chasseurs. Car, si certains le connaissent bien pour l'avoir vu, tiré et même en avoir quelque spécimen à leur carnet de chasse ; d'autres, ceux qui ne chassent pas seulement sur le terrain, mais aussi lisent journaux, livres et revues cynégétiques, pour en avoir lu la description et les mœurs ; combien, par contre, et ils sont la majorité, qui en ignorent jusqu'au nom et qui, entendant parler de la canepetière, ouvrent de grands yeux étonnés en demandant : « Qu'est-ce que c'est que ça ? »
Il a fallu, quant à moi, que j'arrive à mon trentième permis pour le rencontrer et avoir la chance, à la première cartouche qui lui a été destinée, d'en dégringoler deux dans une bande venue passer imprudemment à portée de fusil. Contrairement à ce que pourrait faire croire son nom, la canepetière n'a absolument rien d'une cane, c'est-à-dire d'un anatidé. C'est, au contraire, non point un oiseau d'eau, mais un oiseau coureur, habitué des grandes plaines nues. On pourrait, plutôt, le comparer à l’œdicnème criard, ou courlis de terre, auquel il ressemble un peu par son plumage, ses allures, ses dessous blancs et ses hautes pattes. En plus gros cependant, car il a bien le double de sa taille. En bref, c'est la petite outarde, et on la trouve dans les régions où les terres plates, la plupart du temps sans couvert, souvent incultes, s'étalent à perte de vue sur des centaines d'hectares. De là, la grande difficulté de s'en approcher pour la tirer à portée. Car, comme pour les vanneaux, il y a toujours quelque oiseau aux aguets prêt à alerter la troupe en cas de danger. Certaines grandes plaines toulousaines, celles de la Beauce, de la Champagne, de l'Île-de-France et même de Provence sont les lieux de prédilection où on la rencontre habituellement, souvent par grandes bandes de plusieurs centaines. J'ai vu ainsi, la première fois que j'eus l'occasion de faire connaissance avec elles, cinq ou six cents canepetières réunies et formant une belle troupe. C'était par un beau dimanche d'octobre dernier, un dimanche doux et plein d'un clair soleil qui inondait l'immense plaine où, à quelque dix kilomètres de la ville, commencent à évoluer planeurs et avions sur l'aérodrome en cours de réorganisation. Entre la route d'un côté et, de l'autre, la petite ligne, depuis peu désaffectée, du chemin de fer de Camargue, qui, à grands cahots, vous amenait naguère encore de Nîmes à Saint-Gilles, le terrain, nu et plat comme la main, étale son immense étendue où paissent les troupeaux de moutons : le thym, de courtes herbes maigres et les chardons sont les seules plantes qui poussent sur ce sol caillouteux. Les perdreaux rouges y courent à toutes pattes et, quelque temps après l'ouverture, partent à des distances incroyables. Parfois un lapin gîté sous une touffe minuscule déboule à toute allure devant vos pieds et, si vous le manquez, hélas ! comme il arrive, vous avez tout le loisir de le voir courir pendant deux ou trois cents mètres. C'est là que, soudain, je vis s'élever au loin une grande bande de gros oiseaux qui prirent aussitôt de la hauteur en faisant scintiller au soleil des dessous immaculés. Car les canepetières ont un vol tout particulier ; elles battent continuellement des ailes, surtout quand elles s'élèvent, et, dans le soleil, on n'aperçoit qu'un scintillement d'un blanc éblouissant. Elles montèrent jusqu'à devenir presque invisibles ; mais la troupe était si dense qu'on l'apercevait tout de même comme une large tache se mouvant dans le bleu du ciel. Je les suivis du regard autant qu'elles demeurèrent visibles tout en supputant en moi-même les possibilités d'un beau coup de fusil tiré à portée dans une telle bande d'oiseaux volant en formation aussi serrée. Un doublé à quarante ou cinquante mètres là dedans, on serait bien certain de ramasser au moins la demi-douzaine. Mais, hélas, on m'avait bien averti : « Inutile de les poursuivre, vous y perdriez votre temps et vous ne les tireriez jamais. » Plusieurs fois dans la matinée, je les vis tournoyer, puis s'abaisser, ailes étendues, et finalement se poser au loin. Mais, avec le mouvement qui se faisait sur la plaine, où, le dimanche, évoluent chasseurs, chercheurs de champignons, amateurs de vol à voile dont les planeurs passent souvent à quelques mètres du sol seulement, effrayant ainsi le gibier, elles avaient fini par se diviser en plusieurs bandes, sauf à se reformer au coucher du soleil pour passer la nuit sur le plateau. Un groupe se posa non loin d'un carré de genêts, seul couvert de l'immense plaine, d'où je pensais pouvoir les approcher. J'arrivai, en effet, avec mille précautions, derrière les grandes touffes vertes et les aperçus, mais à cent cinquante mètres, les unes dressées et immobiles, d'autres marchant lentement, s'arrêtant parfois pour battre de l'aile. Un moment, je les contemplai, avec le regret de n'avoir plus rien me permettant de les approcher sans être vu. J'attendis ainsi dans l'espoir que, dérangées, elles pourraient venir passer à portée de fusil ; j'avais du six seulement et ne pouvais tenter la chance de les tirer de trop loin. Finalement elles se levèrent, montèrent aussitôt en s'éloignant vers la route, consommant ainsi ma déception. Je me levai de ma cachette ; c'était bien là, en effet, du temps perdu. Car, depuis plus d'une heure, je tentais de vaines marches d'approche, faisant de grands détours, me baissant au ras du sol, pour arriver chaque fois à les voir partir hors de portée. C'est alors qu'ayant déjà fait quelques pas j'en vis brusquement arriver, sur ma gauche, une cinquantaine volant à petite hauteur. Un amandier se trouvait là. Je me jetai contre l'arbre, collant au tronc de mon mieux. Elles passèrent, croisant à soixante mètres, et, à mon coup de feu, deux s'abattirent sur la plaine. Le roi n'était pas mon cousin quand je ramassai ces deux beaux oiseaux, presque aussi gros qu'une pintade. Et j'en étais certes plus fier que du perdreau et du lapin qui gonflaient déjà mon carnier. Lorsque, l'après-midi, mes compagnons de chasse, qui étaient allés manger à la maison, me retrouvèrent, je leur montrai mon butin. « Eh bien ! me dirent-ils, pour la première fois, vous pouvez vous vanter d'avoir eu de la veine. Et ce serait étonnant que vous puissiez renouveler votre exploit. N'y comptez pas trop, car une fois n'est pas coutume, et, avec ces sacrés oiseaux, il faut être vraiment dans la manche de Saint Hubert pour réussir un coup pareil. » Le fait est que, depuis, j'ai revu les canepetières chaque fois que je suis allé sur le plateau des Mazets, mais que j'ai fini par renoncer à leur poursuite. Je regarde, toujours à regret, s'élever au loin leur clair et scintillant nuage ; je le suis des yeux un moment jusqu'à ce qu'il ait disparu à l'horizon. Mais, tout de même, je conserve secrètement l'espoir que quelque autre jour — qui sait ? — par un nouveau coup da chance, je pourrai mettre une fois encore dans mon filet quelqu'un de ces grands oiseaux dont la capture, ce jour-là, a valu tant de joie à mon cœur de chasseur. FRIMAIRE. |

|
Le Chasseur Français N°637 Mars 1950 Page 131 |

|

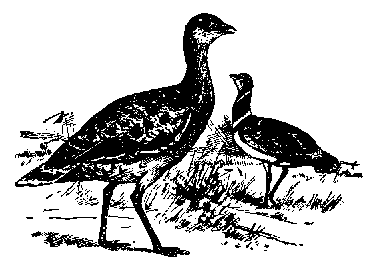 Avouons que les premiers sont des privilégiés. Ce n'est pas
en toutes régions, en effet, qu'on trouve cet oiseau, qui est, par surcroît,
d'une sauvagerie telle que l'abattre est un véritable exploit. Car il en vaut
la peine tant par sa taille, qui atteint celle du faisan, que par la succulence
de son rôti.
Avouons que les premiers sont des privilégiés. Ce n'est pas
en toutes régions, en effet, qu'on trouve cet oiseau, qui est, par surcroît,
d'une sauvagerie telle que l'abattre est un véritable exploit. Car il en vaut
la peine tant par sa taille, qui atteint celle du faisan, que par la succulence
de son rôti.