| Accueil > Années 1950 > N°639 Mai 1950 > Page 262 | Tous droits réservés |

|
Fin d'année. |

|
|
Notre homme, harassé par ces longues heures d'arithmétique administrative, jeta sur le bureau, avec humeur, une plume qui n'en pouvait mais, et, se grattant vigoureusement le crâne en achevant de mettre en désordre une chevelure déjà grisonnante, se prit la tête à deux mains, les yeux rivés sur les grandes pages chiffrées. Tout était donc à reprendre. Vous me direz que, sur un joli nombre de millions de recettes, 111 francs et 11 centimes ne sont pas grand’ chose, et qu'il vaudrait mieux n'en point parler. Certes : mais la comptabilité est la comptabilité, et les chiffres les chiffres ; l'accord doit être complet et l'exactitude rigoureuse. Un centime, c'est un centime, et il faut aller le dénicher là où il est en trop ou en moins. Ainsi, la journée finissait sur ce coup du sort. L'année aussi, puisqu'on était au 31 décembre. Et, au dehors, la bise soufflait. Il faisait froid. Les jardins que l'on apercevait à travers les carreaux étaient tristes et nus, avec leurs arbres dépouillés et de longues traînées de neige tassée tout le long des murs exposés au nord. On voyait fumer les cheminées, jetant sur le ciel gris leur panache noir. Parfois, un moineau se posait sur le rebord d'un toit voisin, puis s'engouffrait sous une tuile ou dans un trou de mur pour y passer la nuit à l'abri. Soudain, un coup de klaxon, prolongé, retentit dans la rue, suivi du bruit d'un moteur ronflant devant la porte. Garrigue sursauta ; il avait compris et lâcha, tout. Et, cinq minutes plus tard, il descendait l’escalier quatre à quatre, jetait dans la voiture bottes, fusil et tout son fourniment de chasseur, y poussait son chien et s'engouffrait à son tour à côté du conducteur qui, déjà, démarrait. L’horloge de la poste marquait quatre heures. On avait bien le temps, car les canards ne viennent guère avant la nuit. Mieux valait, tout de même, ne pas être en retard, car on pourrait, peut-être, faire les trous avant la passée. On descendit aussi vite que le permettait une route recouverte d'une couche de neige gelée. En passant le pont qui franchit le fleuve, on vit celui-ci charrier des glaçons dont certains s'accumulaient sur les bords. Garrigue, à travers la vitre levée, fouillait des yeux le long ruban d'eau à moitié gelé. — Voyez-les, là-bas ! Le chauffeur ralentit, stoppa presque, pour voir à 300 mètres, en face la scierie, une douzaine de canards alignés immobiles, le long de la glace. — C'est bon. Ils ne vont pas rester là. À la nuit, nous les verrons rappliquer. Une autre bande passa au-dessus du pont, redescendant le fleuve. Les chasseurs sentirent l'espoir naître dans leur cœur : la passée allait être bonne. La voiture reprit sa route à vive allure, traversa le bourg à peu près désert et, quelques minutes plus tard, arrivait auprès d'un petit bras du fleuve, à l'abri d'une grande haie de buissons où on avait coutume de la garer. Les deux chasseurs eurent tôt fait de s'équiper et, afin d'avoir le temps de tout battre avant l'heure de se porter, se séparèrent. Suivant le grand talus, Garrigue se dirigea tout droit vers le fond de la gravière qui s'étendait, plate et nue, devant lui. Tout à droite, longeant la haute falaise de rochers, la Loire coulait, allait baigner le pied de la maison du passeur, puis la grande muraille de la voie ferrée, et se perdait vers le grand tournant du moulin. Cachée dans les arbres qui l'entourent, la première mare ne recélait aucun gibier. Seuls deux ou trois merles, blottis dans les buissons, s'envolèrent en ricanant. Il arriva à la deuxième, encombrée de joncs et d'osiers : trois colverts partirent à grand bruit d'ailes. Un mâle tomba net. Au second coup, l'oiseau visé continua sa route comme si rien n'était. Mais on suit toujours des yeux un gibier tiré, même manqué. Les deux canards filaient, ayant pris une bonne hauteur, vers le village qui coiffe le coteau d'en face, quand, soudain, l'un d'eux perdit du terrain et, tandis que l'autre filait bon train, baissa, baissa, jusqu'au ras des terres où il parut se poser. « Il y est ! », se dit notre homme, qui repéra aussitôt le point de chute : trois grands peupliers se dressant, à 4 ou 500 mètres de là, sur la plaine nue que balayait le vent glacé. Il prit au chien le beau mâle qu'il lui rapportait et se hâta, car il ne voulait pas manquer l'heure de la passée. Il allait vite, courait presque, à travers prés et labours, le chien devant lui. Bientôt, au loin, au beau milieu d'un seigle levé, un gros point noir lui apparut ; ce ne pouvait être un caillou — il n'y a point d'aussi gros cailloux dans un semis. Se dirigeant droit dessus, il comprit que ce devait être là son canard et fit un geste au chien : « Va chercher, mon vieux, va chercher ! » L'animal partit au galop dans la direction indiquée et eut tôt fait de ramasser et rapporter une cane déjà raidie. Allons, pour ce soir, la bredouille était conjurée. Dans l'île, quelques coups de feu avaient retenti. Était-ce le compagnon ? Il traversa rapidement la gravière, glissant parfois sur les galets ronds recouverts de verglas, et arriva au bord du marais. L'horizon s'assombrissait. La neige s'était mise à tomber, une petite neige dure et cinglante qui tourbillonnait et que le vent vous envoyait au visage, dans les oreilles, dans le cou. Il allait prendre son poste habituel dans une épaisse touffe de joncs quand un « ho ! ho ! » sonore lui indiqua que l'ami arrivait. Il le vit déboucher, en effet, balançant un colvert au bout de son bras, et lui répondit par le même cri de reconnaissance. Alors chacun ayant pris son poste d'affût, attendit. Vous connaissez la passée. On s'y gèle, les pieds souvent humides quand une botte se met brusquement à prendre l'eau. Le nez semble mort et les doigts sont raides. Mais que viennent tournoyer canards ou sarcelles, et tout va bien. Il faisait déjà nuit, sans un brin de lueur au couchant. En coup de vent, trois sarcelles piquèrent, et se posèrent sur l'eau. Mais des herbes, des joncs étaient là aussi, mêlant leurs ombres à celles des oiseaux. Tout de même, Garrigue tira sur le groupe indistinct, un peu au jugé. Une seule sarcelle s'envola, mais n'alla pas loin, car le bruit de sa chute suivit le coup de feu de l'autre chasseur. Quant aux deux autres, elles étaient restées sur le coup. Un instant résonna dans le silence du marais le barbotage des chasseurs allant ramasser leur butin. Puis, de nouveau, le calme revint. À plusieurs reprises, canards et sarcelles passèrent, à peine visibles dans la tourmente glacée et salués en vain. On les entendait s'abattre dans les vorgines, où ils barbotaient, sans même vouloir se lever au bruit que faisaient tout exprès les chasseurs, navrés de les sentir aussi près sans les voir. Bruyants battements d'ailes, cancanement étouffé des canes, cri sonore des mâles, parfois deux ou trois notes sèches venant d'une volée de sarcelles qui se posaient en trombe ou sifflement lointain d'un vanneau qu'emportait la bourrasque remplissaient l'ombre de ces bruits familiers et chers aux chasseurs. Les deux compagnons, immobiles, restèrent là un moment encore. Seuls, au sein de cette solitude nocturne, malgré le froid qui, au cours de la nuit, allait geler tout le marais, ils goûtaient des instants qui, pour eux, valaient plus que tous les plaisirs du monde ... Bientôt, dans l'ombre épaisse de ce soir d'hiver qui s'appesantissait sur ce coin de terre, le bruit d'un moteur éveilla l'écho du, marais. Les longs faisceaux des phares trouèrent la nuit : les chasseurs rentraient. FRIMAIRE. |

|
Le Chasseur Français N°639 Mai 1950 Page 262 |

|

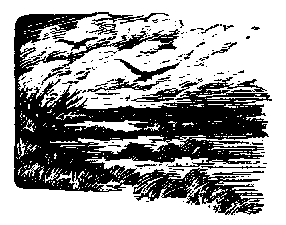 Depuis la veille, Garrigue alignait d'interminables
additions, brassait des chiffres, inscrivait des reports et établissait
récapitulation sur récapitulation. Il arriva ainsi, après avoir tourné maints
et maints feuillets, à la dernière page du registre, puis à la dernière ligne.
Le résultat, hélas ! fut décevant : ça ne « collait » pas ;
il y avait une erreur de 111 francs 11 centimes. C'était encore l'époque bénie
des centimes, je dis bien : l'époque bénie ; car, à présent, malgré
l'arrondissement au franc (pauvre franc !), malgré les simplifications ...
compliquées, la savante et sèche mécanographie et la suppression de ces longues
statistiques toujours fausses, mais qui, à grand renfort de coups de gomme, de
fantaisie et d'imagination, finissaient toujours par cadrer, ce qui a pu faire
dire de la statistique qu'elle est « un mensonge exact », ou quelque
chose d'approchant — malgré tout cela, dis-je, on soupire après l'époque
des centimes, puisqu'elle est celle des années révolues, que l'on regrette
toujours après leur chute lente, inexorable et sans retour dans le gouffre sans
fond du temps.
Depuis la veille, Garrigue alignait d'interminables
additions, brassait des chiffres, inscrivait des reports et établissait
récapitulation sur récapitulation. Il arriva ainsi, après avoir tourné maints
et maints feuillets, à la dernière page du registre, puis à la dernière ligne.
Le résultat, hélas ! fut décevant : ça ne « collait » pas ;
il y avait une erreur de 111 francs 11 centimes. C'était encore l'époque bénie
des centimes, je dis bien : l'époque bénie ; car, à présent, malgré
l'arrondissement au franc (pauvre franc !), malgré les simplifications ...
compliquées, la savante et sèche mécanographie et la suppression de ces longues
statistiques toujours fausses, mais qui, à grand renfort de coups de gomme, de
fantaisie et d'imagination, finissaient toujours par cadrer, ce qui a pu faire
dire de la statistique qu'elle est « un mensonge exact », ou quelque
chose d'approchant — malgré tout cela, dis-je, on soupire après l'époque
des centimes, puisqu'elle est celle des années révolues, que l'on regrette
toujours après leur chute lente, inexorable et sans retour dans le gouffre sans
fond du temps.