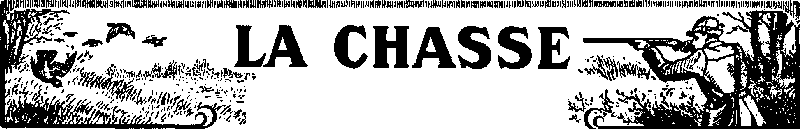| Accueil > Années 1950 > N°640 Juin 1950 > Page 335 | Tous droits réservés |

|
Courrier cynégétique |

|
Chasse à courre au bois de Boulogne.— Récemment, les joueurs de boules de la Société du lac Saint-James au bois de Boulogne étaient mis en émoi par l'apparition brusque, au milieu du jeu, d'un magnifique lapin. Malheureusement pour Jeannot, un chien qui se trouvait par là en liberté arrêta bientôt sa course, et ce fut bien dommage. Après vérification, il s'agissait bien d'un lapin de garenne. M. Roux, abonné. Quelle est cette bête fauve ?— Dans notre département de l'Isère, aux confins des arrondissements de Vienne, Saint-Marcellin et La Tour-du-Pin, région de la plaine du Liers, tous les deux ou trois mois des chiens de chasse sont tués par un animal qu'on n'a pas encore réussi à identifier. Il y a toujours lutte. Les chiens portent des morsures au cou et à la nuque, puis ils sont éventrés d'un côté. La paroi abdominale est sectionnée de la cuisse à la colonne vertébrale et au sommet des côtes. Le foie paraît être dévoré. Ces accidents sont particuliers aux chiens de chasse (petits courants), et le drame se passe presque toujours prés des bois. Dans un rayon d'un kilomètre d'un point donné, une quinzaine de chiens ont été tués. On se perd en conjectures sur l'auteur de ces méfaits. On a d'abord parlé de lynx, car quelques-uns de ces animaux s'étaient, paraît-il, évadés du Zoo de Milan. Une battue avait d'ailleurs été faite sans succès. D'autres parlent de loup. Mais jamais un fauve n'a été aperçu. À mon avis, nous avons affaire à un chien méchant et vicieux ou à une chienne hystérique, car les chiennes sont tuées comme les chiens. Mon opinion vaut ce qu'elle vaut, mais elle est fondée sur les raisons ci-après : 1° L'étendue de nos bois en profondeur ne me paraît pas de nature à donner asile à un fauve ; 2° En deux saisons de chasse, nos bois ont été battus au moment des bécasses : aucun fauve n'a été aperçu ; 3° Un animal sauvage, lynx ou loup, ne se contente pas de manger un morceau de chien tous les deux ou trois mois ; or aucun autre animal domestique n'a été touché, et ces méfaits sont strictement localisés à la région. P. DIGAUD, au Mottier (Isère). Longévité d'une tourterelle femelle.— Née le 10 septembre 1910, elle est morte la 19 septembre dernier ; elle n'avait aucune infirmité, y voyait très bien, se perchait encore très haut dans sa cage et mangeait de bon appétit. Depuis une dizaine d'années, après la mort de son mâle, elle ne pondait plus et roucoulait très rarement. Très familière, elle passait les hivers en liberté dans notre cuisine. Ce qui nous permet de préciser exactement son âge, c'est que, depuis 1917, elle avait une aile brisée (un chien policier l'avait prise dans sa cage ; c'est mon jeune fils qui l'avait sauvée). J'avais lu sur votre journal le cas d'une tourterelle de trente-trois ans ; le cas de la notre étant assez rare, je crois bien faire en vous le signalant. F. BONNAUD, abonné. Heureux chasseur !— Dans les premiers jours de novembre, un de nos amis, dans les marais d'Oix (Landes), M. Couderc, de Dax, chassait la bécassine et venait de réussir un beau doublé. À peine son arme rechargée, deux outardes tirées dans un vol passant à portée étaient également démontées. En allant les ramasser, un colvert s'envolait sous les pieds de notre chasseur, qui mettait avec cette belle pièce un point final à la série. Ainsi, en quelques secondes, la gibecière de M. Couderc se trouva bien garnie, et son contenu suffit à fêter comme il convenait une aussi brillante réussite, surtout dans notre région, malheureusement si pauvre en gibier. J. DE LAPORTERIE, abonné. Perdreaux et arséniates.— Je lis fréquemment dans vos colonnes les doléances de chasseurs relatives à la mortalité du gibier provoquée par les arséniates répandus sur les pommes de terre pour la destruction des doryphores. Or j'ai un jardin potager où se trouvent environ trois cents pieds de vigne, raisins de table et de cuve. Il y a deux ou trois ans environ, faisant traiter la partie en vigne avec une bouillie composée de 2 kilos de sulfate de cuivre, 2 kilos de chaux et 4 à 5 kilos de soufralo, il me resta une cinquantaine de litres de bouillie que je fis répandre au pulvérisateur sur les plants de pommes de terre infestés de doryphores. Le lendemain, lorsque je vins comme d'habitude pour procéder au ramassage du doryphore, quelle ne fut pas ma surprise de n'en trouver aucun : ils étaient morts. J'attribuai ce résultat au soufralo et, quelques jours après, les œufs étant éclos, je fis procéder à une nouvelle aspersion du même mélange sur les pommes de terre et j'obtins le même résultat. J'ai communiqué ce procédé à d'autres propriétaires, qui s'en trouvent bien. Je ne pense pas que le soufralo soit toxique pour les autres animaux, y compris le gibier. Un essai est très facile, et je serais heureux qu'il puisse rendre service à vos abonnés. F. GORGUOS, abonné. Oiseaux en migration.— Ayant fait quelques constatations au cours d'un récent voyage Marseille-Saïgon, il m'a paru utile d'en faire bénéficier les lecteurs du Chasseur Français. J'ai effectué ce voyage au mois d'octobre, à travers la Méditerranés, la mer Rouge, l'océan Indien. Les premiers oiseaux que je vis furent des merles et des grives au large de la Corse (nord-sud), puis, en mer Ionienne, des tourterelles par bandes de dix à quinze oiseaux, venant d'Italie et se dirigeant sur la Sicile. Plus loin, au large de la Crète, ce furent des alouettes, des cailles, volant au ras des vagues à grande vitesse, mais si fatiguées qu'en apercevant le navire elles se posaient sur le pont et se laissaient prendre à la main. Des bandes de moineaux, également en pleine mer, se sont réfugiés dans les cordages. En mer Rouge, les cailles abondaient, se dirigeant toujours est-ouest. Dans l'océan Indien, j'ai constaté la présence de beaucoup de bécasses et bécassines venant des Indes ou du Bengale et se dirigeant plein sud. Certains oiseaux sont même restés deux ou trois jours à bord, puis, sentant l'approche de la terre, sont repartis. Gaston NICOLAS, abonné. Rapaces.— J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les articles de M. Chaigneau sur les rapaces ; ces derniers y sont décrits de telle façon que les moins avertis peuvent en différencier les diverses espèces. Nombreux sont encore, malheureusement, chasseurs et cultivateurs qui confondent dans la même aversion les rapaces diurnes d'une certaine taille : buses, busards, vautours, milans, etc., nuisibles pour le plus grand nombre, et qui, sous le nom générique de chotts (hiboux) en langage du pays, englobent tous les nocturnes plus petits que le grand duc : chouettes, hiboux, hulottes, chats huants, etc., ces auxiliaires si précieux de l'agriculture. Quant au grand duc, il est considéré à juste titre, du moins pour les chasseurs, comme un brigand. Le massif boisé de la Malepère est, je crois, son pays d'élection ; il y est sédentaire, il y niche, et nombreux sont les individus. En bordure de ses bois est un éperon rocheux, taillé à pic, surplombant un ravin particulièrement fourré dans les anfractuosités duquel nichent ces rapaces. Un de mes voisins a tué l'an dernier, à coups de bâton, deux jeunes, presque aussi gros que des adultes, qui n'avaient pas encore quitté le nid. Le garde-manger était bien approvisionné : un lapin dont il ne restait guère que le squelette, un second auquel il manquait une épaule et le foie, et un plus petit encore entier. Travaillant ma vigne sur la pente d'un coteau ensoleillé à quelque distance, mais en face cette colline boisée, il y a trois ou quatre ans, j'entendais par les belles journées d'été, vers le soir, les cris d'amour ou de rappel de ces rapaces. Un soir particulièrement calme, Je pris mon fusil et allai me poster sous un gros cerisier, dont les branches retombantes formaient un affût naturel. Je n'eus pas longtemps à attendre. Deux de ces oiseaux vinrent se percher sur la tête chauve de deux têtards, à une soixantaine de mètres du cerisier. Ils restèrent longtemps immobiles, sur leurs perchoirs, pendant qu'un autre couple, les parents sans doute, se rappelait de chaque côté de la vallée d'un miaulement particulièrement sinistre à cette heure. La nuit étant arrivée, je sortis de l'abri, et les oiseaux, deux jeunes probablement, s'envolèrent. Je suivais un chemin encaissé quand un grand duc arriva sur moi en vol plané. Instinctivement je levai les bras, le fusil avec, comme pour me parer d'un projectile. Le coup partit et le nocturne s'abattît à mes pieds, foudroyé. Dangereuse imprudence, il aurait pu me tomber sur la tête et m'abîmer la figure. C'était un spécimen magnifique, une femelle probablement, de prés de deux mètres d'envergure. À signaler également dans les bois de la Malepère un renard albinos. Un jeune chasseur ayant une petite griffonne très bonne sur le renard, et qui en a déjà plusieurs à son actif, surpris de la couleur inaccoutumée de ce renard, lui a tiré ses deux coups de fusil, mais maître renard blanc court encore. S. C., abonné. Disparition des nids de chardonnerets.— Depuis une dizaine d'années, nous avons constaté avec quelques voisins que les nids de chardonnerets avaient totalement disparu de notre contrée. Avant cette époque, je trouvais tous les ans une dizaine de nids de chardonnerets sur mes pêchers lorsque je les taillais ; depuis, pas un seul, et je n'en vois pas pendant la saison de la ponte. Par contre, à la saison de la migration (novembre à l'aller, février au retour), il en passe des vols très importants qui ne restent que quelques jours seulement (huit au maximum), ce qui n'existait pas autrefois dans ces proportions. Est-ce que ce serait la conséquence d'un changement de mœurs de ces oiseaux ? Quelqu'un aurait-il constaté leur apparition dans une autre contrée ? MOURET, abonné. |

|
Le Chasseur Français N°640 Juin 1950 Page 335 |

|