| Accueil > Années 1950 > N°642 Août 1950 > Page 457 | Tous droits réservés |

|
L'alligator |

|
|
Nous montions un pont métallique sur le rio Tapenaga, et notre campement se trouvait à quelques kilomètres plus au nord, à l'endroit où devait se construire la gare qui porte aujourd'hui le nom de cette petite rivière. Je regagnais à cheval, un soir, mon humble logis par la piste en forêt qui longeait à peu près le rio lorsque mon attention fut attirée par les cris d'un aigle. Celui-ci s'élevait en tenant dans ses serres quelque chose qui se débattait et que je pris tout d'abord pour un serpent. L'oiseau toutefois ne put longtemps maintenir sa proie, qui glissa et vint tomber tout près de moi ; je reconnus alors non un serpent, mais une belle anguille dorée qui s'empressa de regagner son élément. Dans ces eaux boueuses du Tapenaga, il y avait donc des anguilles ; quelle aubaine ! Toutefois je n'avais ni filet ni hameçon et, si je voulais varier un peu le menu de viande boucanée et de conserves, il allait falloir improviser. Rentré au rancho, je trouvai une aiguille à coudre. Je la détrempai au feu ; j'y passai un bout de ficelle. Comme gaule une branche d'arbre, et comme appât un morceau de viande. Avec cet engin, je fis, si je puis dire, le lendemain à l'aube, mes premières armes de pêcheur à la ligne. Le Tapenaga roulait sa boue à cent mètres de mon gîte ; la première séance fut un succès qui dépassa tous les espoirs : je rapportai au cuisinier ébahi une douzaine de magnifiques anguilles dorées à l'échine cartilagineuse. Le lendemain, même résultat. Nous décidâmes alors, pour ne pas perdre un tel butin, de faire des salaisons. Le troisième jour, je lançai ma viande dans le même trou que les jours précédents : aucune touche. Je changeai de place : toujours rien. Enfin, je revins au premier endroit. C'est alors qu'une forme verdâtre, presque à fleur d'eau, attira mon attention. Je crus avoir à faire à une « vieja », nom que donnent les indigènes à un curieux poisson qui peut se passer d'eau pendant des mois. Il s'enfonce dans la vase en période de sécheresse et y reste jusqu'à la crue suivante. Ce poisson, à chair médiocre et peu abondante, possède une peau extraordinairement épaisses et dure comme une carapace. Je sortis mon poignard, je me couchai sur la berge et j'essayai de percer cette chose coriace et immobile. Quelle ne fut pas alors ma surprise de voir se déplacer dans un remous un beau « yacaré » (2) de 2m,50 à 3 mètres de longueur. C'était sa queue que j'avais piquée et que j'avais, dans l'eau trouble, prise pour un poisson. Heureusement pour moi, la bête n'était pas tournée pour me happer, car, la tête penchée sur l'eau, j'étais dans la position la plus indiquée pour disparaître sans histoire. Tel fut mon premier contact avec les alligators, engeance envers laquelle j'ai toujours eu, par la suite, une sympathie modérée. Dans les mois, dans les années qui suivirent, dans le Parana, dans ses affluents, dans les lagunes de Resistencia ou de Puerto-Barranqueras, je devais rencontrer des milliers de ces sauriens et en détruire quelques-uns, trop peu hélas ! Plus au nord, à dix lieues du Tapenaga, coule le rio Salado, rivière un peu plus importante que la première et surtout plus profonde ; ses berges étaient semées de leurs nids. Parfois, à coups de bottes, nous nous amusions à envoyer ces nids dans l'eau où ces bêtes s'agitaient. Nids véritablement curieux, en forme de cônes, où les œufs sont disposés par couches successives : une couche d'œufs, une couche d'herbes en décomposition. Le soleil couvait le jour et la putréfaction entretenait la température durant la nuit. Les œufs étaient de la grosseur de ceux de poule ; mais plus allongés et symétriques. La coquille, d'un blanc pâle, était rugueuse comme du papier de verre. J'ai vu des Indiens s'en régaler ; mais ma curiosité n'a pas été jusqu'à les imiter. Comme je faisais remarquer à l'un d'eux qu'il y avait dans certains de ces œufs de petits « yacarés » qui prenaient bonne tournure, il me répondit que c'était précisément ceux-là qui avaient le meilleur goût. Près de Resistencia, capitale du Chaco austral, le rio Negro, affluent du Parana, roule mollement ses eaux jaunes qu'il déverse dans l'immense fleuve à quelques kilomètres de là. À l'époque, près du pont, les gauchos ne se hasardaient plus à y faire abreuver leurs chevaux. Quelques alligators, sans doute spécialisés, attrapaient les animaux par la tête, les tiraient dans l'eau, et on ne les revoyait plus. Face à la frontière sud du Paraguay, Resistencia étale ses orangers, ses palmiers, ses bananiers, ses eucalyptus. Son port est Barranqueras sur le Parana, à 7 kilomètres de là. Lors de la construction de la gare de ce dernier, nous avions dû faire des emprunts de terre considérables pour les terrassements. Une crue du Parana transforma ces excavations en lagunes ; elles furent aussitôt peuplées d'un nombre considérable d'alligators. La nuit, ces sauriens faisaient leurs petites randonnées de croquemorts. Souvent, au lieu de faire la sieste aux heures les plus chaudes de la journée, je prenais mon fusil et je m'en allais rôder dans la forêt voisine en bordure des lagunes. Malgré les précautions que je prenais pour ne pas faire de bruit, tout paraissait désert et silencieux ; mais, au bout de quelques minutes d'attente, la surface de l'eau se peuplait de curieuses paires de lunettes ; quelques minutes encore, et les nez apparaissaient ; puis c'était les dos. Enfin, si le silence se prolongeait, les formes se présentaient comme des troncs d'arbres qui auraient remonté lentement de la vase. Dans un espace d'environ un hectare, j'ai compté parfois une douzaine d'alligators immobiles et attentifs. Qui se douterait que ces bêtes sont capables, sur terre, de détaler à la vitesse d'un cheval au galop ? Sur un lorry à pompe faisant sur rail beaucoup de bruit, je revenais un soir de Barranqueras à Resistencia et nous allions aborder un pont sur la lagune Boggio. Des cadavres de chevaux et de bœufs, tués quelques jours auparavant par le chasse-beuf de la locomotive, gisaient à cent mètres de la lagune. Sur l'un de ces cadavres, sept alligators festoyaient ; à notre arrivée, ils s'enfuirent avec une telle vitesse que nous en sommes restés interloqués. Ils semblaient des lézards géants lancés avec toute la vitesse dont sont capables ces derniers. Heureusement pour l'homme, ces bêtes sont, à terre, craintives et lâches. Des accidents arrivent parfois, presque toujours tragiques ; mais, à ma connaissance du moins, ceux qui en ont été victimes ont commis des imprudences en se mettant à l'eau dans des endroits infestés de ces sauriens. Le jour, les « yacarés » s'étalent volontiers au soleil près de l'eau, où ils plongent au moindre bruit ; par contre, le soir ou la nuit, ils s'éloignent assez loin sur terre à la recherche des charognes. Les crues périodiques et considérables du Parana les déplacent, et certaines lagunes en sont alors véritablement infestées. Avec quelques amis, il m'est arrivé de faire des cartons très réussis : plusieurs douzaines dans la même journée. Tirés à la carabine à cinquante mètres, touchés à la tête, ils montrent un instant leur ventre en l'air, puis disparaissent sans laisser de traces : leur aimable famille alors, sans nul doute, se charge rapidement de la cérémonie des funérailles. Léon VUILLAME.
(1) Forêt du Chaco. |

|
Le Chasseur Français N°642 Août 1950 Page 457 |

|

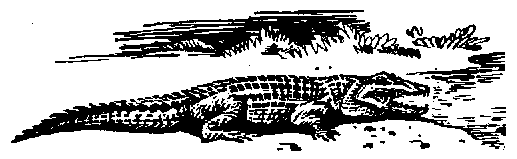 C'était l'hiver austral de 1907, avec ses belles
journées ensoleillées, avec ses nuits glacées qui laissaient du givre aux
arbres de la forêt chaqueña (1), avec ses moustiques de toujours.
C'était l'hiver austral de 1907, avec ses belles
journées ensoleillées, avec ses nuits glacées qui laissaient du givre aux
arbres de la forêt chaqueña (1), avec ses moustiques de toujours.