| Accueil > Années 1950 > N°643 Septembre 1950 > Page 514 | Tous droits réservés |

|
Des étangs à la montagne |

|
|
J'ai traversé la France par son centre jusqu'à l'Océan en compagnie de mon ami Roger, voyage magnifique, au cours duquel j'ai regardé avec mes yeux de chasseur certaines régions pour moi nouvelles. Après une centaine de kilomètres, je ne retrouve plus un seul des caractères de la région méditerranéenne. Voici les plateaux du Massif Central avec leurs bois de pins et leurs genêts, leurs champs favorables aux cailles et aux lièvres. Puis c'est la descente sur l'autre versant et la traversée désormais continuelle de pâturages coupés de haies. Au départ de Bourges, je n'en parlais pas, mais j'éprouvais une douce émotion en allant traverser cette Sologne qui jouit d'une si grande réputation. Passage trop rapide marqué de courts arrêts. Roger, vous le savez, ne chasse pas, mais s'intéresse quand même au gibier. « Tu crois qu'il y a des faisans dans cette forêt, des canards sur cet étang ? » me disait-il, et j'essayais de répondre en faisant appel à mes lectures. Nous traversions une haute futaie coupée de layons. Je lui racontais comment on chassait à courre. Soudain : « Vois ! vois ! ... me dit-il. Vois ces cerfs ! ... « C'étaient deux bicyclistes qui, sortant d'un chemin forestier, traversaient la grand' route. Le crépuscule venait, l' « erreur » comme on dit en Provence, et puis je finis par lui échauffer la tête avec mes histoires de chasse. Ah ! certes, loin de moi l'idée de médire des paysages majestueux que traverse la Loire. J'en ai admiré sans arrière-pensée la sublime harmonie ; j'ai apprécié chez les amis les plus charmants la douceur angevine et la splendeur des forêts, et le charme de paysages modérés. J'ai senti le besoin d'en pénétrer les secrets cynégétiques et d'y revenir pour chasser, pour explorer les haies, fouiller les bois, voir du gibier sur les étangs, connaître les possibilités de tant de vertes prairies si différentes de nos garrigues. Mais j'avoue aussi sans ambage que j'ai retrouvé avec joie les contrastes et les oppositions de mes paysages familiers, d'autant plus qu'après mon retour je ne tardai pas à partir en Camargue, ou plutôt en Petite Camargue, pour chasser le sanglier.
Abrivo! Uno tourre a fusa per orto. (Au galop ! Une tour a fui sur la plaine. Là-bas, Aiguesmortes dorée s'évanouit au fond de la clarté.) On marche encore et on se heurte soudain à la mer, à la Méditerranée pour tout dire, tant elle est bleue sur ses plages désertes. Les sangliers signalés n'étaient plus dans les pinèdes. Des broutis vieux de quelques jours confirmaient leur absence. Néanmoins une trace plus récente s'imprimait dans le sable. Au bord de l'étang des Fourneaux, elle était même chaude. Les flaques traversées étaient encore troublées. L'accueillant propriétaire de la chasse qui l'avait découverte m'appela et nous la suivions. Les chiens, l'ayant croisée, la goûtèrent aussitôt. Une bande étroite de bois s'étirait parallèlement à l'étang. Les piqueurs appuyaient les chiens lorsque soudain an gros solitaire bondit de dessous un pin parasol et se jeta dans les enganes, laissant les piqueurs éberlués, tandis qu'il entraînait la meute hurlante dans un à-vue furieux. Les plus proches témoins de la scène, gênés, n'avaient pu tirer. Mais un chasseur plus en retrait lui brisa les reins. Il fallut l'achever au milieu des chiens tourbillonnants qu'il risquait d'éventrer cependant que sur l'étang trois cents flamants effrayés fuyaient cette scène tragique. Quelques jours plus tard, notre petite meute chassait dans un paysage tout différent et pourtant à peine éloigné de quatre-vingts kilomètres à vol d'oiseau. De un mètre au-dessus du niveau de la mer, nous étions montés à douze cents. Là, le paysage s'élève sans arrêt. Les routes suivent les vallées. Au midi, les cultures sont en gradins et les vignes et les oliviers escaladent les pentes à la recherche des abris. Au nord, il y a d'abord des chênes verts, puis des châtaigniers, puis avec l'altitude apparaissent les pins et les fayards. C'est sur les pentes de l’Aigoual. De l'observatoire le regard plonge vers ces lointains indéfinis et maritimes où stationnent les phénicoptères. Ici, c'est déjà la montagne : pentes profondes semées d'éboulis, forêts de pins et de fayards, ruisseaux peuplés de truites courant sur un lit de pierres. C'est tout l'opposé des brochets et des anguilles des roubines aux eaux stagnantes. Les cloches que l'on entend ne sont pas celles des « simbeu » des prochaines manades, mais annoncent de pacifiques vaches laitières. Le mouvement de la chasse ne fait pas débouler des lapins, mais parfois un lièvre fuit le bruit, s'arrête, écoute, part dans les genêts. L'air est vif, mais c'est le même ciel bleu. Lorsque la meute a lancé les sangliers, les échos répercutent les abois, les combes les éteignent. Les tireurs postés sur les crêtes dominent tout un panorama de montagnes. Ceux qui sont postés dans les vallons restent parfois de longues heures sans savoir où se déroule la chasse, ou bien l'écoutent à travers le bruit continuel du torrent ou le fracas du vent. Les postes sont éloignés les uns des autres, et il faut tous se retrouver pour faire l'historique de la journée. Un de mes amis avait tué un sanglier. Il l'avait émasculé et tiré contre un pin. Posté un peu plus loin, il vit venir un chasseur avec un chien. Le chien sentit le sanglier mort et aboya furieusement. L'espoir de mon ami ne fut pas déçu. Le chasseur épaula, tira et se mit à crier : — Je l'ai tué ! — Vous l'avez tué une deuxième fois. Regardez donc entre ses pattes de derrière ... Évidemment, ça ne tombe pas tout seul. Lorsque les chiens se forlongent après une bête de chasse, il est difficile de les rallier. Vers quels secteurs ont-ils été entraînés ? On les retrouve parfois plusieurs jours après, et leur recherche est le revers des belles journées de chasse. La descente est rapide, l'air devient plus chaud et le contraste est surtout frappant dans les mois d'été. L'hiver, c'est le même vent qui s'élance des sommets pour balayer les plaines, qui siffle dans les sapins, ploie les tamaris et bouleverse la surface des étangs. Jean GUIRAUD. |

|
Le Chasseur Français N°643 Septembre 1950 Page 514 |

|

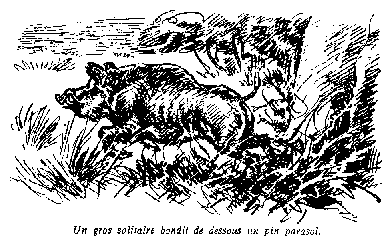 De douceur dans le paysage, il n'y en a guère, ou elle y
a un autre aspect. Les champs ne sont pas découpés de façon régulière, le ciel
est uniforme ou garni d'orages menaçants, les lointains ne sont pas fondus dans
la brume bleutée, mais l'ensemble ordonne les détails dans un équilibre
parfait. Après avoir dépassé Montcalm et Sylveréal, où chaque maison ouvre un
pin parasol sur sa toiture, pour arriver au terrain de chasse il faut suivre
une piste épouvantable, défoncée par les taureaux. Mais elle aboutit à l'étang
de la Grande-Gorgue, couvert de flamants. Ces oiseaux sont impressionnants tant
par leur nombre que par leurs couleurs, par leur vol à l'allure particulière
qui donne au paysage un caractère hiératique. Ils sont tellement serrés au loin
que, pour les reconnaître, il faut les regarder à la jumelle. À l'œil nu, on
dirait un mur blanc ou une arête de rochers, aspect insolite dans ce paysage de
sable et d'eau. Au bord des lagunes, point des hêtres ni de chênes, mais un
maquis de broussailles sous des pins parasols, des tamaris et des enganes. Dans
le lointain, on voit comme un mirage la tour de Constance. Alors, tel le beau
vol des oiseaux roses de l'étang, s'élèvent dans la mémoire les vers de Joseph
d'Arbaud :
De douceur dans le paysage, il n'y en a guère, ou elle y
a un autre aspect. Les champs ne sont pas découpés de façon régulière, le ciel
est uniforme ou garni d'orages menaçants, les lointains ne sont pas fondus dans
la brume bleutée, mais l'ensemble ordonne les détails dans un équilibre
parfait. Après avoir dépassé Montcalm et Sylveréal, où chaque maison ouvre un
pin parasol sur sa toiture, pour arriver au terrain de chasse il faut suivre
une piste épouvantable, défoncée par les taureaux. Mais elle aboutit à l'étang
de la Grande-Gorgue, couvert de flamants. Ces oiseaux sont impressionnants tant
par leur nombre que par leurs couleurs, par leur vol à l'allure particulière
qui donne au paysage un caractère hiératique. Ils sont tellement serrés au loin
que, pour les reconnaître, il faut les regarder à la jumelle. À l'œil nu, on
dirait un mur blanc ou une arête de rochers, aspect insolite dans ce paysage de
sable et d'eau. Au bord des lagunes, point des hêtres ni de chênes, mais un
maquis de broussailles sous des pins parasols, des tamaris et des enganes. Dans
le lointain, on voit comme un mirage la tour de Constance. Alors, tel le beau
vol des oiseaux roses de l'étang, s'élèvent dans la mémoire les vers de Joseph
d'Arbaud :