| Accueil > Années 1950 > N°644 Octobre 1950 > Page 581 | Tous droits réservés |
Un oiseau solitaire

|
Le tire-langue |

|
|
Dans mon jardin actuel, niché au creux d'une vallée beaujolaise, il est revenu, le tire-langue de ma jeunesse, que je sais à présent s'appeler le torcol. Pas tout de suite et pas tout seul. J'ai longtemps entendu dans les prés d'alentour son appel nostalgique, auquel l'éloignement imprime son mystère, avant d'avoir l'idée de lui offrir chez moi une demeure. Un nichoir de plus grande dimension que ceux offerts habituellement aux mésanges a réalisé ce miracle, et ce nicheur de trous n'a pu rester insensible aux attraits de cette jolie habitation à toit d'ardoise, fixée au tronc d'un grand cerisier. Mais il s'agissait d'un célibataire, qui n'entendait pas laisser se perdre cette aubaine d'un logement gratuit pour y élever une famille. Il a donc publié son annonce matrimoniale, comme le font tous les oiseaux, par ses cris — et quels cris ! Plus rien de nostalgique et d'alangui, je vous assure. Tout le voisinage en fut en rumeur. « Quel est donc cet oiseau qui crie tant chez vous ? », me demandait-on. Une semaine durant, il continua à s'époumoner. Son ardeur était telle qu'il ne songeait plus à se cacher. On voyait, accroché au grillage du bassin ou au poteau télégraphique, perché sur un arceau de rosiers ou les tuiles d'un mur, et lançant sans répit ses clameurs enfiévrées, ce bel oiseau de la taille d'une alouette, au plumage gris, très curieusement écussonné et zébré de noir, de brun et de roux, tandis que le dessous de son corps blanchâtre est grivelé horizontalement de taches brunes. Et puis, un beau jour, à quelque distance, une voix plus douce a répondu ... Et, depuis lors, les torcols sont devenus silencieux. C'est dans le plus grand mystère qu'ont eu lieu la ponte — ils ne font pas de nid ; les œufs reposent à même le fond du trou, — l'incubation et l'élevage des petits. À tel point que personne désormais ne put les apercevoir, pas même moi, qui les guettais et qui en arrivais à croire qu'ils avaient transporté leurs pénates ailleurs. Un jour, pourtant, en pénétrant sous les branches longues et retombantes du cerisier, je trouvai au pied du tronc, sous le nichoir, un fragment de coquille d'œuf blanche, mince et transparente. Un peu plus tard, comme je travaillais à proximité de cet arbre, mon attention fut attirée par les sons curieux qui s'échappaient du nichoir. Les oisillons au nid des diverses espèces piaillent tous à peu près de la même façon. Mais la progéniture de mes torcols criquetait comme une nichée de sauterelles. Plus tard encore, leurs crr ! crr ! crr ! m'arrivaient de tous les grands arbres du jardin. La petite famille avait pris son essor. Bientôt, elle s'éloigna dans la campagne et se dispersa. Je n'entendis plus que de loin en loin le cri nostalgique et alangui que je connais si bien, celui du torcol déchargé des soucis domestiques et redevenu solitaire, qui évoquera toujours pour moi les chauds après-midi de pêche de mon enfance. Le torcol doit son nom à la singulière habitude qu'il a de se contorsionner la tête en tous sens lorsqu'il croit sa personne ou sa couvée menacée de quelque danger ; il accompagne quelquefois cette mimique d'une sorte de sifflement destiné à décontenancer l'adversaire, tout en hérissant de son mieux les plumes de sa tête. Son surnom de tire-langue lui vient de sa coutume, non moins curieuse, de se procurer sa nourriture de prédilection, les fourmis et leurs larves. Il a, comme les pics, une langue très longue qu'il peut étendre à volonté et à laquelle, lorsqu'il la tend sur leur passage, viennent s'agglutiner ses proies favorites, C'est un oiseau tout à fait original, mais qui n'est aucunement rare et qu'on peut facilement observer dans les bouquets d'arbres, au milieu des prairies ou dans les vergers entourant les agglomérations rurales. Pierrette MAGNE. |

|
Le Chasseur Français N°644 Octobre 1950 Page 581 |

|

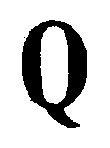 uand j'étais enfant, nous allions souvent pêcher dans
une petite rivière aux eaux calmes et lentes, à quelque distance de notre
habitation. Le cours de ce très modeste affluent du haut Rhône ne devait pas
dépasser une vingtaine de kilomètres. Il était délicieux, après avoir traversé
parmi ses cultures la vaste plaine sans arbres, toute brûlée de soleil,
d'atteindre enfin cette zone d'herbages : pâturages communaux, plantés de
peupliers et de vieux saules creux ou prés marécageux que fleurissaient en juin
les touffes d'un bleu éclatant de la gentiane pneumonanthe. L'après-midi se
passait là, à guetter anxieusement sur l'eau tranquille le frétillement du
petit bouchon indiquant qu'un minuscule fretin, vairon ou ablette, attaquait
l'asticot fixé à l'hameçon. Une sorte de bonheur confus, un sentiment divin de
paix et de liberté, que m'ont toujours causé les heures passées en pleine
nature, me pénétrait alors ; à mesure que le temps passait, il s'y mêlait
cette sorte d'hypnose que connaissent bien tous les pêcheurs à la ligne, faite
de l'intensité de l'attention, de la réverbération sur l'eau de la lumière et
de la chaleur assoupissante de l'été. Comme l'expression vocale de cette
béatitude enchantée, un appel nostalgique résonnait, étouffé par l'éloignement :
une série de quelques notes monotones, régulièrement rythmées sur un timbre un
peu languissant. Mon père disait : « C'est le tire-langue. »
uand j'étais enfant, nous allions souvent pêcher dans
une petite rivière aux eaux calmes et lentes, à quelque distance de notre
habitation. Le cours de ce très modeste affluent du haut Rhône ne devait pas
dépasser une vingtaine de kilomètres. Il était délicieux, après avoir traversé
parmi ses cultures la vaste plaine sans arbres, toute brûlée de soleil,
d'atteindre enfin cette zone d'herbages : pâturages communaux, plantés de
peupliers et de vieux saules creux ou prés marécageux que fleurissaient en juin
les touffes d'un bleu éclatant de la gentiane pneumonanthe. L'après-midi se
passait là, à guetter anxieusement sur l'eau tranquille le frétillement du
petit bouchon indiquant qu'un minuscule fretin, vairon ou ablette, attaquait
l'asticot fixé à l'hameçon. Une sorte de bonheur confus, un sentiment divin de
paix et de liberté, que m'ont toujours causé les heures passées en pleine
nature, me pénétrait alors ; à mesure que le temps passait, il s'y mêlait
cette sorte d'hypnose que connaissent bien tous les pêcheurs à la ligne, faite
de l'intensité de l'attention, de la réverbération sur l'eau de la lumière et
de la chaleur assoupissante de l'été. Comme l'expression vocale de cette
béatitude enchantée, un appel nostalgique résonnait, étouffé par l'éloignement :
une série de quelques notes monotones, régulièrement rythmées sur un timbre un
peu languissant. Mon père disait : « C'est le tire-langue. »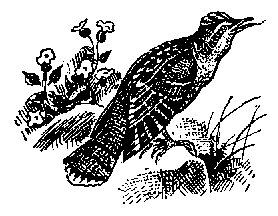 Au pied de la colline coiffée de taillis, parmi les
vignes de ses pentes, notre beau jardin, avec ses grands arbres et ses eaux
jaillissantes, formait au-dessus de la plaine, dévorée par la canicule, une
oasis de fraîcheur réconfortante. De superbes espèces exotiques bordaient
l'allée principale : un micocoulier, qui eût abrité un campement sous ses
branches, un sophora tout murmurant d'abeilles, un tulipier de Virginie, un
févier d'Amérique, ceinturé de formidables épines et balançant au vent ses
longues gousses de haricots géants. Entre eux, tordus, mutilés, crevassés, avec
les marques de leurs amputations accentuées par la lividité de leurs pansements
mastiqués, deux autres arbres se cachaient, sauvés de la hache qu'eût réclamée
leur vétusté par la beauté de leur floraison : un paulownia aux longues
corolles tubulées d'un mauve vif et un catalpa aux innombrables et fragiles
petites outres blanches, pointillées de pourpre. Par les lourds après-midi de
fin juin, quand toujours quelque orage bourdonne à l'horizon et que
l'atmosphère semble imprégnée d'un silence attentif, des cris, non plus
alanguis, mais véhéments, exaspérés, retentissaient suivant les années de l'un
ou l'autre de ces deux arbres. Mon père disait : « C'est le tire-langue.
Il annonce la pluie. »
Au pied de la colline coiffée de taillis, parmi les
vignes de ses pentes, notre beau jardin, avec ses grands arbres et ses eaux
jaillissantes, formait au-dessus de la plaine, dévorée par la canicule, une
oasis de fraîcheur réconfortante. De superbes espèces exotiques bordaient
l'allée principale : un micocoulier, qui eût abrité un campement sous ses
branches, un sophora tout murmurant d'abeilles, un tulipier de Virginie, un
févier d'Amérique, ceinturé de formidables épines et balançant au vent ses
longues gousses de haricots géants. Entre eux, tordus, mutilés, crevassés, avec
les marques de leurs amputations accentuées par la lividité de leurs pansements
mastiqués, deux autres arbres se cachaient, sauvés de la hache qu'eût réclamée
leur vétusté par la beauté de leur floraison : un paulownia aux longues
corolles tubulées d'un mauve vif et un catalpa aux innombrables et fragiles
petites outres blanches, pointillées de pourpre. Par les lourds après-midi de
fin juin, quand toujours quelque orage bourdonne à l'horizon et que
l'atmosphère semble imprégnée d'un silence attentif, des cris, non plus
alanguis, mais véhéments, exaspérés, retentissaient suivant les années de l'un
ou l'autre de ces deux arbres. Mon père disait : « C'est le tire-langue.
Il annonce la pluie. »