| Accueil > Années 1950 > N°644 Octobre 1950 > Page 587 | Tous droits réservés |

|
Par -10°. |

|
|
Malgré les misères qu'apporte la neige aux malheureux, la gêne qu'elle cause à nos travaux ruraux, j'ai toujours aimé sa parure blanche pour le calme religieux qu'elle met sur la campagne. Combien de souvenirs elle rappelle à l'âme du chasseur, que de belles prises elle évoque, de beaux coups de fusil sur la sauvagine qui nous vient avec le froid ! Il faut les avoir vécus dans l'élément même, la profondeur des sous-bois ouatés devenus le royaume du silence, le long d'un cours d'eau dont le courant est prisonnier de la glace. Pour moi, chasser la sauvagine dans un tel décor est un privilège royal et, depuis que je sers le grand saint Hubert, je n'ai jamais pu contenir ma passion pour l'hiver. C'était il y a six ans. Depuis quelques jours, le temps était au froid vif, sous un ciel de plomb ; une neige épaisse couvrait la terre. Quelques vols de canards avaient paru, traçant sur le ciel sombre leur chapelet tendu. Tout gelait ailleurs, mais les rives boisées de l'Adour et de l'Estèous, avec leurs eaux rapides et vives, attiraient de loin ces vols. Plus d'un avait déjà payé son tribut à ce dangereux repos et je comptais un tableau fort honnête de colverts, souchets, et même un couple de tadornes, ce magnifique gibier, si rare dans ma région. Un jour, après déjeuner, m'arrachant aux délices d'un bon feu malgré l'insistance de ma bonne mère alarmée, je partis vers la rivière familière de mes chasses. À la vitre, le thermomètre marquait -10°. L'Estèous, paresseux et lent à la belle saison, torrentueux l'hiver, offre une multitude de méandres encaissés, blottis au pied des tertres boisés qui l'entourent. Les rameaux le recouvrent parfois et le masquent sur de longs parcours. Aussi les canards le recherchent lorsque le nord glacial souffle avec rage ou lorsque la tempête de neige drape de blanc les vieux troncs rugueux des saules inclinés, fouette silencieusement les épais buissons de ses berges, efface sous son manteau immaculé le détail des ramures courbées au-dessus de l'eau. J'allais sans ambition. Le matin, je n'avais rencontré qu'une cane ; je l'avais tuée. Une bise noire soufflait dans les futaies, lugubre, balayant en tourbillon la neige poudreuse gelée et la précipitait avec un grincement métallique vers l'épaisseur des bordures. Durant mon trajet, quelques vanneaux transis, la tête engoncée dans leurs plumes ébouriffées, avaient imploré ma clémence par leur « Pi ... i ... ouit ! » de détresse. Un vol de corbeaux affamés s'était levé à courte distance, laissant sur la neige la trace de leurs tentatives infructueuses de fouilles d'un sol gelé. Il y a six ans, les munitions étaient trop rares pour que je les use à leur intention. Plus loin, dans le creux d'un ruisselet glacé, une bécassine au vol pénible vient chercher pitance. Partout je lis la souffrance des pauvres bêtes dont, à l'instant, un couple ravissant de bouvreuils semble chanter la litanie plaintive en fuyant au-devant de moi d'un vol saccadé. Le vent fait larmoyer mes paupières et, jusque sous mon cache-nez, vient brûler mes oreilles. Me voici à l'Estèous. Boucle après boucle, les nerfs au guet, j'explore ses méandres. Soudain, à l'un de ses détours, claque un grand fatras d'ailes, un sifflement de fuite précipitée. Une douzaine de colverts viennent de se mettre à l'essor.
L'autre malard, inerte, file toujours sur l'eau d'ébène, où son plastron fait un bel et clair relief. La chance veut qu'un aimable confrère tarbais passe providentiellement sur la rive opposée. Il parvient non sans peine à s'en emparer et me l'expédie par la voie des airs. Sur le remous, l'autre canard semble être un peu « requinqué ». Je tente de l'amener avec une gaule — hélas ! elle est un peu courte — et ne réussis qu'à le voir enfoncer sous l'enchevêtrement des racines. Au fond de cet entrelacs obscur, je vois encore sa tête d'émeraude. Que faire ? L'achever d'un coup de 4 ? je le broierais ; or je ne suis pas un gâcheur et ne goûte aucune joie à ramener un gibier informe. Mon sportif confrère, qui est un peu plus loin, me demande le plaisir de l'opérer lui-même, mais je décline son offre. D'ailleurs, il me faudrait quand même aller l'extraire de sa cachette. Au fond, lorsque l'on va en rivière, où s'offre si souvent la nécessité de finir une pièce, l'on devrait emporter toujours quelques cartouches à demi-charge ; elles suffisent à faire le travail proprement, sans rien gâcher. Je me décide. En un instant, me voici déguisé en « bourgeois de Calais » avec, en moins, « la chemise et la corde, au cou », prêt, non pas à la potence, mais à me lancer dans le bain. Mes pieds nus foulent un beau tapis moelleux de neige, puis de glace épaisse. Brrr ! que c'est donc froid ! J'entre franchement dans l'eau, soudain, ouf ! ... un trou, dans l'eau jusqu'à la poitrine ; j'en ai le souffle coupé et mon collègue d'en face en a, je crois, le frisson ! ... Voici mon canard blotti au plus profond de la souche. Allongeant le bras, je caresse son croupion de velours et le tire à moi. Il ne doit pas aimer les chatouilles ; d'une violente secousse, il m'échappe et plonge au plus profond, sous d'autres remises insondables. Je ne l'ai plus revu et n'en ai conservé comme trophée que deux plumes frisées pour ma boutonnière. En hâte, je sors du bain. Quel supplice ! j'en suis bleu, violet, raidi. Vite, il me faut passer des vêtements eux-mêmes glacés et mes grosses chaussettes de laine servent à frictionner énergiquement mes pieds « sans connaissance ». Enfin, vêtu, chaussé, je me précipite vers la prairie attenante pour une course salutaire et réchauffante. « Quel fou ! » devait penser l'ami tarbais. « Pas tellement ! » puisqu'un instant plus tard, bien réchauffé, je revins sur mes pas, remontant l'Estèous, et, d'un doublé réussi, allongeai deux autres beaux malards, que je n'eus, cette fois, aucune peine à cueillir. Le lendemain, pas le moindre petit rhume ! Si j'ignore quel patron protège les ivrognes, puisse toujours notre grand saint Hubert avoir soin de ses « fous ». H. DEBATS.
|

|
Le Chasseur Français N°644 Octobre 1950 Page 587 |

|

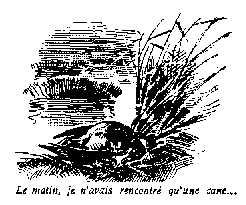 Gêné par les branches, j'ai à peine le temps d'arrêter
net deux malards en un doublé rapide, au passage d'une clairière. J'entends
leur lourde chute dans l'eau, dont le courant rapide les emmène. Vite, je cours
en aval et descends la berge pour les cueillir au passage. Les voici, trop au
large, hors d'atteinte, et pas le temps de couper la moindre gaule. L'un,
désailé, agonisant, le cou allongé, dodeline la tête. Il se laisse ballotter
par l'onde et recrache avec un petit. « Tff ... t, Tff ... t »
l'eau de ses narines. Un remous le saisit et l'arrête à cinq mètres du bord,
sous une souche d'aulnes vives formant îlot.
Gêné par les branches, j'ai à peine le temps d'arrêter
net deux malards en un doublé rapide, au passage d'une clairière. J'entends
leur lourde chute dans l'eau, dont le courant rapide les emmène. Vite, je cours
en aval et descends la berge pour les cueillir au passage. Les voici, trop au
large, hors d'atteinte, et pas le temps de couper la moindre gaule. L'un,
désailé, agonisant, le cou allongé, dodeline la tête. Il se laisse ballotter
par l'onde et recrache avec un petit. « Tff ... t, Tff ... t »
l'eau de ses narines. Un remous le saisit et l'arrête à cinq mètres du bord,
sous une souche d'aulnes vives formant îlot.