| Accueil > Années 1951 > N°649 Mars 1951 > Page 137 | Tous droits réservés |

|
Le tapir |

|
|
Le tapir, connu en Amérique latine sous le nom de gran bestia, se rencontre dans toutes les forêts chaudes et humides du continent américain : je l'ai trouvé dans les forêts de la Cordillère des Andes aussi bien que dans celles du Chaco austral. C'est un animal massif qui, adulte, atteint la taille d'un gros porc. Il est cependant plus élevé sur des pattes robustes. Lorsqu'il a atteint son plein développement, il est de couleur gris-plomb ; mais, durant sa croissance, alors même qu'il est déjà d'une taille imposante, il est tacheté comme un petit cerf. La femelle ne met bas qu'un seul petit.
C'est un herbivore inoffensif dont le salut est dans la fuite. L'épaisseur de son cuir et sa masse lui permettent de foncer dans la forêt la plus épaisse, où il ne peut être suivi que difficilement. En fait, il se tient toujours dans les fourrés les plus touffus, et je ne l'ai jamais rencontré en terrain découvert. Durant l'hiver 1907, mon travail m'avait fixé pour quelques mois dans la région du rio Tapenaga (ligne de la Sabana à Puerto-Barranqueras). Avec un jeune Anglais de mes amis, nous avions projeté une journée de chasse et nous nous étions assuré le concours d'un Indien pourvu de trois chiens habitués à la chasse en forêt. Partis bien avant l'aube, nous avions suivi le lit de la rivière et nous nous trouvions, à l'aurore, à trois ou quatre lieues de nos ranchos. Le nuage de moustiques qui nous suivait couvrait nos montures et nous harcelait sans répit. Le brouillard se condensait sur les herbes, où disparaissaient nos chevaux parfois jusqu'au garrot, sur les arbres aux minuscules petites feuilles et les transformait en autant d'arrosoirs qui déversaient sur nous une eau glacée. Notre premier soin, après avoir dessellé et entravé nos montures, fut d'allumer un bon feu, de nous sécher un peu et de nous préparer un maté bouillant ; puis, machette en main, nous entrâmes dans la forêt. Celle-ci, en cet endroit, était dense, parsemée d'embûches et de plantes épineuses. Nous y avancions lentement. Les empreintes d'animaux étaient nombreuses ; mais nous faisions, malgré toutes nos précautions, beaucoup trop de bruit pour surprendre un gibier. Les chiens, en plusieurs fois, furent aux prises soit avec des fauves, soit avec des cervidés, mais à une telle distance qu'il était impossible de les rejoindre. Nous aurions pu tirer quelques dindes sauvages ; mais mon ami et moi n'avions apporté que notre mousqueton Winchester. Seul l'Indien avait un fusil de chasse. Comme nous lui demandions de tirer sur ces volatiles, il nous avoua que tout son approvisionnement en munitions consistait en quatre cartouches chargées à chevrotines. D'ailleurs, ajouta-t-il, il ne savait pas ce que c'était que de tirer au vol. Lorsqu'il lâchait un coup de fusil, c'était à une distance maximum de dix mètres, et il ne manquait jamais. Nous le crûmes sans difficulté. L'heure du déjeuner arriva sans que nous ayons vu un gibier important. Nous fîmes un feu et nous étions en train de faire griller nos viandes, lorsque les aboiements des chiens, relativement près de nous, nous donnèrent l'assurance qu'ils avaient rencontré. Nous les rejoignîmes aussi rapidement que possible : ils cernaient un fourré épais et obscur. Nous prîmes position derrière chacun d'eux, le doigt sur la gâchette, et attendîmes quelques minutes. Nous ne savions pas ce que nous avions devant nous, et la prudence s'imposait. Enfin l'Indien prit son machette et avança de quelques pas dans le fourré. A ce moment, à la vitesse d'une flèche, deux formes obscures foncèrent dans sa direction, le bousculèrent et le firent rouler comme une quille. La forêt se referma sur elles dans un grand fracas de branches cassées. Aucun de nous n'avait pu tirer. L'homme se releva, étourdi mais sans mal. Nous avions eu à faire à une femelle de tapir accompagnée de son petit. Les chiens les ayant suivis, nous les rattrapâmes un moment plus tard ; ils aboyaient furieusement autour d'une masse épineuse au travers de laquelle nous pouvions maintenant distinguer les raies et les taches claires du jeune tapir, mais la mère n'était plus là. L'indigène nous fit signe de ne pas tirer. Il coupa une branche et, avec cette fourche improvisée, parvint à enfiler la boucle d'un petit lasso de cuir dans une patte de l'animal. Il le tira de son repaire et nous le ligotâmes non sans mal. L'homme nous dit son intention de le ramener vivant. La chose parut difficile, car la bête pesait dans les 60 kilogrammes. Un essai tenté de le mettre sur ses pattes nous fit abandonner l'espoir de le transporter par ses propres moyens : il faisait des bonds dans toutes les directions et aurait entraîné n'importe lequel d'entre nous. Il fallut le fixer à une branche que, à deux, en nous relayant, nous portâmes à l'épaule jusqu'à l'endroit où cuisait notre repas. Mais le plus dur restait à faire : nous avions encore une distance d'une demi-lieue à parcourir dans la forêt pour retrouver nos chevaux. Ce fut d'autant plus pénible qu'avec le brouillard nous demeurâmes plusieurs heures égarés. A la tombée de la nuit seulement nous aperçûmes nos montures. Mon ami et moi devions regagner d'urgence nos chantiers, où notre présence était indispensable ; nous ne pouvions envisager de passer la nuit en forêt à cause de la bête. Nous laissâmes donc à notre guide les provisions qui nous restaient et l'abandonnâmes. Dans l'obscurité totale, nos chevaux, la bride sur le cou, nous amenèrent à nos ranchos au milieu de la nuit. L'Indien et sa prise ne parurent que deux jours plus tard. Nous nous sommes toujours demandé comment l'homme avait pu, tout seul, faire faire à son captif une vingtaine de kilomètres dans une contrée dépourvue de chemin et même de piste. Il vendit son tapir à un de nos collègues. L'animal s'apprivoisa rapidement, partagea avec nos chevaux leurs rations de luzerne et de maïs, puis, quelques mois plus tard, prit le chemin du Zoo de la capitale. Léon VUILLAME. |

|
Le Chasseur Français N°649 Mars 1951 Page 137 |

|

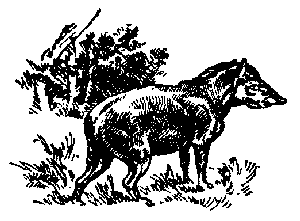 Le nez est très allongé et déborde largement la mâchoire
inférieure comme une courte trompe. Sa peau est dure et peut atteindre un doigt
d'épaisseur sur le dos. Les gauchos en confectionnent des cravaches
recherchées.
Le nez est très allongé et déborde largement la mâchoire
inférieure comme une courte trompe. Sa peau est dure et peut atteindre un doigt
d'épaisseur sur le dos. Les gauchos en confectionnent des cravaches
recherchées.