| Accueil > Années 1951 > N°649 Mars 1951 > Page 190 | Tous droits réservés |
Notes de voyages

|
Dans les îles australes |

|
|
Avec ses cinquante-cinq ans, le matelot Féron était l'homme le plus âgé da bord. Son visage était ridé comme celui d'un vieillard, mais ses yeux vifs et ses réflexes rapides trahissaient une vitalité que quarante années d'une vie pleine de privations et de nuits sans sommeil régulier n’avaient pas réussi à diminuer. J'aimais son calme, quand il répétait les ordres avant de les exécuter, sa conduite exemplaire, son allure disciplinée. Nous ne nous parlions pas bien souvent, mais les quarante années de souvenirs de mer, dont je lui enviais l'expérience, me portaient à le respecter et à entretenir pour lui une secrète sympathie, car j'étais alors jeune élève-officier, et ce voyage-là était le premier que je faisais à travers l'océan Indien. Un soir, en passant sous la tente de la dunette, j'y trouvais Féron assis près d'un fanal et occupé à introduire dans une bouteille un petit voilier, dont les mâts et le gréement étaient rabattus sur le pont pour permettre le passage de l'ensemble dans le goulot. Une fois la petite coque fixée sur du mastic à l'intérieur de la bouteille, il fallait tirer sur un certain nombre de fils judicieusement disposés afin de redresser la mâture et faire prendre au gréement sa position naturelle. C'était un schooner du type de ceux dont se servaient les Américains dans la deuxième moitié du siècle dernier pour chasser la baleine dans les mers australes. Tracé d'une main lourde, avec des lettres un peu trop grosses, le nom de Sea-crow figurait sur les joues de la coque. — Pourquoi lui donnez-vous un nom pareil ? J'avais hésité à poser la question et dus faire un geste car Féron voulut se lever pour répondre. — C'était un baleinier, monsieur, sur lequel j'ai fait une campagne, il y a de ça plus de trente ans. — Un Américain ? — Oui, monsieur, et j'en aime le souvenir. Appuyé contre la barre de secours, ma pipe à la bouche, je sortis ma blague à tabac et la tendis au vieux matelot qui se mit à bourrer la sienne. Le soleil était couché ; à tribord, encore pâle et assez bas, la croix du sud avait fait son apparition dans le ciel tropical. Dans le silence de la nuit, on n'entendait que la bouillonnement de l'eau derrière l'hélice auquel se superposait le bruit périodique de la longue houle de calme plat de l'océan Indien que l'avant du navire refoulait et qui déferlait au large avec régularité. Et voici ce que Féron me raconta alors : — J'avais eu la malchance, à cette époque-là, d'être embarqué sur un trois-mâts de la maison Bordes de Nantes dont le capitaine était un homme violent et vindicatif. Bien longtemps avant l'arrivée au cap Horn, la vie était devenue pour quelques-uns parmi nous un véritable enfer. Pendant les trois semaines où nous dûmes louvoyer là-bas pour gagner dans l'Ouest, je fus impliqué personnellement à plusieurs reprises dans des affaires fomentées par d'autres et le tort qu'on me fit était, à mon avis, si cruel, que je pris la décision de déserter à la première occasion ce navire qui, alors, était devenu à mes yeux un bagne flottant. » Deux mois plus tard, ayant trouvé des complices, je réussis à le quitter à Iquique, dans la nuit qui précédait son départ, et, me tenant d'abord caché dans les environs de la ville, gagnai ensuite l'intérieur, où je vécus pendant quelques mois en travaillant dans les mines de salpêtre. Mais ce n'était pas là une vie qui pouvait me plaire. Je retournai à Iquique, et, n'osant pas encore embarquer sur un voilier français a cause de la faute que j’avais commise, je me présentai au capitaine du Sea-crow, dont le navire était sur rade, et qui m'embarqua séance tenante sans poser sur mon passé des questions trop indiscrètes. » Le Sea-crow était un baleinier américain de New-Bedford, qui avait pris la mer depuis dix-huit mois. Il faut que vous sachiez que les campagnes de ces navires-là duraient parfois trois ou quatre années, car leurs capitaines se piquaient de ne rentrer à leur port d'attache qu'avec un chargement complet. II arrivait qu'à bout de vivres ils relâchaient dans les ports australiens pour y échanger une partie du produit de leur chasse contre des vivres frais afin de pouvoir encore faire durer la campagne. Pour une fois, mon étoile m'avait été favorable, car j'étais tombé sur un bon navire. Cependant, comme sur tous les baleiniers de 1’époque, on souffrait de l'éternelle absence de vivres frais, et des conséquences que cela entraîne pour la santé de l’équipage quand l'inévitable scorbut fait son apparition. Aussi une distribution parcimonieuse de vivres frais a pu avoir lieu pendant mes premières semaines à bord, elle cessa complètement ensuite, et l'équipage, déjà affaibli par la longueur de la campagne, s'en ressentit presque aussitôt. » Et pourtant la campagne était bonne. Quinze jours à peine après notre départ, une nombreuse troupe de cachalots était signalée, dans laquelle nous pûmes faire du bon travail. J'étais rameur dans une embarcation qui harponnait ; le métier était nouveau pour moi, et vous savez que, quand on est jeune, on aime les choses dangereuses. Retardés par nos prises, nous perdions les bêtes de vue pendant des jours et des jours, mais le capitaine avait un flair spécial et, ayant repéré la direction générale de leur route, les retrouvait toujours. Elles nous entraînaient de plus en plus loin vers le sud de l'Australie et ensuite vers l'ouest. » Les semaines et les mois passèrent. Finalement quatre mois s'étaient écoulés depuis notre départ du Chili. Toutes nos barriques étaient pleines d'huile ; aucun des matelots du bord ne se rappelait avoir participé à une poursuite aussi continue et aussi fructueuse. » Quatre mois sans voir la terre, monsieur ! » Les barriques étaient pleines, c'est un fait, mais le scorbut avait réduit l'équipage à un troupeau de moribonds qui se traînait lamentablement sur le pont. Seuls les plus forts étaient encore capables de monter dans le gréement. Et alors, depuis des semaines, le temps avait changé : il faisait froid et la brise d'ouest nous obligeait de louvoyer jour et nuit. Depuis un bon moment il y avait des murmures dans le poste, où chacun se demandait ce que le capitaine attendait pour virer de bord. Le calme revint pourtant parmi nous quand le second nous eut dit que nous étions à des milliers de milles du port le plus proche et que le capitaine cherchait à atteindre les Kerguélen, seul moyen qui lui restait pour sauver son équipage et avec lui le navire. D’ailleurs, nous ne tardions pas de voir à la manœuvre que nous en approchions : la nuit, en effet, le capitaine fit mettre en panne et le jour on louvoyait avec des vigies doublés. » Alors, par une matinée froide et bruineuse, on aperçut un instant la terre entre deux bouchons de brume. C'étaient de hauts promontoires gris et dénudés avec des traînées de neige dont les sommets s'enfonçaient à faible altitude dans de sombres nuages. Aussitôt on fit des manœuvres pour virer de bord. Vers le soir on devait être entre deux îles, car le vent faiblit et devint irrégulier ; la terre apparut encore à plusieurs reprises, toujours les mêmes parois rocheuses et noires sortant presque à pic de la mer, qui se brisait contre elles avec une puissance redoutable. A l'approche de la nuit, nous dûmes encore reprendre le large. Ce n'est que 1e soir du lendemain que le capitaine, malgré la mauvaise visibilité, réussit à nous faire entrer dans une baie abritée où nous pouvions enfin jeter l'ancre. Il était alors grand temps, car les plus faibles parmi nous se trouvaient dans un état de prostration extrême. » Le lendemain, le second se rendit à terre avec une équipe d'hommes valides, dont je fis partie. Nous trouvions une plage de galets noirs et, lentement, car nous étions affaiblis, nous suivions l'officier, qui nous mena à travers de pauvres prés vers un plateau situé à faible altitude et limité à l'ouest par une chaîne de montagnes neigeuses. Ici le second nous désigna des plantes à tiges plus ou moins courtes et épaisses, dont les feuilles étaient pareilles à celles des choux de France. Il se mit à en manger cru, et nous l'imitions sans perdre un mot. C’était ce qu'on appelle du chou de Kerguélen. Nous en remplissions des sacs pour la cuisine du bord, où le cuisinier en fit une soupe, puis des purées. On ne mangeait plus que de cela. Tous les jours les provisions furent renouvelées, et l'état de santé de l’équipage s'améliorait à vue d'œil. Nous étions sauvés. Trois semaines plus tard, nous quittâmes les Kerguélen. Le vent d'ouest durait encore et, après une courte escale à Port-Hobart, nous fîmes une traversée sans incidents, par le cap Horn jusqu'à New Bedford, où le Sea-crow fut désarmé ... » Le vieux Féron, ayant terminé son récit, ne se doutait certainement pas qu'il avait éveillé mon intérêt pour le genre de végétation susceptible d'être rencontré dans un archipel aussi éloigné des continents que le sont les Kerguélen.
Nous avons vu que ses feuilles sont comestibles, même à l'état cru. Elles sont charnues, plus larges au sommet qu'à la tige, et forment sur les jeunes plantes des rosettes, soulevées peu à peu par l'apparition d'une tige, qui prend à l'âge adulte une consistance épaisse et ligneuse, comme un véritable tronc d'arbre court et trapu. C'est alors que les fleurs apparaissent. Elles se trouvent groupées dans la forme de longues grappes redressées et assez voyantes et donnent naissance à autant de siliques dont les graines, une fois mûries, sont éparpillées par le vent. Actuellement le chou de Kerguélen ne se rencontre plus qu'aux altitudes de 400 à 600 mètres, où il a toujours été très abondant, tandis que, dans la région du littoral, il a disparu à la suite de l'introduction dans les îles de lapins. Rappelons, pour finir, qu'on tient la preuve, par les nombreux débris d'arbres à l'état fossile trouvés dans les îles, qu'à une époque lointaine le grand plateau immergé, dont notre archipel, avec les îles du Prince-Édouard et les îles Crozet, constitue le point le plus élevé, était couvert de vastes forêts. Sans doute luxuriante et peut-être tropicale, cette végétation, en tant qu'elle n'a pas disparu par immersion, a été détruite au courant des âges par l'action volcanique et par des périodes glaciaires. René-R.-J. ROHR,Capitaine au long cours. |

|
Le Chasseur Français N°649 Mars 1951 Page 190 |

|

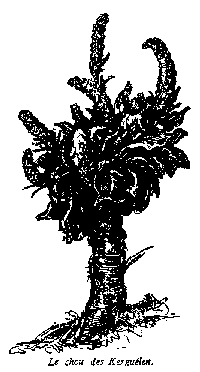 J'avais entendu parler, en effet, de la théorie de Wegener
sur les déplacements des continents, suivant laquelle les îles australes de
l'océan Indien auraient été essaimées par la pointe méridionale de l'Amérique
du Sud pendant sa lente course vers l'ouest avant de subir, par de nouvelles
influences, d'autres mouvements qui leur sont propres. Et, effectivement, la
flore des Kerguélen a des affinités avec celle de ce continent et est, par
contre, très étrangère aux flores du Cap et de l'Australie, pays dont
l'archipel est à peu près équidistant et, à notre époque, beaucoup plus proche
que de l'Amérique méridionale. Ainsi le genre Acaena, de la famille des
rosacées, qui se rencontre aux Indes, est représenté aux Kerguélen par l'espèce
Acaena affinis, sans avoir de cousins dans les terres voisines. En
dehors de mousses et de lichens, espèces arctiques et antarctiques par
excellence, il n'y existe d'ailleurs que dix-huit espèces de phanérogames où
plantes à fleurs, dont la plus apparente, la plus intéressante aussi, est notre
chou de Kerguélen, aux propriétés bienfaisantes, qui lui ont fait donner le nom
scientifique de Pringlea antiscorbutica et ont valu aux Kerguélen
d'innombrables visites de baleiniers dès le milieu du XIXe siècle. C'est une
crucifère, seule espèce du genre Pringlea, très évoluée pour s'adapter à
son habitat éternellement exposé aux violents vents froids de l'Antarctique et
très peu favorables au développement d'une vie végétale intense. Sang doute lui
a-t-il fallu pour cela les nombreux milliers ou centaines de milliers d'années
qui se sont écoulées depuis la séparation de l'archipel des Kerguélen du
continent américain.
J'avais entendu parler, en effet, de la théorie de Wegener
sur les déplacements des continents, suivant laquelle les îles australes de
l'océan Indien auraient été essaimées par la pointe méridionale de l'Amérique
du Sud pendant sa lente course vers l'ouest avant de subir, par de nouvelles
influences, d'autres mouvements qui leur sont propres. Et, effectivement, la
flore des Kerguélen a des affinités avec celle de ce continent et est, par
contre, très étrangère aux flores du Cap et de l'Australie, pays dont
l'archipel est à peu près équidistant et, à notre époque, beaucoup plus proche
que de l'Amérique méridionale. Ainsi le genre Acaena, de la famille des
rosacées, qui se rencontre aux Indes, est représenté aux Kerguélen par l'espèce
Acaena affinis, sans avoir de cousins dans les terres voisines. En
dehors de mousses et de lichens, espèces arctiques et antarctiques par
excellence, il n'y existe d'ailleurs que dix-huit espèces de phanérogames où
plantes à fleurs, dont la plus apparente, la plus intéressante aussi, est notre
chou de Kerguélen, aux propriétés bienfaisantes, qui lui ont fait donner le nom
scientifique de Pringlea antiscorbutica et ont valu aux Kerguélen
d'innombrables visites de baleiniers dès le milieu du XIXe siècle. C'est une
crucifère, seule espèce du genre Pringlea, très évoluée pour s'adapter à
son habitat éternellement exposé aux violents vents froids de l'Antarctique et
très peu favorables au développement d'une vie végétale intense. Sang doute lui
a-t-il fallu pour cela les nombreux milliers ou centaines de milliers d'années
qui se sont écoulées depuis la séparation de l'archipel des Kerguélen du
continent américain.