| Accueil > Années 1951 > N°655 Septembre 1951 > Page 519 | Tous droits réservés |

|
Après-midi de Noël |

|
|
De temps en temps, nous nous regardons, d'un air complice et entendu. Puis l'un de nous s'enhardit : « On y va ? » Cela a été dit en sourdine ; assez haut, tout de même, pour qu'on puisse l'entendre autour de nous. Nous jetons un coup d'œil furtif du côté de ces dames : aucune réaction. Elles paraissent n'avoir pas entendu. On soulève, une fois encore, le rideau. Quel temps ! Alors l'un de nous s'approche : — Tout de même, vous ne voulez pas rester là jusqu'à ce soir ? Ça ne vous dit rien d'aller au cinéma ? Cette fois, on a compris. — Oui, oui, allez ; vous croyez qu'on ne voit pas votre manège depuis un moment ? Pas tant de simagrées, fichez le camp. — Oh ! nous ne resterons pas longtemps. Rien qu'un petit tour, le temps de vous tuer un canard. Nous ne ferons même pas la passée. — Il faut bien être fous, tout de même, avec un temps pareil ! Enfin, si ça vous amuse ... Nous nous sommes précipités hors de la salle à manger où nous entendons nos « gouvernements » (comme dit Alphonse, le commis du percepteur, en parlant de son épouse) nous lancer, pour finir : — Regardez-les. On dirait deux gosses à qui on a donné la liberté d'aller jouer. Drôles de gosses, en vérité, dont l'un, bien déplumé, et l'autre, déjà blanchi, ont fait tous deux 14-18, ayant connu Yser, Somme, Verdun, Lorraine et autres lieux qui eurent, un temps, une mondiale renommée ; noms bien oubliés, hélas ! aujourd'hui, sauf de ceux qui y vécurent de dures années de jeunesse ou d'âge mûr ou qui y ont laissé quelque être cher. — Dépêchez-vous. Le temps de me préparer et de sortir la voiture et je vous prends, en passant, avant dix minutes. Je fonce vers la sortie. Sur le seuil, la bourrasque, impitoyable, m'arrête, me coupant le souffle. Vraiment, il fait mauvais. Je pars à la course vers la maison. Cent cinquante mètres à peine ; je grimpe l'escalier et enfonce la porte, bousculant mon chien qui bondit après moi.
Mais il a vu mes préparatifs. Alors il dédaigne son plat et va prendre la faction à la porte, frétillant de son moignon de queue. J'insiste : — Allons, va manger ta soupe. Il s'aplatit, têtu, l'air suppliant. Il craint que je le laisse là, lui ayant déjà joué le tour une ou deux fois où une raison quelconque, mais incompréhensible pour lui, m'empêchait de l'emmener. Tant pis, il mangera mieux ce soir ; nous n'avons pas de temps à perdre. Déjà, la voiture est en bas. Et l'on démarre. — Quel temps, quand même, dites. Elles ont bien un peu raison quand elles disent qu'il faut être fous. Dès la sortie de la ville, on passe tout juste. S'il avait neigé encore une heure ou deux, avec ce vent, c'était bouché sur deux cents mètres. Là-bas, la plaine déserte est ensevelie sous l'épaisse couche blanche, coupée seulement par la ligne noire du fleuve qui s'étire et, tout au fond, dans une vague brume fumeuse, par les bouquets d'arbres du marais. On ne peut aller vite, car il n'y a pas de trace faite. Personne n'est encore passé. Voici le pont ; la Loire, large, s'écoule vers le fond de la plaine, charriant, déjà, quelques glaçons. Demain, elle sera à moitié prise. Nous continuons, traversons le bourg, prenant ensuite la route du marais. Enfin, on y est. En chasse. Il faut se hâter, car il est déjà trois heures et le ciel est bas ; la nuit sera vite là, ce soir. Les chiens sont lâchés et commencent à barboter dans les joncs, les boutasses et les touffes d'osiers. Rien, on ne voit rien ; sauf des chasseurs. Le marais, battu et rebattu depuis ce matin, doit être vide. Il faudrait rester tard, attendre la passée du soir, jusqu'à la nuit noire où les canards reviendront. Pourquoi donc, dans notre ivresse de partir, avons-nous promis de ne pas rester ? Enfin, on suit les bords dans l'espoir de lever quelque poule d'eau. Mais en vain ; même aux endroits favoris, nos chiens n'en trouvent pas. Nous remontons le petit bras qui descend des pins. Il y a un joli tournant, à l'abri d'un talus, où poussent cressons en abondance et où se remet, souvent, quelque isolé pourchassé. Mais, avant que nous y arrivions, nous voyons approcher, dressée sur le talus, une silhouette que nous reconnaissons aussitôt : c'est le docteur, avec sa peau de bique, sa barbe et sa pipe. Nous nous arrêtons. Inutile d'aller plus loin puisqu'il fait, en sens inverse, le trajet que nous voulions faire. Attendons-le. Soudain, devant lui, mais hors de portée de son fusil, deux canards se lèvent. Nous nous accroupissons aussitôt dans la neige. Ils descendent vers nous. — Attention, hein ! chacun le nôtre. Oh ! comme ils viennent bien ! Pourvu qu'ils ne dévient pas. Juste au moment où ils vont me dépasser, j'ajuste le premier qui descend comme une masse, disloqué, et tombe à quelques mètres derrière, faisant son trou dans la neige épaisse. C'est une cane. — A vous l'autre ! Pan ! Pan ! Mon compagnon reste là, debout, médusé, regardant filer le beau mâle dont on a bien vu les couleurs du plumage. Bon sang ! si j'avais su, j'aurais bien doublé sur lui ! Mais je m'attendais tellement à lui voir subir le même sort que le mien, car mon compagnon sait mettre droit, à l'occasion. Dommage. Les deux seuls canards qui se trouvaient encore dans le marais et qu'on pouvait, qu'on devait avoir tous les deux ! Déjà le docteur arrive ; nous lui devinons un petit air vexé de ne les avoir pu tirer et de nous les avoir si bien envoyés. C'est moi qu'il interpelle, car, de là-haut, il a vu le coup : — Toujours les mêmes, alors ? Veinard ! Avouez qu'il ne vous a pas coûté beaucoup de peine celui-là. Nous bavardons un moment. Puis nous repartons, mon compagnon et moi, dans l'espoir de retrouver le rescapé. Je reste par là ; lui, va faire les trous des gravières où l'oiseau s'est peut-être remis. Mais mon chien, mouillé, grelotte de rester en place ; moi je ne sens plus mes pieds. Alors je repars le long du ruisseau pour me donner un peu de mouvement et avoir moins froid. Soudain, arrêt : une grosse touffe de joncs est là, au ras de la berge. Je pense à une poule. — Allez, Duc ! Le chien plonge dans la touffe, barbote un peu, puis en ressort, tenant dans sa gueule une sarcelle désailée, un mâle. Une bonne surprise. Le ciel est de plus en plus noir et chargé, la sibère toujours aussi froide. A présent, j'ai hâte de voir arriver mon compagnon pour regagner le logis avant la nuit, car il serait trop dur de partir au meilleur moment. Aucun coup de feu n'a retenti sur le marais depuis qu'il m'a quitté. Gelés, des chasseurs passent, emmitouflés, la tête dans les épaules, les mains aux poches. — Il n'y a rien, on s'en va. D'autres, au contraire, les durs, arrivent pour là passée. Ceux-là verront du gibier tout à l'heure. Ah ! voici l'ami. — Alors, on part ? Je ne sais pas où il est passé, ce bougre de colvert ! Impossible de le relever. Vous n'avez rien vu ? Je lui montre la sarcelle. Il s'étonne, ne m'ayant point entendu tirer. Alors je le mets au courant de la trouvaille. Mais où est mon chien ? Nous attendons un instant. Puis je lance quelques coups de sifflet. Et nous le voyons arriver, au grand galop, tout en haut du talus que suivait, tout à l'heure, le docteur. Il a quelque chose à la gueule. — Qu'est-ce qu'il a trouvé encore ? En quelques bonds le voici près de nous et posant à mes pieds une autre sarcelle, encore raide, probablement tuée du matin. Nous le caressons comme il le mérite. Brave chien ! — Vous avez là, tout de même, une fameuse bête, me dit mon compagnon de chasse. ... Vous en souvenez-vous, dites, ami G ..., de cette après-midi de Noël ? FRIMAIRE. |

|
Le Chasseur Français N°655 Septembre 1951 Page 519 |

|

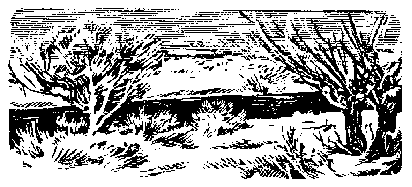 Il y a déjà un bon moment que le repas est terminé. Ces
dames et demoiselles bavardent, les enfants tournent en criant. Nous deux, nous
nous sommes levés, silencieux, allant et venant comme deux ours en cage. Puis
nous allons lever les rideaux « pour voir le temps », collant le nez
aux carreaux. Un vrai temps de Noël. La neige, toute la nuit et toute la
matinée, n'a pas cessé de tomber, tourbillonnant dans le vent. A présent, la
blanche tourmente a cessé. Seule la bise, forte et âpre, continue de souffler,
balayant la rue et formant une épaisse congère en face, le long du mur.
Il y a déjà un bon moment que le repas est terminé. Ces
dames et demoiselles bavardent, les enfants tournent en criant. Nous deux, nous
nous sommes levés, silencieux, allant et venant comme deux ours en cage. Puis
nous allons lever les rideaux « pour voir le temps », collant le nez
aux carreaux. Un vrai temps de Noël. La neige, toute la nuit et toute la
matinée, n'a pas cessé de tomber, tourbillonnant dans le vent. A présent, la
blanche tourmente a cessé. Seule la bise, forte et âpre, continue de souffler,
balayant la rue et formant une épaisse congère en face, le long du mur.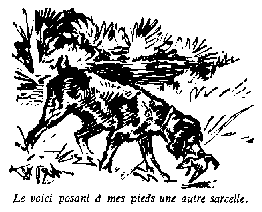 —Tiens, vieux, voilà ta soupe ; mange.
—Tiens, vieux, voilà ta soupe ; mange.