| Accueil > Années 1952 > N°659 Janvier 1952 > Page 62 | Tous droits réservés |
Au temps jadis

|
Gentilshommes campagnards |

|
|
Leur domesticité est modeste, mais prend part à toutes les joies ou les peines du foyer. Au milieu du XVIe siècle, le bon sire de Gouberville, aux environs de Cherbourg, consigne sur ses registres les moindres événements de la journée : il y fait une large part à ses valets. Il nous conte qu'un jour la pluie ayant « rachassé ses gens » et les ayant forcés de se mettre à l'abri sous le manteau de la vaste cheminée, il « leur lut toute la vesprée Amadis de Gaule », vieux roman de cape et d'épée qui devait passionner ces braves gens. En son manoir du Mesnil-au-Val, Gouberville se penche avec bonté sur ses serviteurs ou ses filles de cuisine, sans aucune morgue, sans préjugé de classe. Certes, il a parfois la main leste et il châtie rudement ceux qu'il aime ; il en est quitte, le soir, pour inscrire sur son carnet les coups donnés à tel ou tel : « Je battis Cantepye au matin parce qu'il avait battu Raoul. » Les jeunes laquais sont fouettés ; ce sont là mœurs du temps. Mais, en revanche, sa charité est inépuisable, il donne quelque argent à un valet pour lui permettre d'envoyer son fils à l'école, il distribue des médicaments, des aumônes. Ces « gens de maison » sont le plus souvent de petits villageois, et leur gaucherie fait rire à gorge déployée les poètes parisiens qui se moquent de leurs manières. Un écrivain du XVIIe siècle décrit ainsi le maître d'hôtel d'un hobereau :
La scène est un peu poussée à la caricature, mais cependant les notes en sont exactes ; ces gentilshommes campagnards n'ont pas le moyen d'entretenir une importante domesticité. La demeure féodale, dont le revenu est insignifiant et n'a pas été « revalorisé », écrase littéralement le seigneur. À la veille de la Révolution, la maison du père de Chateaubriand n'est pas non plus très luxueuse. Dans ses Mémoires, le grand écrivain a évoqué cette période de sa triste enfance : « Une cuisinière, une femme de chambre, deux laquais et un cocher composaient tout le domestique ; un chien de chasse et deux vieilles juments étaient retranchés dans un coin de l'écurie. Ces douze êtres vivants disparaissaient dans un manoir où l'on aurait à peine aperçu cent chevaliers, leurs dames, leurs écuyers, leurs varlets, les destriers et la meute du roi Dagobert. » De son côté, le marquis de Mirabeau rapporte que son trisaïeul se contentait « de quelque palefrenier hérissé, d'un page fréquemment sans culotte, quoique son cousin, d'une demoiselle laborieuse et de quelques petits garçons ». Ces valets d'ailleurs avaient à entretenir un manoir délabré, aux murs croulants, aux pièces immenses, mais chichement meublées. Dans le livret d'un ballet donné au Palais-Royal, en 1665, et dans lequel figure le roi Louis XIV en personne, nous pouvons lire : « La scène représente une de ces maisons de campagne qu'on nomme noblesses ou gentilhommières, composée d'un corps de logis découvert, d'une petite tour ruinée, d'une grange en mauvais ordre et d'une cour où paraissent quelques poulets dindes, des lévriers maigres et des bassets. » Les documents du temps confirment d'ailleurs en partie cette satire. Un seigneur picard ne possède,en 1617, qu'une table et deux chaises dans sa chambre, sa vaisselle est entièrement en étain et son argenterie se compose uniquement de trois cuillers, d'une salière et d'un gobelet ! Le plus souvent M. le comte est moins bien logé que ses riches fermiers. Il est vêtu de toile comme un moulin à vent et il traîne à travers champs et guérets des guenilles dignes d'un épouvantail à moineaux. L'un avoue qu'il est « botté à cru », un autre qu'il n'a que des guêtres. Mais ils aiment les costumes solides, d'usage, comme on dit. Cette tradition se conserva longtemps. Pierre de Vaissières, qui a écrit sur les Gentilshommes campagnards de l'ancienne France un livre aussi érudit que délicieux, me contait, il y a quelques années, une amusante anecdote. Un de ses grands-pères, noble auvergnat du siècle dernier, avait fait l'emplette de quelques aunes de drap de billard et le digne homme, pendant toute sa vie, visita ses terres sa noble bedaine serrée dans cette étoffe verte et inusable ! Une des principales distractions de ces campagnards est la chasse. Buffon définit ainsi le hobereau : « Un gentilhomme à lièvre qui va chasser chez ses voisins sans en être prié et qui chasse moins pour son plaisir que pour son profit. » Garaby de la Luzerne, un obscur poète du XVIIe siècle, mettant en scène un de ces châtelains de village, nous le montre discutant avec un de ses cousins et s'enquérant des qualités de ses chiens :
et il conclut ainsi :
Déjà, au XVIe siècle, le journal du sire de Gouberville nous avait appris que celui-ci était un passionné du sport de saint Hubert ; il possédait un véritable arsenal et une meute d'une certaine importance avec laquelle il traquait loups, renards ou cerfs. On se recevait alors beaucoup entre familles voisines ; au moindre prétexte, une trentaine de personnes s'installaient au manoir. On tuait une partie de la basse-cour et l'on faisait tout de même, en dépit de la pauvreté du maître de logis, quelques bons repas. Malgré leur dénuement, ces gentilshommes aimaient inviter leurs amis ; certains livres de raison contiennent de longues listes de dîners ! Les écrivains satiriques ont fait des gorges chaudes de ces divertissements ; leurs poèmes, fort drôles, peuvent paraître quelque peu outrés, cependant leur véracité est confirmée par des auteurs sérieux tels que Bussy-Rabutin. Un jour, celui-ci arriva en pleine nuit dans un manoir du Bourbonnais. On le reçut dans une salle basse où il manqua tomber, car le sol était veuf de la plupart de ses carreaux. La maîtresse de maison le fit asseoir sur de mauvaises chaises devant une cheminée sans feu. Pendant ce temps, des domestiques allèrent abattre des arbres pour faire une flambée. Un quart d'heure plus tard, des valets d'écurie charrièrent des bûches couvertes de neige et une botte de paille mouillée qu'une servante essaya en vain d'allumer. À ce moment, Bussy crut périr étouffé par la fumée. Enfin, le peu de chaleur qui se dégagea fit fondre la neige qui couvrait le bois, si bien qu'une mare vint vite mouiller les pieds du visiteur. « Enfin, écrit-il, on apporta le souper qui fut aussi méchant que le feu : les potages n'étoient que de l'eau bouillie ; de toute la viande qu'on servit, il n'y avoit rien qui ne fût vivant quand nous étions arrivés ; le pain étoit frais et n'étoit pas cuit, le vin étoit aigre et trouble, le linge n'étoit pas seulement humide, il étoit mouillé, et la chaleur des potages faisoit fumer la nappe. Ce nuage acheva de nous ôter le peu de lumière que rendoit une petite chandelle de vingt-quatre à la livre. » Lorsque le hobereau ne traitait pas ses parents, il prenait part fréquemment aux réjouissances de ses fermiers ou des habitants du hameau. Les textes du XVIe siècle font souvent allusion à des seigneurs de village jouant à la boule ou à la paume avec leurs sujets. Quelquefois M. le vicomte revient au château les habits déchirés, mais il a passé une bonne journée. Le dimanche est un grand jour pour ces « nobliaux » ; ils se rendent à la messe en grande pompe où le curé doit les recevoir suivant des rites prescrits. Le seigneur va droit à sa place, marquée de son blason peint :
il attend que le prêtre lui offre l'eau bénite, geste simple, mais qui donna matière à maints procès, certains ecclésiastiques refusant avec obstination de se soumettre à ce droit féodal. L'un d'eux même, un beau jour, mit dans le seau à eau bénite une magnifique queue de renard en guise de goupillon et arrosa largement son châtelain qui dut, fort penaud, aller se changer ! Mais ces petits côtés burlesques d'une paisible existence ne doivent pas nous faire oublier que les gentilshommes ruraux d'autrefois étaient, en général, bien vus de leurs paysans. Cette noblesse s'intéressa toujours à la terre, elle sut même adopter la première certaines innovations dans sa culture ; enfin, lorsque la patrie était en danger, le pauvre hobereau prenait sa vieille rapière pendue au manteau de la cheminée et, après avoir enfourché un maigre bidet, partait vers la frontière pour combattre les ennemis de la France. Roger VAULTIER. |

|
Le Chasseur Français N°659 Janvier 1952 Page 62 |

|

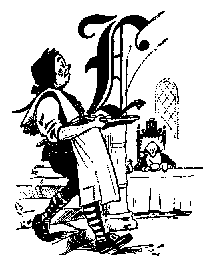 e gentilhomme campagnard au XVIe siècle et
sous l'ancien régime est, en général, peu fortuné. Il vit sur ses terres, car
il ne peut s'offrir le luxe de parader à la cour ; parfois ancien
officier, il s'est retiré au manoir ancestral, pourvu de cicatrices, de
rhumatismes, mais rarement d'une bonne pension de retraite. Il partage
l'existence des paysans, ne dédaigne pas de travailler aux champs et de
s'intéresser aux questions agricoles. Il lit les traités d'Olivier de Serres et
consulte la lune pour ses plantations. Le soir, à la veillée, il rédige son
livre de raison qui, ainsi que quelques autres documents, nous permet d'évoquer
ces hommes d'autrefois dont l'attachement à la glèbe mérite bien notre estime.
e gentilhomme campagnard au XVIe siècle et
sous l'ancien régime est, en général, peu fortuné. Il vit sur ses terres, car
il ne peut s'offrir le luxe de parader à la cour ; parfois ancien
officier, il s'est retiré au manoir ancestral, pourvu de cicatrices, de
rhumatismes, mais rarement d'une bonne pension de retraite. Il partage
l'existence des paysans, ne dédaigne pas de travailler aux champs et de
s'intéresser aux questions agricoles. Il lit les traités d'Olivier de Serres et
consulte la lune pour ses plantations. Le soir, à la veillée, il rédige son
livre de raison qui, ainsi que quelques autres documents, nous permet d'évoquer
ces hommes d'autrefois dont l'attachement à la glèbe mérite bien notre estime.