| Accueil > Années 1952 > N°660 Février 1952 > Page 73 | Tous droits réservés |

|
Le col-vert |

|
|
J'avais attrapé, en voyage, une mauvaise grippe, et je me laissais soigner, gâter, dorloter. Vieille fille, ma tante avait, pour le dernier de ses neveux, du reste largement sexagénaire, le secret de ces attentions, de ces petits soins que je ne retrouverai nulle part ailleurs. Le déjeuner venait de se terminer et j'écoutais au coin du feu ma tante, à l'extraordinaire mémoire, conter ses souvenirs du bon vieux temps et parler des chers disparus. C'était le 13 décembre 1948, j'ai de très bonnes raisons pour ne jamais oublier cette froide et belle soirée d'hiver. Quant à moi, je pestais contre cette maudite grippe qui me retenait à la maison alors que la campagne, avec sa neige et ses arbres givrés, était si belle et qu'au loin, dans la direction de la rivière, claquaient les coups de fusil. Soudain, le grincement de la porte de fer du jardin, suivi du bruit assourdi de pas dans la neige, nous fit taire l'une et l'autre : L. M ..., notre voisin, le plus fin pêcheur et le plus intrépide chasseur de l'endroit, apparut, le fusil sur l'épaule. Il venait voir si j'étais décidé à faire avec lui une petite promenade en barque : il y avait du canard, disait-il, et il ne fallait pas trop tarder, car la nuit serait vite venue. Ma bonne tante, avant même que je ne répondisse, savait parfaitement que je serais, même à demi mort, incapable de résister à une pareille tentation. Elle leva les bras, désespérée, invoquant tous les saints du Ciel, nous assurant que nous étions parfaitement fous de sortir par un temps et un froid pareils et que, et ceci me visait tout particulièrement, je ne devais plus compter sur elle pour être soigné. Je la calmai de mon mieux, lui promettant, foi de chasseur, que nous serions de retour avant la nuit. Cinq minutes plus tard, coupant à travers champs, enfonçant dans la neige jusqu'au milieu des bottes, la figure cinglée par une bise glaciale, nous nous hâtions vers le Doubs, distant d'une demi-lieue. La rivière était débordée, les gros froids étaient survenus brusquement. L'eau s'étendait à perte de vue, bordée, près du sol, de larges collerettes de glace. Les saules des rives et des îles, en partie submergés, laissaient pendre vers l'onde leurs branches chargées de givre que balançait la brise dans un décor de féerie. Quelques vols de canards et de sarcelles passaient hauts et rapides vers le sud. Nous arrivâmes enfin vers notre barque, qu'il fallut vider de sa neige et de ses glaçons, laissant les planches glissantes et boueuses. Nous y prîmes notre place habituelle ; nous avions, en effet, à bord une fonction bien déterminée : l'ami L. M ..., expert dans la manoeuvre de la gaffe et pilote éprouvé, exerçait ses talents à l'arrière, se réservant en outre le droit d'appréciation sur les coups de son adjoint. Or le pilote n'était pas toujours tendre lorsqu'il advenait un coup malheureux. À l'avant, debout, en équilibre instable, le doigt plus ou moins gelé sur la gâchette, j'étais chargé du tir, avec tout ce que cela comportait de responsabilité. Nous allions aborder le fond d'une « morte » (1), lorsqu'un col-vert partit des roseaux ; à belle distance, j'eus la chance de le descendre. Il tomba au loin sur la terre ferme. Mon compagnon, plus jeune et plus leste que moi-même, l'attrapa alors qu'avec une aile cassée il allait atteindre l'eau. Il prit place dans mon carnier, et nous continuâmes notre randonnée, visitant les recoins cachés par la végétation. Nous dérivions par une série de mortes jusque vers les Pantières, où nous pensions rester à l'affût. Dans l'ombre du soir, le « floc » rythmé de la gaffe troublait seul le silence. Des branches chargées de givre, près desquelles nous passions, m'obligeaient à de fréquentes flexions pour les éviter. Que se passa-t-il alors ? Je ne saurais l'expliquer : un coup de gaffe plus violent accusa-t-il le balancement provoqué par mon geste pour éviter une branche de saule ? C'est vraisemblable. Je glissai, perdis l'équilibre et basculai par quelques mètres de fond, non sans percevoir, en tombant, le formidable juron du pilote. J'ai toujours pensé que le col-vert que j'avais dans le dos avait fait office de ceinture de sauvetage. En effet, je remontai comme un bouchon, mon fusil serré dans ma main gauche, celle de droite s'agrippant au bord de la barque, où mon compagnon m'aida à me hisser. Celui-ci était furieux, non pas tant, je suppose, à cause de mon accident, mais parce que maintenant la chasse et surtout l'affût étaient manqués. Quant à moi, pour me trouver hors de l'eau, je n'en étais pas pour cela hors d'affaire. Nous étions dans une barque, loin du village, et le froid commençait à m'envahir. Nous avions encore un long parcours à faire avant de sortir de la rivière. Au bout d'un temps qui me parut fort long, nos appels furent cependant entendus par un groupe de camarades chasseurs qui, dans la journée, avaient coupé du bois dans une île voisine. Ils avaient fait du feu pour leur repas de midi, et les braises étaient encore chaudes. Quelques instants plus tard, nu comme un ver, les pieds sur le sol gelé, j'attendais que mes vêtements veuillent bien sécher devant les flammes qu'entretenaient d'énormes fagots.
Mon linge un peu brûlé, mais sec, je n'attendis pas davantage ; j'enfilai le tout, les vêtements de laine n'étant guère moins mouillés que lorsque j'étais sorti de l'eau. Je me fis traverser rapidement et, aussi vite que je pus, je parcourus dans la nuit la distance qui me séparait du village. Jamais la vue du vieux toit de notre demeure ne me fut si agréable. Lorsque ma tante m'ouvrit la porte, je lui tendis le canard et, pendant qu'elle l'admirait, je m'éclipsai dans ma chambre, d'où je ne sortis qu'après m'être changé, car mon paletot gelé avait la consistance du carton. Ah ! qu'elle fut bonne, alors, la soupe brûlante de la vieille tante ! En m'éveillant fort tard le lendemain matin, je constatai que ma grippe de la veille avait complètement disparu. L'année suivante, notre tante quittait la maison des aïeux pour s'en aller dans le petit cimetière entourant l'église. Elle est partie sans connaître mon aventure. Léon VUILLAME.(1) « Morte », ancien lit du Doubs où le courant ne se fait sentir qu'en temps de crue. |

|
Le Chasseur Français N°660 Février 1952 Page 73 |

|

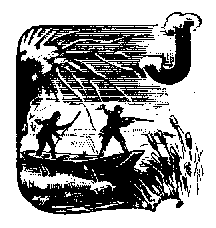 'étais allé passer quelques jours auprès de ma très
vieille tante. Elle était alors encore gardienne et génie de l'antique maison
familiale d'Annoire, aux confins de la Bourgogne, du Jura et de la Bresse.
'étais allé passer quelques jours auprès de ma très
vieille tante. Elle était alors encore gardienne et génie de l'antique maison
familiale d'Annoire, aux confins de la Bourgogne, du Jura et de la Bresse.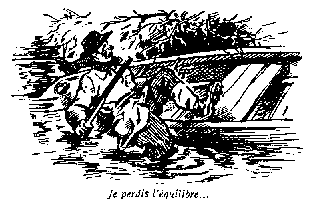 Je devais présenter au feu tantôt la face, tantôt le
verso (il est, bien entendu, difficile de présenter les deux à la fois),
grillant d'un côté, gelant de l'autre. Je tournai ainsi comme un poulet à la
broche pendant que mes braves compagnons faisaient leur possible pour sécher
l'indispensable de mes vêtements.
Je devais présenter au feu tantôt la face, tantôt le
verso (il est, bien entendu, difficile de présenter les deux à la fois),
grillant d'un côté, gelant de l'autre. Je tournai ainsi comme un poulet à la
broche pendant que mes braves compagnons faisaient leur possible pour sécher
l'indispensable de mes vêtements.