| Accueil > Années 1952 > N°660 Février 1952 > Page 125 | Tous droits réservés |
Notes de voyage

|
La fève de Calabar |

|
|
À son étonnante vitalité et une imperturbable bonne humeur Babo Saré alliait un courage de tous les instants. Si sa présence se traduisait par une certaine recrudescence des bruyants éclats de rire si caractéristiques du bien-être physique des Noirs, elle permettait normalement aussi de s'attendre à un travail prompt et convenablement accompli. Il appartenait à l'équipe des soixante-cinq Kroomen qu'à notre arrivée sur les côtes de Guinée nous avions embarquée à Tabou. L'habitude des navires de faire ainsi appel à la main-d'œuvre indigène pendant leur séjour quelquefois long dans ces parages s'explique par l'absence, à l'époque presque complète, d'installations portuaires normales. Mais la présence des Kroomen permet, en outre, de poursuivre en mer et pendant les longues attentes sur les rades des travaux d'entretien courant du navire sous un climat où le rendement des équipages européens est souvent compromis par la fièvre et des troubles de santé provoqués par l'absence prolongée de nourriture fraîche. Les équipes se trouvent sous les ordres d'un « cacatois », qui est généralement assisté de plusieurs « petits cacatois ». À bord des cargos régulièrement affectés au service de la côte occidentale d'Afrique, il n'est pas rare de voir la même équipe revenir à bord pendant plusieurs voyages de suite, car, aussi bien que nous, le Noir est susceptible de s'attacher à l'ambiance qui règne sur un bateau. Cette fois-là, le voyage approchait de sa fin. Cinq jours nous séparaient de l'escale de Tabou où les Noirs devaient nous quitter. Ce fut alors que quelques-uns d'entre eux vinrent me trouver pour m'avertir que Babo Saré était tombé malade. Je le trouvai étendu sur une planche au fond du poste des Kroomen ; atteint d'une forte fièvre, respirant avec difficulté, il gardait les yeux fermés et ne répondait plus à aucune de mes questions. C'était la vieille manie des Noirs : de peur d'être débarqué loin du pays dans un hôpital de la côte et de ne pouvoir retourner à Tabou avec les autres, Babo avait imposé à ses camarades de poste de ne pas mettre les Blancs au courant de sa maladie, et dès lors personne ne m'en avait parlé alors qu'il avait encore été temps. Maintenant, avec un pouls à peine perceptible, le malheureux semblait près de s'éteindre. Les Noirs me dirent qu'il s'était plaint de douleurs dans les régions intercostales. Congestion pulmonaire ? Pleurésie ? Dans l'impossibilité d'interroger le malade, je n'avais pas les moyens de m'en rendre compte. Et, en l'absence d'un diagnostic sûr, je n'eus que faire des beaux conseils du manuel d'hygiène navale. Babo se trouvait dans une sorte de coma. Je lui appliquai force sinapismes, lui fis avaler quelques gouttes de rhum et administrai un lavement.
Par malheur, la mer devint agitée, et nous trouvâmes à Tabou une barre violente et difficile à franchir. Les Kroomen furent débarqués à coups de filet. Et, malgré toutes ses supplications, il ne pouvait être question de faire partir ainsi Babo Saré, encore à peine capable de se tenir assis. Mais le lendemain nous étions au mouillage devant Grand Sesters sur les côtes du Libéria. Les circonstances étant favorables, je proposai à Babo de se faire débarquer ici : après quelques jours de repos dans l'endroit, il pourrait regagner Tabou à pied. Cependant, au lieu de susciter la joie du Noir, mes paroles lui firent manifester les signes d'une intense frayeur. Plutôt abasourdi, j'essayai de lui faire comprendre la simplicité de la situation. Mais Babo, couvert de sueur, me regardait avec des yeux terrifiés et continuait de protester. Il fit preuve, dans sa fièvre, d'une agitation intérieure qui ne tarda pas à devenir inquiétante lorsque sans arrêt, avec de pauvres gestes affaiblis, il répétait, en s'efforçant vainement de crier, les mots de : « Pas moyen, capitaine, pas moyen Libéria ! » Dès lors nous cessâmes d'insister. Il y avait une solution simple, c'était de confier le malade à notre agence de Conakry, qui le ferait rapatrier à Tabou par le premier bateau français descendant vers le sud. Nous savions tous que le Libéria est un pays plutôt bizarre, qu'il s'y passait, sous les yeux d'une administration impuissante et mal avertie, des choses peu communes. La peur de Babo ne laissait pas d'éveiller nos commentaires. Certes, ce n'était pas le moment d'interroger le malheureux pour lequel le seul nom de ce pays semblait évoquer le souvenir d'un de ces drames dont les profondeurs de l'Afrique savent si bien garder le secret ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bien du temps s'était passé depuis ces faits. Au milieu de pluies torrentielles, nous nous morfondions depuis de nombreuses semaines au fond du bras de mer formé par le cours inférieur du Gabon où près de l'île dite aux Perroquets notre navire se trouvait à l'ancre. Un peu en amont de l'Île l'Ingombiné, dernier grand affluent du fleuve, débouche de la forêt vierge. Deux ou trois fois par semaine, nos chaloupes en remontaient le cours pour en ressortir après deux marées avec de lourds radeaux de billes d'okoumé et d'autres essences, fret pour l'Europe, qu'elles étaient allées prendre à Macoc, un centre d'exploitation forestière isolé appartenant au consortium des Chemins de fer français et situé à peu près à l'endroit où l'Ingombiné franchit l'équateur. Nos fidèles Kroomen du précédent voyage nous avaient rejoints à Tabou, et Babo Saré, florissant de force et de santé, faisait en riant son travail dans l'équipe. Je m'étais arrangé pour l'emmener un jour où mon tour d'accompagner les chaloupes dans l'Ingombiné était revenu. À l'entrée de l'affluent un groupe de flamants roses profitait de la basse mer pour chercher sa nourriture dans la vase molle. Plus loin, la rivière se rétrécit, l'impénétrable forêt aux hautes racines aériennes qui la bordait finit par nous surplomber. Des heures et des heures, nous remontions l'étroite voie au milieu d'un décor et d'un silence de la nature que rien ne semblait avoir troublés depuis les origines du monde. Nul, certes, ne pourra jamais décrire toute la beauté d'une telle randonnée. Les bêtes semblaient avoir fui à l'approche du vrombissement des semi-diésels de nos Bollenders, dont l'écho, revenu des vertes murailles, pouvait donner l'illusion de lointains tam-tams. Ce sont de ces souvenirs qui vous donnent à jamais la nostalgie de l'Afrique noire ... Se servant avec satisfaction d'une tige de bois mou pour faire un nettoyage prolongé de ses dents, Babo Saré se tenait assis à mes côtés sur la partie avant du large capot de fer qui recouvrait le compartiment du moteur. Je cherchais un début de conversation. — Toi bien fini malade, Babo ? — Toi grand porrohman ! dit-il en guise de compliment et riant de toutes ses dents blanches. Je le questionnai sur sa famille, son pays, son passé. Il me répondit de bonne grâce. Et le Libéria, le connaissait-il ? Oui, ce sont des « savasses » (1). Il n'y retournera jamais. Il y avait donc été ? En effet. Bribe par bribe, sans trace de cette peur qu'il avait manifestée naguère au moment de sa maladie, il me permit, par ses réponses, de reconstituer toute son affaire du Libéria. Babo Saré n'était pas sujet français d'origine. Son père avait été porrohman, sorte de sorcier de village dans un endroit situé au pays de Kroo derrière les collines de l'Est libérien. D'après le récit du Noir, il semble bien qu'aucune influence étrangère ni même gouvernementale n'y était jamais venue troubler les antiques et primitives coutumes de la tribu. Le fait, universellement connu à l'époque, de l'impuissance notoire des agents du gouvernement de Monrovia dans les vastes territoires de l'intérieur corroborait cette image. Au moment de sa mort, intervenue dans des circonstances mystérieuses, le père de Babo venait de commencer l'initiation de son fils dans les secrets de son état. Selon Babo, ce décès était l'oeuvre d'un autre porrohman, concurrent de son père. Peu après, le corps d'une femme étranglée fut trouvé devant la case de Babo. Cette femme, Babo l'avait connue, pour employer ce terme dans son sens biblique. Or, en l'occurrence, la loi de la tribu établissait, par une sorte de présomption légale, que l'assassin était le propriétaire de la case au voisinage de laquelle le cadavre de la victime était découvert. — Alors moi calabousse et moi attaché, me dit Babo. Mais la présomption n'était pas absolue. Une sorte d'ordalie devait la confirmer : au cours d'une cérémonie publique, le présumé assassin se voit obligé d'avaler, devant les anciens de la tribu, un « gri-gri », qui est un poison mortel. S'il y a plusieurs accusés, le porrohman épargnera ceux qu'il veut ménager en ajoutant secrètement à leur dose de poison un puissant vomitif. La mort de l'inculpé est considérée comme preuve de son méfait. Babo sentait vaguement que tous ses malheurs étaient l'œuvre de ce même sorcier qui avait déjà supprimé son père. Soutenu par une farouche volonté de vivre et aidé par le hasard, moins superstitieux aussi à cause de son embryon d'apprentissage, il réussit à s'évader et à franchir le Cavally, pour finalement venir s'établir aux environs de Tabou, en Côte-d'Ivoire. En fait, sa peur irraisonnée de fouler la terre libérienne était ridicule. Mes explications à ce sujet semblèrent le satisfaire, mais finalement le laissaient sceptiques. Il promit de m'apporter, à l'occasion, un échantillon du gri-gri mortel que, dans le temps, son père lui avait appris à connaître ... Un mois après notre départ de l'île aux Perroquets, nous nous trouvions amarrés à l'appontement en bois de Burutu, sur la rivière Forcados, au Nigeria, où des chalands remorqués descendant le Wari devaient nous amener du coton. L'endroit est malsain à l'extrême. Situé dans le delta et entouré de forêts marécageuses, il est pourri de moustiques et de fièvre. Les rares Blancs du pays y séjournent le moins possible. C'est là que Babo Saré me fit voir une sorte de liane de la famille des légumineuses. C'était une forte plante à tige volubile de la grosseur d'un bras et de plus de 15 mètres de longueur. Il en arracha une cosse et m'en remit les deux fèves. Elles étaient réniformes, de couleur chocolat et entourées d'une profonde fente qui les divisait en deux moitiés. Certaines cosses avaient jusqu'à 15 centimètres, mais aucune ne contenait plus de trois fèves ; le plus souvent il n'y en avait que deux ou même une seule. C'était au moyen de ces fèves insipides et inodores que le porrohman du village kroo empoisonnait les personnes dont il cherchait à se débarrasser. Le rouge pourpre des grandes et belles fleurs de cette liane avaient depuis longtemps attiré mon regard en différents endroits depuis le cap des Palmes jusqu'au Cameroun. Il s'agissait de la Physostigma venenosum, seule espèce du genre Physostigma. Sa semence est connue en Europe sous le nom de fève de Calabar depuis 1859, l'année où le botaniste Fraser en montra les propriétés thérapeutiques au monde médical. Elle contient, en effet, de l'ésérine, un alcaloïde dépourvu de saveur, d'odeur et de couleur, qui possède un pouvoir paralyso-moteur sur la matière cérébro-spinale, de telle sorte que son absorption produit un effet tétanique mortel. Employée en dose infinitésimale, elle provoque la contraction de la pupille de l'œil et agit ainsi en sens inverse de l'atropine de la belladone. On lui a découvert, par ailleurs, des réactions utiles dans le traitement de toute une série de maladies telles que les convulsions de l'enfance, le tétanos, l'épilepsie, les ballonnements, la constipation et la chorée, maladie plus connue sous le nom de danse de Saint-Guy. De plus, l'ésérine peut servir d'antidote en cas d'empoisonnement par la strychnine. La fève de Calabar contient aussi, mais en quantité moindre, de la calabrine, autre alcaloïde dont les effets sont analogues à ceux de ce dernier poison. René R.-J. ROHR,Capitaine au long cours. (1) Sauvages. |

|
Le Chasseur Français N°660 Février 1952 Page 125 |

|

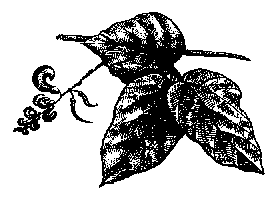 Le lendemain, le cœur du malade étant devenu très
faible, une issue fatale me parut presque certaine. Alors, en l'absence de
toute autre ressource, simplement pour essayer encore que1que chose, je tentai
une piqûre de cacodylate de soude. La chaleur et l'humidité, particulièrement écrasantes
ce jour-là, achevèrent de m'ôter les dernières lueurs d'espoir au sujet de Babo
Saré. Mais, néanmoins, au courant de l'après-midi, un Noir vint m'informer
qu'il avait ouvert les yeux et murmuré quelques paroles. Sans essayer de me
rendre compte si ce changement était dû à mon traitement empirique ou à la
forte constitution du Noir, je redoublai mes efforts avec bientôt la conviction
bien fondée que le malade était sauvé.
Le lendemain, le cœur du malade étant devenu très
faible, une issue fatale me parut presque certaine. Alors, en l'absence de
toute autre ressource, simplement pour essayer encore que1que chose, je tentai
une piqûre de cacodylate de soude. La chaleur et l'humidité, particulièrement écrasantes
ce jour-là, achevèrent de m'ôter les dernières lueurs d'espoir au sujet de Babo
Saré. Mais, néanmoins, au courant de l'après-midi, un Noir vint m'informer
qu'il avait ouvert les yeux et murmuré quelques paroles. Sans essayer de me
rendre compte si ce changement était dû à mon traitement empirique ou à la
forte constitution du Noir, je redoublai mes efforts avec bientôt la conviction
bien fondée que le malade était sauvé.