| Accueil > Années 1952 > N°661 Mars 1952 > Page 141 | Tous droits réservés |

|
Lequel choisirais-tu, Diane : ton maître ou moi ? |

|
|
Nous chassions alors, mon beau-frère et moi, en utilisant pleinement les services si appréciables d'une jeune chienne Bretonne qui émerveilla souvent nos camarades. « Ryta », tel était son nom, avait hérité de toutes les qualités de sa race et convenait admirablement à la région où se situait notre action. Que de satisfactions elle nous avait apportées ! Or, un jour — d'ouverture, s'il vous plaît, — mon beau-frère, cependant considéré, à juste titre d'ailleurs, comme l'un des meilleurs fusils, sinon le meilleur, de la région, tua net sa pauvre petite chienne ! C'était alors qu'il tirait, dans une étroite coulée, un lapin sur lequel il venait de poser son pied, que « Ryta », quittant comme une flèche le bouquet de genêts qui jusqu'alors la dissimulait à nos yeux, vint se jeter littéralement sous le plomb ! Le coup fit deux victimes : le lapin et le chien touché en pleine tête. Je reverrai toujours le grand corps de mon beau-frère, accablé de désespoir, regardant sa petite compagne rendre, sur-le-champ, son dernier soupir ! Lui, ce cultivateur si dur pour lui-même, cet homme qui ne manifeste que très rarement l'affection cependant si profonde qu'il nourrit pour les siens, ce « roc » qui, même aux plus pénibles moments de son existence, n'avait jamais réussi à faire couler de ses yeux la moindre larme — à croire qu'ils étaient aussi secs que sa carcasse, — cacha cependant son visage dans ses deux grandes mains calleuses pour ne pas laisser briller au soleil du matin cette goutte chaude, laquelle — pour la première fois de sa vie — mouillait sa paupière ! Il avait, lui, un tel fusil, tué sa petite « Ryta » qu'il aimait tant ! Mais passons sur ce drame stupide, que je souhaite très sincèrement à mes amis chasseurs de ne jamais vivre. Après cette aventure, notre homme rentra tristement au logis, déposa son calibre 16 sur ses pieds de biche et déclara gravement qu'il ne chasserait plus. — Je suis si maladroit ! précisa-t-il. Mais saint Hubert ne lâcha pas de si tôt une semblable proie et, quelques jours après cette lamentable ouverture, un excellent ami venait, en voiture, nous chercher pour aller voir, dans un village voisin, une autre Bretonne qu'on disait être de qualité. Notre première, impression fut très mauvaise. « Diane » était une bête qui, au moment, nourrissait sept chiots. Elle vivait dans un foyer misérable. Son maître malade la laissait chasser seule et, visiblement, le produit de ces sorties constituait son unique nourriture. Elle n'avait que les os et la peau ! Une dame nous déclara que, ne pouvant plus la nourrir, elle voulait s'en débarrasser. Après une courte discussion, mon beau-frère risqua 500 francs, bien persuadé qu'il serait bientôt obligé d'avoir recours au vétérinaire pour piquer la pauvre bête. Diane tenait avec peine sur ses pattes. Elle me faisait pitié. En revenant en voiture au logis, je la pris sur mes genoux et lui donnai quelques caresses. Avait-elle déjà connu ces douceurs ? Peu probable, car, très craintive, elle se pelotonnait et tremblait dès que ma main se levait. Sur la fin du parcours, cependant, elle prenait visiblement confiance et semblait avoir deviné qu'une tout autre vie s'ouvrait alors devant elle. Depuis ce jour, Diane me témoigne une éternelle reconnaissance. Bien soignée, choyée et dorlotée, elle fut rapidement apte à suivre son nouveau maître à travers champs. Elle avait de nombreux défauts, mais d'extraordinaires aptitudes pour la chasse ; aussi s'habitua-t-elle rapidement aux coups de fusil et parvint ensuite à se libérer, une à une, de ses imperfections. Domicilié à 50 kilomètres de chez mon beau-frère, mes occupations m'empêchent, hélas ! de chasser aussi souvent que je le désirerais et, de ce fait, je ne revois ma protégée qu'à de trop longs intervalles. Cependant, à chacun de mes voyages, reconnaissant de très loin le son du moteur de ma moto — mode de transport qu'elle affectionne tout particulièrement — Diane se précipite à ma rencontre. Dès que je mets pied à terre, elle me saute au visage, me lèche les mains, me « fait des joies inouïes », puis, ayant dans le regard une indescriptible expression, mêlée à la fois de plaisir et d'émotion, elle se met, en tortillant curieusement sa gueule, à émettre des sons amusants, tenant du hurlement, de l'aboiement et du glapissement ! « Elle te parle », m'ont dit souvent des amis assistant à cette curieuse scène. Sait-on ?
Diane se rappellera toujours que c'est moi qui, l'arrachant au « bagne » où elle vivait, l'ai transportée sur mes genoux dans le paradis où s'écoulent désormais pour elle des jours si merveilleux ! Et lorsqu'en forêt nous chassons la bécasse, alors que je me tiens à quelque cinquante pas de son maître, profitant d'un court moment d'inattention de celui-ci, elle vient me retrouver. Elle hume devant moi, avec zèle et application, chaque touffe de bruyère. Mais si, soudain, un bref et impératif coup de sifflet la rappelle à l'ordre, alors ma compagne s'éloigne en me regardant avec de grands yeux tristes. Elle se retourne de temps à autre et semble me dire : « Ne m'en veux pas ! Tu vois bien, je voudrais bien t'arrêter une belle mordorée, mais mon maître m'appelle. Tu comprends bien, tu n'es pas fâché ? Il faut que j'obéisse ... » Il m'est souvent venu à l'idée, à ces moments-là, de faire un geste de rappel pour tenter de la conserver avec moi. Je n'ai jamais osé imposer à son « pauvre cœur de chien », une aussi cruelle épreuve. Au fait, Diane, si je te rappelais, à ce moment-là, lequel de nous deux choisirais-tu ? Ton maître ou moi ? R. GUILLET. |

|
Le Chasseur Français N°661 Mars 1952 Page 141 |

|

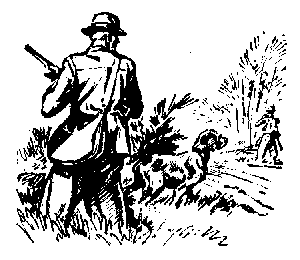 Ce qui est certain, c'est que jamais à aucune autre
personne, en tout cas, elle ne tient semblable « langage ». Jamais
son maître, qu'elle ne quitte cependant pas d'une semelle, n'a pu lui faire
effectuer ce manège !
Ce qui est certain, c'est que jamais à aucune autre
personne, en tout cas, elle ne tient semblable « langage ». Jamais
son maître, qu'elle ne quitte cependant pas d'une semelle, n'a pu lui faire
effectuer ce manège !