| Accueil > Années 1952 > N°661 Mars 1952 > Page 154 | Tous droits réservés |

|
Le métier de cycliste professionnel |

|
|
Si on se place au point de vue du simple bon sens, il apparaît étrange que des succès ou des défaites puissent avoir des répercussions sur la vente des vélos X ou Y. Qu'un concurrent, à l'issue de deux ou trois cents kilomètres, devance ses concurrents d'une roue, voire de quelques longueurs, cela démontre qu'il est le plus malin, ou le plus rapide, mais cela ne prouve nullement que le vélo qu'il monte est supérieur à ceux de ses adversaires. La logique ne triomphe pas dans l'affaire. Il est, prétend-on, indiscutable que la victoire dans une épreuve classique est génératrice de ventes accélérées et de profits. Par suite de cet abandon, des professionnels se sont trouvés sans emploi. Les meilleurs ont découvert rapidement un nouveau patron. Les moins bons, ou ceux qui ont un trop fichu caractère, ont été condamnés à courir à leur compte ou à se retirer. Mais, dira-t-on, les coureurs cyclistes sont donc des employés touchant des mensualités comme des comptables ou comme des fonctionnaires. Nous pensions qu'ils vivaient grâce au produit des prix et des primes. Nous croyions que leur métier était plus que tous autres instable, fertile en risques. Les gens qui parlent ainsi se trompent. Nos pédaleurs touchent en fin de mois des salaires souvent mieux qu'honorables. Nous pourrions citer les noms de coureurs qui, en 1951 encore, émargeaient pour 50.000 francs et plus. Ces coureurs, hâtons-nous de le préciser, ne sont pas de grands champions. Ceux-ci ont les dents beaucoup plus longues. Parmi les coureurs dont le traitement régulier atteignait ou dépassait 600.000 francs par an, il en est plusieurs qui n'ont pas gagné une seule course et qui ont multiplié les abandons injustifiés ! Que des paresseux — s'il en existe parmi nos lecteurs — se mettent à leur place. Voici des garçons assurés de vivre douillettement. Pourquoi s'astreindraient-ils à s'entraîner sous le soleil ou dans la boue ? Pourquoi se fatigueraient-ils à rouler huit heures de file pour terminer un parcours ? Quelques contrats sur piste, des critériums faciles, avec primes au départ, suffisent pour corser l'ordinaire. Le malheur est que certains ont abusé du dolce farniente. Ils ont trop tiré sur la corde et la corde a cassé ! Doit-on les plaindre ? Si l'on veut que, même professionnel, le sport demeure le sport, on ne peut l'assimiler à une occupation banale et, moins encore, à une occupation qui laisse des loisirs illimités. Le sport est une lutte. Sa morale, brutale, est que le vaincu succombe, soit éliminé. S'il pratique réellement pour son plaisir, qu'il reste amateur et méprise les gains matériels. En revanche, nous jugeons normal que d'authentiques vedettes se fassent payer à leur prix. Elles sont rares et sont devenues internationales, même du point de vue industriel, si l'on peut ainsi dire. Koblet monte un vélo suisse en Suisse, un vélo italien en Italie, un vélo français en France. Et pas gratuitement ! La prime qui lui a été attribuée pour sa victoire dans le « Tour » était d'un million tout rond. Comme une star, il a prêté son nom et sa photo à des savons, à des dentifrices. Le Mexique lui a offert une tournée en qualité de journaliste. En moins d'un an, il a gagné une fortune. Qu'on regrette que des savants soient réduits à la portion congrue, d'accord. Mais, dans presque toutes les formes de l'activité, les « as » sont largement rémunérés. Koblet ne jouit pas d'un traitement de faveur. Notre Louison Bobet est, lorsqu'il se produit de l'autre côté des Alpes, équipé et grassement appointé par une marque italienne. La réciproque n'est d'ailleurs pas vraie. Coppi, Magni, Bartali et tutti quanti ne prêtent pas leurs services à des constructeurs étrangers. Des contrats stricts le leur interdisent. Dans le petit groupe des champions, Coppi conserve, malgré un déclin relatif, la grosse cote. Pour des exhibitions sur piste ou des critériums, son cachet est de 200.000 francs. Bobet et Koblet ne touchent que 100.000 francs, Barbotin et les hommes de sa classe doivent se contenter de 50.000, ce qui nous paraît mieux qu'honorable. Quel sort est réservé aux laissés pour compte des marques ? Ils sont invités à courir « à la musette » ou à se borner à une activité régionale. Le régime — naguère quasi général — qualifié pittoresquement « à la musette » est le suivant. Les coureurs sont fournis en machines et accessoires. Ils ne touchent pas de mensualités, paient de leur poche leurs frais de déplacement. Mais une marque, en course, les ravitaille, remplit leur musette et leur attribue des primes en cas de victoire. Le destin des régionaux est, quoi qu'il puisse paraître, enviable. Habitant chez eux, menant la vie de famille, exerçant sagement un métier leur assurant un salaire de base, ils ne sont pas menacés de chômer les dimanches et jours de fêtes. Dans un rayon de 200 ou 300 kilomètres de leur domicile, il y a toujours, pour eux, du printemps à la fin de l'automne, des épreuves convenablement dotées. Ils ont même l'embarras du choix. Cette prospérité du cyclisme régional explique l'attitude de garçons pondérés qui, maintes fois sollicités, n'ont pas consenti à quitter leur province pour tenter leur chance à Paris. Que nous ayons perdu quelques champions, cela est certain, mais combien d'hommes, aussi, ne sont-ils pas rentrés chez eux découragés, sans argent, sans emploi ? Le sport est cruel pour ceux dont les ambitions sont plus grandes que les forces. En terminant, nous mentionnerons une combinaison originale imaginée par René Vietto. Ayant été privé du poste de directeur sportif qu'il remplissait sans abandonner entièrement les compétitions, il a décidé de créer la marque Vietto. Les camarades enrôlés dans son équipe seront ses associés et ses représentants. Sans rémunération fixe, ils participeront aux bénéfices. Ainsi ils feront l'impossible pour gagner et accroître la réputation de leur firme. Au cours de leurs voyages, ils visiteront les clients. Ingénieuse, l'idée est-elle pratiquement réalisable ? Il est possible que, le jour où paraîtront ces lignes, Vietto en ait adopté une autre. Cabochard, hargneux, mais énergique et courageux en diable, Vietto demeure l'une des figures les plus expressives et les plus sympathiques du monde du sport. Possédé par la passion du vélo, il ne consent pas à la retraite. Dix fois, il a subi des opérations douloureuses pour rendre sa souplesse à l'une de ses « vieilles jambes ». Nous le reverrons sur les routes, enthousiaste, pestant, sacrant, vouant organisateurs et suiveurs aux pires supplices. Tant mieux : René Vietto nous manquerait. Un caractère de chien, mais un rude bonhomme qui, lui, n'a jamais volé l'argent qu'il gagnait. Jean BUZANÇAIS. |

|
Le Chasseur Français N°661 Mars 1952 Page 154 |

|

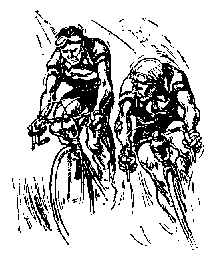 À l'issue de la dernière saison routière, plusieurs
constructeurs de cycles ont pris la décision de supprimer leur service des
courses. Un tel service exige des sacrifices financiers qui s'élèvent de dix à
vingt millions annuellement. Ces sommes sont représentées par les appointements
du directeur sportif des membres de « l'écurie », de mécaniciens
spécialisés, par des frais de déplacement considérables et par de nombreuses
dépenses accessoires. Elles varient suivant le nombre et la valeur des coureurs
engagés par la firme. Les marques qui ont liquidé leur équipe reprochent aux
représentants de leurs couleurs de ne pas leur avoir rapporté des victoires
marquantes.
À l'issue de la dernière saison routière, plusieurs
constructeurs de cycles ont pris la décision de supprimer leur service des
courses. Un tel service exige des sacrifices financiers qui s'élèvent de dix à
vingt millions annuellement. Ces sommes sont représentées par les appointements
du directeur sportif des membres de « l'écurie », de mécaniciens
spécialisés, par des frais de déplacement considérables et par de nombreuses
dépenses accessoires. Elles varient suivant le nombre et la valeur des coureurs
engagés par la firme. Les marques qui ont liquidé leur équipe reprochent aux
représentants de leurs couleurs de ne pas leur avoir rapporté des victoires
marquantes.