| Accueil > Années 1952 > N°661 Mars 1952 > Page 190 | Tous droits réservés |
La petite histoire

|
La garde nationale |

|
|
Le règne de Louis-Philippe marque l'apogée de ce soldat citoyen ; c'est aussi celui où il est la « tête de Turc » préférée de Daumier ou autres dessinateurs satiriques. On plaisantait surtout le biset, c'est-à-dire celui qui assistait aux revues sans tenue réglementaire ou qui montait la garde dans un accoutrement étrange, mi-civil, mi-militaire. Parfois, le pauvre diable, mal reçu de ses camarades, était sévèrement puni ; parfois, il ne se présentait même pas aux convocations, de peur d'être la risée de tout le bataillon ; alors les jours de prison tombaient ferme après la comparution de l'intéressé devant une sorte de conseil de guerre. Un jour, ce tribunal convoque l'artiste Reyer. Celui-ci tente d'attendrir ses juges : « Vous savez, dit-il, le malheureux sort des musiciens ... je n'ai jamais eu les moyens de me payer un uniforme, sans cela personne ne serait plus zélé que moi ... » Avec beaucoup d'élégance, le terrible président du jury déclare qu'il est prêt à offrir au compositeur de régler la note du tailleur. Alors, l'auteur bien oublié de la Statue s'écrie : « Vous ne pourriez pas transformer cet uniforme en un habit noir ? » Les gardes nationaux qui en avaient les moyens portaient fièrement un shako avec un attribut en métal représentant un coq gaulois et un faisceau de drapeaux ; cette coiffure en petite tenue était ornée d'un pompon tricolore et, dans les grandes occasions, d'un plumet retombant du plus gracieux effet. L'habit était bleu de roi, avec collet et retroussis rouges ; le pantalon était aussi bleu de roi, avec une bande alternativement bleue et rouge. Les vaudevillistes mirent en scène ces braves gens, en se gaussant, on doit s'en douter, de leur ridicule. Une petite pièce de la Restauration intitulée Une Nuit de la Garde nationale nous montre une femme s'habillant en militaire pour venir surprendre son mari au poste. C'est dans cette comédie que l'on trouve le personnage grotesque de M. Pigeon, le biset, coiffé d'un chapeau rond et harnaché de la double buffleterie par-dessus une fort bourgeoise redingote. Comme ses camarades reprochent à ce riche marchand sa ladrerie quant à la tenue, « n'importe, réplique le héros, on peut bien aimer son roi, sans être en uniforme ». Lorsqu'en 1830 cette milice connut, par suite des événements politiques, un nouveau regain de faveur, le Gymnase reprit la saynète. Mais les gardes de l'époque — c'étaient cependant en grande partie les mêmes — prirent fort mal la plaisanterie, et M. Pigeon dut quitter les planches devant les cris indignés « il n'y a plus de Pigeon » ! Le service de cette force de police auxiliaire était relativement simple ; en fait, elle doublait l'armée et les sergents de ville. En principe, on prend la faction trois ou quatre fois par an, mais cela dépend un peu de l'humeur du sergent major, qui règle à sa volonté les tours. L'homme de confiance du sous-officier c'est le tambour, dont Robert Burnand nous trace ainsi le portrait : « Celui-ci ne se contente pas de battre le rappel, aux jours d'alerte, ni de rythmer par ses ra et ses fla le défilé des légions, ni de se joindre aux autres tapins des autres légions pour célébrer la fête du Roi par une aubade assourdissante, battue, roulée à pleins bras sous les balcons des Tuileries. Le tambour porte à domicile les billets de garde ; s'ensuivent des relations étroites avec les concierges et, par conséquent, une documentation sur les locataires qui sera précieuse au sergent-major. Le tambour présente au capitaine les pièces à signer ; il est, entre les sergents-majors et le commandant de compagnie, l'agent officiel de liaison. » Tout citoyen de vingt à soixante ans, inscrit sur les rôles des impositions, fait obligatoirement partie de cette milice ; il figure sur les contrôles de l'infanterie, parfois aussi sur ceux de la cavalerie ou de l'artillerie, car la garde nationale a ses lanciers et ses pièces de canon, celles-ci ayant surtout une importance plus décorative que tactique. La garde nationale assure le service de place, fait des patrouilles, prend part aux revues. Toutes ces fonctions sont accomplies, le plus souvent, avec une fort aimable désinvolture. Voici comment l'écrivain de Jouy décrit une nuit d'un poste de garde : « Chacun revenait après avoir été dîner chez soi ou chez les restaurateurs des environs. Le tambour apportait au corps de garde les carricks, les manteaux, les capotes et les bonnets fourrés, dont les plus prévoyants avaient soin de se munir pour passer la nuit ; ceux-ci marquaient par un oreiller ou une couverture leur place sur le lit de camp ; ceux-là jouaient à la triomphe ou au piquet sur le poêle ; d'autres fumaient ; d'autres en cercle, autour de la lampe, écoutaient la lecture d'un journal que faisait à haute voix l'un de leurs camarades ; et l'officier, le cigare à la bouche, dans son grand fauteuil, donnait ses ordres pour le service de la nuit avec autant de sang-froid que Chevert au siège de Prague. » Ce texte humoristique n'est pas une charge, les documents officiels en confirment la véracité. En 1831, le correspondant du prince de Schwarzenberg écrit à celui-ci : « Quand on fait une ronde de postes de la ville pendant la nuit, on trouve quelquefois un factionnaire de la garde nationale : le reste du poste est allé se coucher, les uns avec leur femme, les autres tout seuls. Ce sont là les auxiliaires de notre armée, qui doivent de nouveau aller planter le drapeau révolutionnaire sur toutes les capitales de l'Europe ! » À certaines heures, une escouade, parfois abritée par un immense parapluie, parcourait les rues du vieux Paris ; le caporal pouvait alors fredonner ce refrain longtemps en vogue :
Je pars, Daumier et les autres caricaturistes, ainsi que les auteurs comiques, Labiche en tête, se moquent de ces braves soldats — épiciers ou marchands de drap dans la journée — déambulant, le fusil sur l'épaule, le coupe-choux en bandoulière. En cas de désobéissance ou d'oubli plus ou moins volontaire de monter une garde, le délinquant était conduit manu militari à la prison spéciale, dite des haricots, située rue des Fossés-Saint-Bernard. Les graffiti qui ornaient les murs de ces cachots — d'ailleurs fort doux — prouvaient qu'ils avaient été fréquentés par les plus grands artistes ou littérateurs de l'époque. Mais le garde national n'était pas toujours astreint à un service ou mis en geôle, parfois il avait de bons et agréables moments. Le 1er janvier, les tambours de chaque compagnie allaient visiter les officiers et leur présentaient leurs vœux en musique, ce qui n'était point toujours du goût des voisins, réveillés à l'aube par des sons souvent peu harmonieux. Le tapin offrait une belle lettre enluminée sur laquelle on pouvait lire des vers de mirliton. Mais gare au musicien s'il s'était avisé, pendant l'année, de commettre un acte de nature à déconsidérer ses camarades. C'est ce qui advint, sous le second Empire, à Abbeville. Les gardes nationaux du lieu devaient à tour de rôle monter la garde à la Poudrière, assez éloignée de la ville. L'endroit était désert et lugubre, les soldats citoyens prétendaient même que des fantômes hantaient ces parages ! Une nuit, on gratta à la porte ; bravement, un garde alla ouvrir et vit alors une forme blanche ; fou de terreur il tomba à la renverse sur le lit de camp, tandis que le factionnaire se blottissait dans sa guérite, où on le retrouva le lendemain mort de peur et de froid, car personne n'avait osé le relever. Seul, le vieux tambour se moque de ses collègues ; il assure, ce qui était vrai, qu'il s'agissait d'une vache aux poils blancs, oubliée par un maraîcher. Mais le pauvre et incrédule musicien fut cette année-là privé de toute gratification au jour de l'an ... Nous avons vu que ces militaires malgré eux étaient souvent des rebelles, des sortes d'insoumis ; cependant, fait paradoxal, beaucoup aimaient revêtir leur tenue pour parader et, lorsque le gouvernement parlait de leur supprimer ce jouet, c'était alors un tollé général. Quand, en 1827, Charles X licencia, à la suite d'événements scandaleux, la garde nationale de Paris, Delécluze vit dans Paris des uniformes exposés en dehors des boutiques avec un bouchon de paille et cet écriteau : « Habit de garde nationale à vendre, on se réserve les armes ». Longtemps, à Paris comme en province, on conserva le souvenir de cette milice bourgeoise. À Lille, les vieillards se souvenaient de la giberne, dite boîte à bruants (hannetons), qui pendait sur la bedaine de ces troupiers improvisés ; en Normandie, au jeu national des dominos, le 5 était surnommé la patrouille, sobriquet datant du temps où la patrouille — quatre hommes et un caporal — parcourait les rues de Rouen ou du Havre. Mais ces railleries, d'ailleurs sans méchanceté, ne doivent pas nous faire oublier qu'en 1870 maints gardes nationaux surent courageusement faire front aux Prussiens, presque toujours en nombre très supérieur. Les noms de ces héroïques défenseurs de leur village sont peut-être un peu effacés sur les monuments commémoratifs. Ils ne doivent pas l'être malgré tout dans le cœur de leurs descendants. Roger VAULTIER. |

|
Le Chasseur Français N°661 Mars 1952 Page 190 |

|

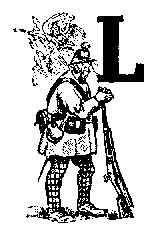 orsqu’on feuillette les albums de caricatures publiés
sous la Restauration ou la monarchie de Juillet, on est souvent frappé par le
nombre important de lithographies consacrées à un personnage toujours burlesque
dans sa gravité, revêtu d'un uniforme sous lequel pointe une bedaine
proéminente ; c'est le garde national, soutien du régime et, le cas
échéant, son adversaire.
orsqu’on feuillette les albums de caricatures publiés
sous la Restauration ou la monarchie de Juillet, on est souvent frappé par le
nombre important de lithographies consacrées à un personnage toujours burlesque
dans sa gravité, revêtu d'un uniforme sous lequel pointe une bedaine
proéminente ; c'est le garde national, soutien du régime et, le cas
échéant, son adversaire.