| Accueil > Années 1952 > N°665 Juillet 1952 > Page 393 | Tous droits réservés |

|
Un sacré doublé |

|
|
Raconte, mon chien... J'adore le corned-beef ... C'est une faiblesse, je le sais, mais, quand Il ouvre une de ces boîtes bariolées en forme de tronc de pyramide, mes narines palpitent d'aise, presque autant qu'au fumet tout frais d'un capucin (quelle honte !). Ce midi-là, j'étais un peu excusable de lorgner la boîte avec cette exceptionnelle intensité. Il y avait plus de trois ans qu'on n'avait vu de corned-beef. C'était cette chose bizarre : la guerre, qui avait amené les soupes plus maigres, la poursuite sans doute plus âpre aussi du civet et du rôti à travers les cailloux. Et c'était cet autre événement, obscur pour mon cerveau de chien, qui avait soudain ramené le corned-beef : le débarquement américain sur les cotes africaines. (J'en dirai bien d'autres, à propos de ce débarquement ...) Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ceci : nous sommes assis tous les deux à l'abri d'un mur de pierres sèches tout juste assez haut pour couper net un vent de glace soufflant du nord. Dame, c'est novembre, et nous sommes au sommet d'un piton qui domine le Souk des Hanchen. La bise coupe le museau, une bise violente, rageuse, qui rafle les fumées des douars, et les couche, et les déchire dans les vallons. Nous avons échoué là, au haut du mamelon, un peu au hasard, dans un bled quasi inconnu, et fait comme ceux que je déteste, des champs de cailloux, tout nus, désespérément vides. Des haies maigres, inhabitées, quelques oliviers hirsutes, déguenillés, aux feuilles d'argent sans cesse tourmentées et qui n'abritent que de rares grives ... Menu fretin !
Si. Le corned-beef. Justement, la boîte est ouverte. Il la pose sur une pierre plate, tout près du pain noir. Il en hume, lui aussi, l'odeur inespérée. Il mange, il mange ... Mais II me regarde avec un bon sourire. Je sais bien que j'aurai ma part. Il me la donne, avec un quignon de pain, quelques quartiers d'orange. Quel délice ! Je savoure. Je fais durer le plaisir, ce qui n'est pas dans les habitudes des chiens. Je lèche la boîte vide, au risque de me couper la langue. Mais tout a une fin. Même le corned-beef. Il me dit, tout en fumant, avec quelle jouissance, sa seule cigarette blonde : — Ce n'est pas tout ça, madame Chien. Il est midi et nous sommes bredouilles. Ce bled est infâme. Tant pis. On y gèle. Tant pis. Le camion vient nous reprendre à quatre heures. Allons-nous montrer à ces militaires rustauds que nous ne sommes capables de rien ? Du courage, mère Diane ! Pour une fois que nous avons de fameuse poudre dans nos cartouches, faisons encore un effort. Il se lève. Je gambade. Je ne demande pas mieux, moi ! Justement, sous nos pieds, s'amorce, en descente, un ravineau qui va s'élargissant jusqu'à la route, tout en bas. Deux ou trois plaques de doum que le vent froisse. Un ou deux jujubiers en touffes maigres. C'est par là qu'il me guide. Je hume. Je cherche. Rien à faire. Toujours le vide ... Mais à mi-pente, soudain, sous une murette de cailloux qui tient la terre et que, d'en haut, nous ne voyions pas, soudain, un picotement étrange et pourtant familier me met la rosée aux narines. Il y a, sous le petit mur, faisant corps avec lui, un gros buisson d'arganier sec. Malgré moi, je ralentis ... L'odeur sourd de là, des branches enchevêtrées, le fumet du capucin, mais étrangement fort, et lourd, par vagues grisantes. Il est là, je le sens. Je le sais. Mon cœur bat : toc, toc ... Ma patte avant se soulève. Mon cou s'allonge. Ma tête est à frôler les branches ... Lui, rapide, le doigt sur la détente, est déjà en contre-bas, et Il s'approche, tout doux, tout doux, vers la touffe ... Le tir sera difficile, à sept ou huit mètres seulement, avant que le lièvre ait sauté le mur. Il ne peut reculer non plus, car la pente est raide, et il manquerait son coup. Je n'ai jamais tant frémi d'aise. Il sent comme le diable, le bouquin, il pue divinement ! Je n'y tiens plus : un mouvement irraisonné me précipite en avant ... Ça y est. Un lièvre énorme jaillit sur moi, dans mes pattes et, dans la même seconde, bascule au faîte du mur. Sauvé ! Non, car lui veillait. Surpris, il réalise vite. Le coup m'assourdit. (Poudre de mortier de tranchée !) Et le capucin, du haut de la murette, roule sous mon nez. Mais lui s'est retourné et, en pleine descente, foudroie un second lièvre, sorti de la même touffe. Celui-là fait sept ou huit culbutes. Le vent emporte une touffe de poils. J'exulte. J'exécute un lancer de lièvre à pleine gueule. Dieu des chasseurs, qu'ils sont lourds ! Un bouquin et sa hase dont nous avons interrompu le duo d'amour. Lui, toujours calme, les soupèse, en caresse le poil roux, leur appuie avec méthode sur le ventre pour la rituelle et hygiénique opération, les pend enfin au porte-gibier et me flatte, et me félicite. Il n'y a vraiment pas de quoi ! Deux lièvres à la fois, ça sent tellement fort ! Surtout s'ils se livrent à des ébats ... Mais passons ... Et ce ravin fut vraiment un porte-chance. Tout en bas, au bord de la route, demeuraient de grands chaumes clairs, parsemés d'herbes noires et rêches. Là, en cinq minutes, je lui arrêtai superbement (je ne crains pas de le dire) une jolie compagnie de rouges. Il en tua six en huit coups. Qu'on y ajoute un septième perdreau, parti du haut d'un olivier, et, au moment de repartir, un confortable levraut qui gicla du coin de la dernière vigne, et l'on voit qu'une journée si tristement commencée ne se termina pas mal du tout ... Si les militaires du porte-tank avaient moins fêté le débarquement, ils auraient sans doute admiré notre chasse. Ils pensaient bien à tout autre chose. Chantant et hurlant, à dominer le bruit du Saurer. Pour moi, je serrai les fesses jusqu'à la ville, le chauffeur s'étant mis en tête de « s'envoyer un chameau ». Il ne s'envoya rien du tout. Les chameaux sont stupides, mais prudents. Épouvantés, ils quittaient la route, un kilomètre devant nous, à grandes enjambées de leurs pattes raides, en baissant leurs cous de dindons. Ce fut une belle histoire à raconter. Un doublé de lièvres, ce n’est pas extraordinaire, mais ce n'est pas non plus si courant. Et je n'étais pas peu fière, car, tandis que ses camarades l'écoutaient, il me caressait les oreilles, doucement, comme pour exprimer tout ce qu'il me devait d'affectueuse reconnaissance ... Le soir, avant de m'endormir, je songeais à ces deux lièvres, tués à cet essentiel moment. Mais, comme je suis une très vieille chienne et que je n'ai plus à m'attendrir sur des choses qui ne m'appartiennent plus, je me dis, entre parenthèses, que c'était tout de même une belle fin ... Diane. P. C. C. Maurice CONTANT. |

|
Le Chasseur Français N°665 Juillet 1952 Page 393 |

|

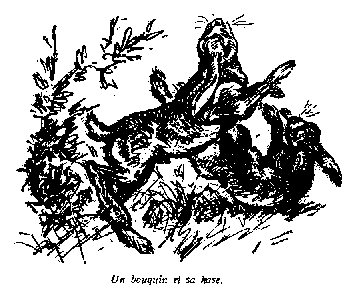 Je suis donc d'un regard d'extrême convoitise le mouvement
de son poignet, qui tourne avec art et lenteur la clef minuscule découpant le
couvercle de la boîte. Le fumet, déjà, mouille mes narines. Je n'ai pourtant
pas de quoi être réjoui : il est midi et nous n'avons rien tué. Rien tiré.
Le filet vide pend sur la murette. Misère ! ... Et quelle expédition
pourtant. Nous sommes venus (occasion rarissime) sur un énorme Saurer porte-tank,
avec des soldats mal élevés, qui ont répandu du vin rouge sur mes fesses et,
depuis l'aube, nous avons couru les mamelons, ausculté les haies sans résultat.
Je me suis piqué le nez aux jujubiers ras, où s'accroche la laine des moutons.
Je me suis écorché les paumes sur des cailloux minuscules qui s'incrustent
entre les doigts. J'ai reniflé de si près une noualla dans de grands figuiers à
palette, que deux immondes chiens jaunes sont venus me hurler aux oreilles ...
Et tout cela pour rien ! ... Et partout le paysage semble le même. De
grands champs nus, en pente, piquetés de maigres touffes. Où aller ? Où ne
pas aller ? ... Aucune consolation.
Je suis donc d'un regard d'extrême convoitise le mouvement
de son poignet, qui tourne avec art et lenteur la clef minuscule découpant le
couvercle de la boîte. Le fumet, déjà, mouille mes narines. Je n'ai pourtant
pas de quoi être réjoui : il est midi et nous n'avons rien tué. Rien tiré.
Le filet vide pend sur la murette. Misère ! ... Et quelle expédition
pourtant. Nous sommes venus (occasion rarissime) sur un énorme Saurer porte-tank,
avec des soldats mal élevés, qui ont répandu du vin rouge sur mes fesses et,
depuis l'aube, nous avons couru les mamelons, ausculté les haies sans résultat.
Je me suis piqué le nez aux jujubiers ras, où s'accroche la laine des moutons.
Je me suis écorché les paumes sur des cailloux minuscules qui s'incrustent
entre les doigts. J'ai reniflé de si près une noualla dans de grands figuiers à
palette, que deux immondes chiens jaunes sont venus me hurler aux oreilles ...
Et tout cela pour rien ! ... Et partout le paysage semble le même. De
grands champs nus, en pente, piquetés de maigres touffes. Où aller ? Où ne
pas aller ? ... Aucune consolation.