| Accueil > Années 1952 > N°666 Août 1952 > Page 460 | Tous droits réservés |

|
La peau de jaguar |

|
|
L'Indien essaya de comprendre ce qui lui était arrivé ; mais sa tête lui faisait trop mal, aussi mal qu'un jour où un puma blessé l'avait à moitié scalpé d'un coup de patte. Tout, dans sa mémoire, n'était que brouillard, se confondait avec la bruine matinale et avec la lisière indécise de la forêt. Et puis il y avait cette soif atroce qui lui brûlait les entrailles. Péniblement il se leva, se dirigea vers sa monture où il pensait trouver la gourde d'eau pendue à sa selle. Il n'y avait plus de gourde, plus d'arc, plus de flèches, plus de sac à provisions. De l'eau sur ces prairies où il n'avait pas plu depuis cinq lunes, c'était inutile d'en chercher. Il entra dans la forêt voisine et, avec son coutelas, qui par hasard pendait encore à sa ceinture, il coupa quelques tiges de piñas (4) sauvages. Lentement, il suça l'eau fraîche concentrée à leur base. Il coupa et suça beaucoup de piñas : peu à peu sa mémoire s'éclaircit. Il se souvint alors que, quatre jours auparavant, il avait quitté la forêt de Lollak Nillak où chassait sa tribu des Charras. Le cacique l'avait choisi lui, Lino, pour aller au rancho d'Alonso, non loin d'où les hommes blancs remuaient beaucoup de terre, faisaient marcher des bêtes effrayantes qui sifflaient et crachaient du feu. Il était parti, la yegua chargée d'un ballot de plumes d'autruches, de trois peaux de pumas et d'un petit bouquet de plumes d'aigrettes. Il fallait rapporter du sucre, du sel, de la herba-maté, des allumettes et des cartouches pour le Winchester du cacique. Dans ces forêts et ces clairières du Chaco, cheminant jour et nuit, ne dormant qu'à la sieste, il avait parcouru plus de quarante lieues pour arriver au comptoir d'Alonso. Celui-ci avait pris les plumes d'autruches et les peaux de pumas. En échange, il lui avait remis un sac de provisions qui, en semblables circonstances, sont toujours demandées. Lino avait bien trouvé le sac trop petit ; mais il ne parlait pas l'espagnol et Alonso paraissait ne pas comprendre le charra. Dans ces conditions, il était difficile de discuter. Il sortit, fixa le sac de provisions en croupe, attaché à la selle, puis rentra au rancho ; il avait, en effet, oublié le petit bouquet de plumes d'aigrettes. À la vue des plumes blanches, longues, fines, légères et transparentes, les yeux d'Alonso s'écarquillèrent comme ceux d'un hibou. Quant à Lino, il fixa son regard sur les armes accrochées aux rayons, derrière le comptoir : il y avait là des fusils de chasse, des carabines, des revolvers aux crosses étincelantes. Mais Alonso fit mine de ne pas comprendre, et il mit sur la planche un verre rempli d'une liqueur aux reflets de soleil. Ces reflets fascinèrent Lino ; on aurait cru un singe qui voit ramper vers lui un lampalagua (5). D'un trait, il vida le verre de caña (6), puis un second, puis sans doute beaucoup d'autres. Vaguement il lui semblait, comme dans un rêve, être monté ensuite à cheval, parti dans la nuit. Puis c'étaient les ténèbres les plus opaques. Combien de temps avait-il cheminé avant de rouler sur le sol ? Personne ne le saura jamais. Sa soif apaisée, Lino sortit de la forêt, se mit en selle et retourna dans la direction du rancho d'Alonso dans l'espoir de retrouver toutes les choses qu'il avait semées. Ses yeux de lynx découvrirent d'abord son arc, puis les flèches, dans leur gaine de cuir. Enfin il aperçut une masse volumineuse qui devait être le sac à provisions. Lorsqu'il en fut à quelques pas, il pressentit une catastrophe : en effet, une énorme flaque noire et grouillante recouvrait ce qui restait du ballot et s'étendait aux alentours comme l'ombre d'un arbre. Du sac, il ne restait pas grand-chose et les fourmis achevaient leur déménagement. D'un coup de cravache, il déblaya le terrain : seule émergea la boîte de cartouches, dont le carton même était en loques, et les bouts d'allumettes, dont la cire manquait. Lino se rendit compte de l'étendue du désastre et de ses conséquences : s'il revenait à Lollak Nillak, le cacique l'assommerait, ce qui était équitable ; mais il pourrait s'aviser, au contraire, de le laisser vivre après lui avoir coupé une oreille, ce qui serait autrement terrible. Il deviendrait ensuite la risée des femmes charras. Et puis il fallait absolument deux oreilles pour soutenir son chapeau, faute de quoi celui-ci descendrait jusqu'au menton. Non, décidément, il ne pouvait songer à se présenter devant le cacique. Redevenant peu à peu lui-même, Lino distribua les responsabilités : c'était ce damné d'Alonso qui était coupable et il allait lui faire payer cela. Il y mettrait le temps, mais il les aurait tous les deux : lui, Alonso, et son péon. Il avait remarqué les deux catres (7) surmontés de leur moustiquaire, près du corral (8). Il se glisserait la nuit comme un serpent et les égorgerait l'un après l'autre, sans qu'ils aient seulement le temps de faire couic. Puis il s'emparerait des chevaux, les chargerait de toutes les armes et des bonnes denrées du magasin. Le sergent du fortin pourrait plus tard passer par là, il y trouverait deux charognes gonflées comme des ours crevés depuis une lune. Le sergent, lui aussi, il l'aurait, lui et ses soldats. Il leur volerait leurs armes, ensuite il leur couperait les jarrets et les attacherait sur une fourmilière. Il reviendrait les voir de temps à autre, lorsque leurs carcasses seraient bien propres. Enfin il s'enfuirait si loin, si loin, que même le diable ne pourrait le rejoindre. Ces perspectives réjouissantes firent sourire l'Indien. Chemin faisant, ses chiens lui prirent deux péludos (9), dodus comme des cochons de lait ; le soleil étant déjà haut, le Toba s'arrêta, entrava sa monture, fit du feu et, sur la braise, mit à rôtir les deux tatous dans leur carapace. Après le repas, homme et chiens sombrèrent dans un sommeil réparateur. Vers la fin du jour, alors qu'il allait repartir, Lino, scrutant la clairière, aperçut au loin le grand cou dressé d'un guanaco en faction. Sur un signe, les chiens se tapirent et ne bougèrent plus. Prenant son arc et ses flèches, il s'enfonça dans la forêt pour en ressortir le plus près possible du gibier. Se couchant, il rampa alors vers le but, silencieux et invisible comme un cascabel (10). Il s'était approché ainsi à une bonne portée de flèche, lorsque le grand guanaco tourna la tête de son côté, souffla, comme ont coutume de le faire ces animaux lorsqu'ils sont contrariés. À ce bruit, dix, puis vingt cous se dressèrent, et la fuite du troupeau commença. Lino avait lâché un trait, il vit un animal sauter de côté avant de reprendre sa course : il avait touché. Il siffla ses chiens, qui arrivèrent en trombe. L'Indien savait que sa tâche était terminée et que celle de la meute commençait. Il savait aussi qu'elle se terminerait infailliblement par la victoire. Il s'en fut donc chercher la yegua et tranquillement prit la direction des guanacos. La nuit était tombée et la lune se levait à l'horizon. À mesure qu'il avançait, il percevait plus distinctement les aboiements des chiens ; toutefois, plus il s'en rapprochait, plus ces aboiements lui paraissaient rageurs, comme s'il se fût agi d'une lutte, alors que le sort du guanaco devait être réglé depuis longtemps. Il pressa l'allure et se trouva bientôt en face d'un spectacle extraordinaire. Le guanaco était bien à terre ; mais il était gardé par un énorme jaguar qui défiait la meute. Un des chiens, qui s'était approché de trop près, reçut un coup de patte qui l'envoya en l'air pour retomber inerte comme un paquet de chiffons. L'arc bandé, à pied, Lino s'approcha. À dix mètres, il tira une flèche qui entra dans le ventre du fauve avec un bruit mat. Dans un bon prodigieux, le jaguar vint tomber, debout, les griffes menaçantes, près de l'homme qui lâcha son second trait, à bout portant, dans la gorge de la bête. Le dernier rugissement s'éteignit dans un flot de sang et le fauve roula à ses pieds. Le Toba se redressa et poussa trois bip ! ... ou ! ... si aigus que l'écho s'en répéta de tous les côtés de l'immense clairière. Il entrava et dessella sa monture, fit du feu, dépeça le grand guanaco à l'épaisse toison fauve et frisée, mit en réserve les énormes gigots, disposa près des braises deux ou trois rôtis sur des tiges de bois vert enfoncées dans le sol, puis abandonna le reste aux chiens qui s'en gavèrent. À genoux, alors, il s'approcha du cadavre du jaguar, caressa longtemps avec volupté la belle peau tachetée, examina les griffes, les dents, lui parlant comme à une personne vénérée. Avec précaution il retira les flèches. Enfin, comme à regret, il se mit en devoir, avec des soins minutieux, d'enlever la belle parure. Ce travail terminé, il fouilla le corps, en retira le cœur sanglant et le croqua de ses dents de sauvage. Il dormit sur la peau du guanaco, celle pliée du fauve lui servant d'oreiller. En arrivant au rancho le lendemain, il déploya devant Alonso la magnifique dépouille encore ruisselante de sang. Le commerçant en pâlit de convoitise ; il remplit un verre de caña ; mais Lino ne détacha pas les yeux des Winchester et les montra du doigt. Alonso partit d'un rire moqueur et avança le verre. L'Indien s'en détourna, saisit son couteau et allait couper la peau, quand le bras d'Alonso l'arrêta. Celui-ci décrocha la carabine, Lino la pressa sur sa poitrine et se fit remettre un sac de provisions. Sans se retourner, l'Indien partit pour Lollak Nillak. 1910, c'était, si j'ai bonne mémoire, l'année de la comète de Halley. Je me trouvais en mission dans les forêts du Chaco. Un soir, assis près du feu de camp, j'essayais de converser avec un Indien qui était venu m'offrir ses services comme guide et comme chasseur. Il disait s'appeler Lino Charra et avait déjà servi dans d'autres missions. C'était un homme vigoureux, paraissant âgé d'une trentaine d'années. Il se faisait assez bien comprendre en espagnol.
Lino avait maintenant une solide compagne que le sorcier avait tatouée de belles volutes rouges, bleues, noires, depuis les pieds jusqu'aux cheveux. Il avait même trois ou quatre petits diables couleur chocolat, à la chevelure raide, épaisse et noire. Les aînés promettaient d'être d'aussi bons chasseurs que leur papa et un tantinet bandits. Je voulus savoir s'il était retourné au rancho d'Alonso. Il répondit négativement : Alonso avait été assassiné. Mais, ajouta-t-il, les Charras n'y ont été pour rien, c'était un homme qui avait beaucoup d'ennemis. Ce qui, après tout, était bien possible. Léon VUILLAME.(1) Une des races indiennes du Chaco. |

|
Le Chasseur Français N°666 Août 1952 Page 460 |

|

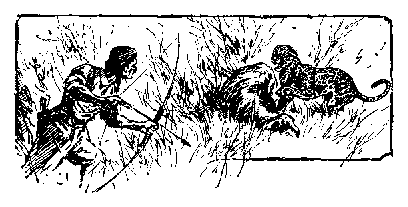 Le jeune Toba (1) ouvrit des yeux hagards, il se passa
la main sur le visage et sur le front où il écrasa quelques familles de
moustiques gonflés de sang. Trois de ses chiens étaient près de lui et
semblaient épier son réveil. Le quatrième, le vieux Tuerto (2), accroupi à
quelques pas de là, surveillait la yegua (3) squelettique qui broutait parmi
les touffes d'herbes dures et coupantes.
Le jeune Toba (1) ouvrit des yeux hagards, il se passa
la main sur le visage et sur le front où il écrasa quelques familles de
moustiques gonflés de sang. Trois de ses chiens étaient près de lui et
semblaient épier son réveil. Le quatrième, le vieux Tuerto (2), accroupi à
quelques pas de là, surveillait la yegua (3) squelettique qui broutait parmi
les touffes d'herbes dures et coupantes.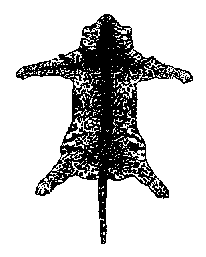 L'Indien en question avait un vieux mousqueton Winchester
dont il ne se séparait jamais. Je lui demandai d'où il le tenait, et c'est
alors qu'il me conta l'histoire que je viens d'écrire.
L'Indien en question avait un vieux mousqueton Winchester
dont il ne se séparait jamais. Je lui demandai d'où il le tenait, et c'est
alors qu'il me conta l'histoire que je viens d'écrire.